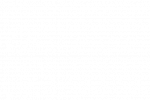Faire l’Europe et défendre les « fleurons français »

Faire l’Europe et défendre les « fleurons français »
Editorial. Les annonces des fusions des chantiers navals STX avec l’italien Fincantieri et d’Alstom avec l’allemand Siemens, révèlent les limites du double discours du président Macron, qui veut céder les rênes de ces entreprises en gardant le contrôle.
Emmanuel Macron et le premier ministre italien Paolo Gentiloni, à Lyon, le 27 septembre, pour le 34e Sommet franco-italien. / Laurent Cipriani / AP
Editorial du « Monde ». Ce n’est qu’« un léger décalage », comme le dirait Sempé. Un écart d’à peine 0,5 % ou 1 %. Mais, dans les deux gros dossiers de politique industrielle bouclés cette semaine par Emmanuel Macron, il se traduit par une distance problématique entre le discours officiel et la réalité. Comme si les pouvoirs publics n’assumaient qu’à demi la ligne européenne qu’ils ont adoptée.
L’affaire des chantiers navals de Saint-Nazaire est frappante. Après des mois de négociations, la France a accepté de rapprocher le dernier grand chantier tricolore de son principal concurrent, Fincantieri. L’accord va permettre au groupe public italien de « diriger les destinées de cette entreprise », a reconnu M. Macron mercredi. Cependant, il n’était pas question de laisser les Italiens seuls maîtres à bord d’un site jugé stratégique.
Paris a donc échafaudé un montage subtil. L’Italie et la France détiendront chacune 50 % du capital. Mais Paris prêtera à Fincantieri 1 %, avec la possibilité de le reprendre si le groupe de Trieste ne tient pas ses promesses. Le résultat ? « Nous sommes à 50-50, avec de vraies garanties », s’est réjoui mercredi M. Macron. « Fincantieri aura la disponibilité directe de 51 %, et donc le plein contrôle », ont déclaré les officiels italiens. Et les deux parties disent vrai !
Une confiance limitée
Chez Alstom, le gouvernement a aussi vanté le « rapprochement entre égaux » conclu avec Siemens, la création d’un leader européen dans lequel l’industriel allemand détiendra au départ « 50 % » et ne pourra pas dépasser 50,5 % pendant quatre ans. Une égalité de façade. Car, face à Siemens, le reste du capital sera éclaté. Le grand actionnaire d’Alstom, Bouygues, compte se retirer, et l’Etat ne veut pas le remplacer. Au bout de quatre ans, Siemens pourra monter librement au-delà du plafond initial.
50 % ou bien 50,5 % voire 51 % ? Cette légère marge, celle qui sépare l’alliance entre égaux de la vraie prise de contrôle, est symptomatique du double discours français. D’un côté, M. Macron donne son aval à de grandes fusions. Face à des rivaux chinois ou nord-américains offensifs, il veut constituer des champions estampillés « Union européenne ». « L’avenir de l’industrie française (…) se joue dans le partenariat avec les autres Européens », a dit le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, chez Alstom. Et si, pour faire naître ces géants, la France doit renoncer au contrôle qu’elle détenait, elle y est prête.
D’un autre côté, l’Etat n’entend pas tout à fait lâcher prise. Il n’a qu’une confiance limitée en ses nouveaux partenaires, comme le montre la kyrielle d’engagements demandés à Fincantieri et à Siemens, et la possibilité de reprendre la main à Saint-Nazaire. Le gouvernement sait qu’il est politiquement risqué de dire : « Peu importe la nationalité des entreprises, tant qu’elles sont européennes ». Ces derniers jours, les souverainistes de droite comme de gauche ont immédiatement critiqué la « capitulation » de M. Macron et l’« éviscération » de l’industrie française.
Faire l’Europe et défendre les « fleurons français », céder les rênes tout en gardant un contrôle ultime : toutes les limites du « en même temps » macronien, version industrielle, sont là. En ce sens, le nouveau président peine à rompre avec une politique industrielle qui depuis trente ans s’est refusée à arbitrer entre l’efficacité économique, les intérêts particuliers et l’intérêt de l’Etat. On voulait éviter le désastre industriel et la colère populaire. On peut avoir en même temps l’un et l’autre.