Fonctionnaires et élus locaux, deux frondes qui pourraient s’avérer dangereuses
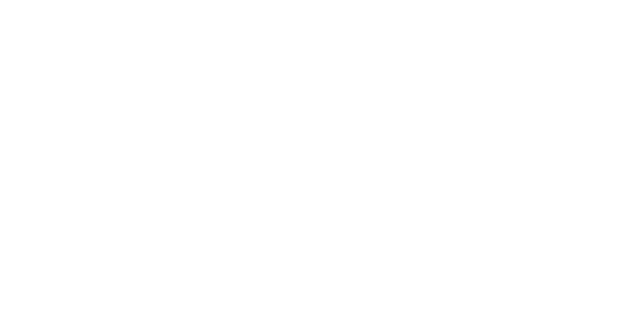
Fonctionnaires et élus locaux, deux frondes qui pourraient s’avérer dangereuses
Editorial. En négligeant certaines de ses promesses, l’Etat donne aux intéressés le sentiment d’être réduits au rôle humiliant de simple variable d’ajustement budgétaire.
Manifestation de salariés de la fonction publique, le 10 octobre à Nantes. / STEPHANE MAHE / REUTERS
Editorial du « Monde ». Jusqu’à présent, le gouvernement a géré avec habileté une rentrée sociale qu’on lui promettait explosive. Après l’interminable empoignade de 2016 sur la loi El Khomri, la nouvelle réforme du droit du travail, qui plus est par la voie d’ordonnances concoctées en plein été, mettrait forcément le feu aux poudres, prédisaient les plus pessimistes ou les plus combatifs.
Il n’en a rien été. Soigneusement préparée, la concertation menée durant l’été avec les organisations professionnelles a permis de désamorcer assez d’inquiétudes pour diviser le front syndical et obtenir, sinon l’aval, du moins une relative neutralité de la CFDT et de FO. Les ordonnances ont été signées fin septembre, et personne n’imagine que le gouvernement revienne en arrière. La réunion intersyndicale, lundi 9 octobre, a d’ailleurs confirmé l’isolement de la CGT sur ce terrain.
Pour autant, le chef de l’Etat et le premier ministre auraient tort de se réjouir trop vite. Car ils ont suscité, cet été, deux frondes qui pourraient s’avérer fort dangereuses. D’une part, celle des fonctionnaires appelés à la grève, mardi 10 octobre, par l’ensemble de leurs syndicats, unanimes comme rarement. D’autre part, celle des élus locaux dont les associations, les unes après les autres (régions, départements, maires), semblent prêtes à entrer en rébellion contre « Paris ».
Aussi différents soient les acteurs et les problématiques, ces deux frondes ont les mêmes causes : contrairement à la réforme du travail, le gouvernement a oublié quelques bonnes paroles du candidat Macron, et il n’a pas pris la peine de préparer le terrain avant d’annoncer, au fil de l’été, une rafale de décisions budgétaires douloureuses.
Les fonctionnaires savaient que le chef de l’Etat entendait supprimer 120 000 postes durant son quinquennat (même s’il avance à très petits pas, avec 1 400 suppressions budgétées pour 2018), qu’il voulait rétablir le jour de carence en cas d’absence pour maladie et qu’il envisageait, de façon plus floue, de réformer le statut de la fonction publique. Mais ils avaient parfaitement entendu l’engagement d’Emmanuel Macron : ils bénéficieraient, comme les salariés du privé, d’une amélioration de leur pouvoir d’achat. L’annonce du gel du point d’indice, qui sert de base de calcul des salaires de la fonction publique, puis d’une simple « compensation » de la hausse de la CSG, leur a fait l’effet d’une douche glacée.
De même pour les élus locaux, auxquels le chef de l’Etat promettait, au début de l’été, un séduisant « pacte girondin ». Au lieu de quoi, ils ont appris, notamment, que la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales serait de 13 milliards d’euros, et non pas 10 milliards, durant le quinquennat, que le nombre d’emplois aidés dont ils bénéficiaient serait drastiquement réduit, le tout ajouté à la suppression annoncée de l’essentiel de la taxe d’habitation, ressource-clé des communes.
Dans les deux cas, négligeant certaines de ses promesses, l’Etat, impécunieux, cherche des sources d’économies pour réduire les déficits publics. Mais il donne aux intéressés le sentiment d’être réduits au rôle humiliant de simple variable d’ajustement budgétaire. Le résultat est identique : la confiance est rompue. Or, le premier ministre, féru de littérature policière, et le président, grand amateur des dialogues d’Audiard, ne peuvent l’ignorer : quand on le pousse à bout et qu’on touche au « grisbi », « le cave se rebiffe ». Et ça peut faire des dégâts.







