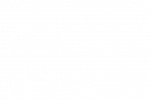Rétrospective : Luchino Visconti, chercheur du temps perdu

Rétrospective : Luchino Visconti, chercheur du temps perdu
Par Mathieu Macheret
La Cinémathèque française consacre un riche hommage au cinéaste et metteur en scène italien.
Du mercredi 11 octobre au jeudi 9 novembre, La Cinémathèque française rend hommage au grand Luchino Visconti (1906-1976), prince milanais aux sympathies communistes, homme de théâtre et d’opéra, qui légua au cinéma italien une poignée de films inoubliables (quatorze entre 1943 et 1976), tels que Le Guépard (1963) ou Mort à Venise (1971).
Sans doute cette œuvre s’était-elle, avec les années, laissé figer dans l’image d’un esthétisme raffiné, cultivant les reconstitutions historiques avec un faste et un sens du grandiose quelque peu écrasants. La rétrospective arrive à point nommé pour rendre à Visconti son secret et son vertige. Ceux d’un cinéaste pour qui la grandeur, le souffle opératique, la vision historique n’étaient jamais que les somptueux écrins de subjectivités tourmentées et de solitudes irrémédiables. Si le héros viscontien est plongé dans le siècle (notamment les XIXe et XXe siècles, sur la brèche des conquêtes successives de la modernité), c’est pour mieux s’y laisser engloutir et s’évanouir comme une ombre en plein cœur du tumulte.
Disciple de Jean Renoir, dont il fut l’assistant sur Les Bas-Fonds et Partie de campagne, Visconti, dès ses débuts, préfigure le néoréalisme, sans lui appartenir complètement. Son premier long-métrage, Les Amants diaboliques (Ossessione, 1943), adapté du célèbre roman noir de James M. Cain Le facteur sonne toujours deux fois (1934), se penche sur la relation adultère et criminelle de deux proscrits, dans une auberge perdue de la plaine du Pô, en pleine période de dépression économique. Déjà, le souci de décrire une réalité sociale (chômage, prison conjugale et dénuement) est bousculé de l’intérieur par les orages d’une passion intempestive, dont la sensualité brutale (les amants s’étreignent dans le cambouis et le graillon) fit scandale à l’époque.
Dans La terre tremble (1948), Visconti raconte la lutte d’un village de pêcheurs, en Sicile, contre les grossistes qui les maintiennent dans la misère, dans une grande fresque aux accents ethnographiques (des villageois du cru jouent leurs propres rôles). Son protagoniste ’Ntoni (Antonio Arcidiacono), jeune pêcheur qui voit son métier ancestral tomber aux mains d’une corporation (une classe moyenne en devenir), est déjà une version primitive du prince Salina (Burt Lancaster), dans Le Guépard : tous deux, de part et d’autre de l’échelle sociale, portent sur leurs épaules la fin d’un monde familier et assistent, impuissants, à l’avènement du suivant.
Tragédie antique
De fait, le héros viscontien est bien souvent un être entre deux mondes, entre deux temps, broyé dans la tectonique de l’Histoire ou se dressant comme un seul homme sur le socle de son anachronisme. Il en va ainsi pour le prince Salina du Guépard, dernier pilier d’une aristocratie sicilienne déjà fantomatique, au seuil d’un Risorgimento (la campagne de Garibaldi) qui entraîne l’Italie sur la voie de la monarchie constitutionnelle, sans rien changer à la structure oligarchique du pouvoir (c’est le fameux mot de Tancrède, joué par Alain Delon : « Pour que tout reste comme avant, il faut que tout change »). C’est également le cas de Rocco (Alain Delon toujours), dans le magnifique Rocco et ses frères (1960), dont la famille, venue d’une Lucanie arriérée, débarque dans la banlieue de Milan, puis se désagrège au contact de la modernité urbaine. De même, dans Les Damnés (1969), une riche famille d’industriels allemands, les von Essenbeck, se laisse gangrener par la montée du nazisme, nouvel ordre qui finira par avoir raison d’elle et dont la puissance de séduction est ici figurée, à longueur de zooms nauséeux, comme une perversion sexuelle.
A travers ces familles déchirées, déplacées ou ivres de pouvoir, à l’image des Atrides ou des Labdacides, on décèle l’influence évidente de la tragédie antique, comme récit possible du choc sans cesse réitéré entre l’ancien et le nouveau. A ce titre, le film le plus révélateur est sans doute le méconnu et magnifique Sandra (Vaghe stelle dell’Orsa, 1965), qui remonte le fil d’une malédiction familiale – un inceste entre frère et sœur –, dans une vieille maison poussiéreuse aux reflets gothiques. L’héroïne (Claudia Cardinale dans son plus beau rôle, choisie par Visconti pour son profil « étrusque ») s’abandonne à un atavisme scandaleux, venu du fond des âges, et qui signe en quelque sorte la destruction du foyer bourgeois.
Si le héros viscontien aspire à une vie meilleure, il n’en est pas moins possédé par le sang dont il a hérité, un sang qui le ronge et qui répand sur son existence le germe d’une corruption généralisée. On pense tout autant au Tullio (Giancarlo Giannini) de L’Innocent (1976), conduit à l’infanticide en se croyant un surhomme nietzschéen, qu’à la comtesse Serpieri (Alida Valli) dans Senso (1954), fonçant tête baissée dans l’illusion d’un romantisme échevelé. Corruption des âges, des systèmes et des cœurs.
Mais tout l’œuvre de Visconti, grand lecteur de Marcel Proust, qu’il rêvait d’adapter, se résout sans doute dans la recherche d’un temps perdu, qui revient à ses personnages par bouffées successives et fait d’eux, à terme, des fantômes de leur propre époque. Curieusement, c’est par le biais de Thomas Mann que Visconti s’est le plus rapproché de son écrivain fétiche, en portant à l’écran La Mort à Venise. A la veille de la première guerre mondiale, Dirk Bogarde, dans la peau d’un chef d’orchestre déchu, parcourt les rues d’une Venise infestée, en quête d’une illumination de beauté, dans la figure fuyante et quasi fantasmatique d’un adolescent fluet. Les glissements languissants de la caméra, la suspension lente du récit, le retour obsessionnel des symphonies de Gustav Mahler ont suscité cette conscience du temps se retournant sur lui-même, pour mieux surprendre la mort au travail. Une belle façon d’entrer dans l’éternité.
Rétrospective Luchino Visconti. Du 11 octobre au 9 novembre à La Cinémathèque française. www.cinematheque.fr