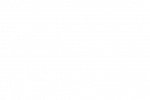« Le refus de la sélection à l’université a provoqué la marchandisation de l’enseignement supérieur »

« Le refus de la sélection à l’université a provoqué la marchandisation de l’enseignement supérieur »
Propos recueillis par Adrien de Tricornot
Le sociologue François Vatin a défendu, lors d’un tchat, l’idée que c’est en laissant les universités fixer leurs conditions d’accès qu’elles ne seront plus un choix d’orientation « par défaut ».
Première année de licence de droit à l’université Paris Descartes (site de Malakoff) en septembre 2016. / CAMILLE STROMBONI/CC BY-ND 2.0
La réforme, en cours de discussion, sur l’accès à l’université passe-t-elle par une sélection des étudiants après le bac ? Coauteur d’une tribune publiée dans Le Monde, « Arrêtons de penser que l’université est la solution pour tout le monde », le sociologue François Vatin en a débattu avec les internautes lors de la journée spéciale rentrée étudiante du Monde Campus, jeudi 28 septembre. Voici le compte rendu de cet échange en direct.
Julie Kal : Il faut arrêter de dire que les étudiants en général s’opposent à la sélection à l’université, c’est faux.
François Vatin : Tout à fait. Il faut savoir qu’aujourd’hui, les étudiants qui sont dans des cursus non sélectifs de licence et master représentent environ 40 % des étudiants en France. Et beaucoup d’entre eux avaient pu candidater pour des cursus sélectifs. Par ailleurs, l’introduction de la sélection à l’entrée en master s’est globalement bien réalisée, même s’il y a pu y avoir des problèmes ici ou là.
Louise : Ne trouvez-vous pas que mentionner des problèmes « ici et là » sur la sélection en master relève de l’euphémisme alors qu’au 24 juillet, il y avait déjà plus de mille plaintes déposées au rectorat ? Et que la faculté de Nanterre est actuellement en procès avec une étudiante refusée en master ?
Il y a sûrement des problèmes individuels à résoudre. Je disais simplement que sur le principe, cette réforme n’avait pas provoqué une levée de boucliers. Et que donc, comme le disait la personne qui avait posé la question initialement, les étudiants en France étaient globalement préparés au principe de la sélection.
Le jeu en vaut-il la… : Mettre de la sélection à l’université, pour seulement quelques milliers de bacheliers qui n’ont pas de places dans des filières ultra-tendues (via un tirage au sort certes absurde), n’est ce pas prendre le risque de mettre à mal la démocratisation que tente de réussir notre pays ? Alors certes, la réussite en licence n’est pas au rendez-vous, mais laisser tous ceux qui n’ont pas les prérequis pour réussir dehors, n’est-ce pas se débarrasser des difficultés que l’université devrait à l’inverse relever ? Et où vont aller tous ces jeunes ? Qu’on ne croit pas que cela va se limiter aux bacheliers professionnels, les bacheliers généraux vont être tout autant concernés !
La question n’est pas uniquement celle des filières en tension. Sélectionner cela ne veut pas forcément dire choisir « les meilleurs » parce que le nombre de places serait limité (régime du concours). Cela peut vouloir dire tout simplement : inviter à ne pas orienter vers une formation des personnes dont la probabilité de réussite est très faible et qui souvent ne désirent même pas suivre cette formation.
Il y a un vrai problème dans la politique d’insertion sociale et professionnelle de la jeunesse. Dire que l’université devrait prendre en charge toute la jeunesse bachelière, y compris la fraction d’entre elle qui n’a aucune envie de mener des études universitaires, n’est pas la bonne réponse. L’enjeu est aussi d’inviter ainsi une large partie des bacheliers qui, aujourd’hui, fuit l’université (c’est le cas de 80 % des bacheliers S, hors filière santé) à la rejoindre.
Lucie : Il est temps de mettre une sélection à l’université pour arrêter cet arbitraire hallucinant du tirage au sort. Mais comment pensez-vous que cette sélection doit s’effectuer, très concrètement… Quels critères ? Quelle alternative pour ceux qui n’ont aucune chance de réussir à la fac ? Faut-il arrêter de dire que tout bachelier a le droit d’accéder à l’enseignement supérieur ?
Chaque établissement doit être maître de la définition des conditions d’entrée dans chaque cursus afin d’assurer de bonnes chances de réussite aux étudiants, comme cela paraît normal dans les DUT ou les BTS par exemple. Je suggère par ailleurs de mettre en place une année de remédiation postbac pour toutes les personnes désireuses de rentrer dans un cursus et dont l’établissement a jugé qu’elles ne disposaient pas des prérequis pour cela.
Plus généralement, je pense que beaucoup de jeunes gens au sortir du baccalauréat n’aspirent tout simplement pas à une poursuite immédiate d’un cycle d’études, ce qui peut se comprendre, au bout de quinze à vingt ans passés sur les bancs de l’école. Il faut penser une politique audacieuse de la jeunesse, qui n’assujettirait pas, par exemple, le droit à la Sécurité sociale ou à une aide sociale, à l’inscription à l’université.
La contrepartie est qu’il faut rendre plus facile l’accès à l’université à tous les âges de la vie, ce qui nécessite une autre grande réforme : celle de la politique de formation professionnelle continue.
GP : La sélection à l’université s’accompagne d’un modèle bien précis : celui de la marchandisation des savoirs par le biais de l’introduction des méthodes gestionnaires du privé dans l’université (ce qui est d’ailleurs déjà le cas depuis la loi LRU). N’est-ce pas, d’une part, renoncer à la conviction politique que l’émancipation citoyenne passe par un accès à l’éducation d’un maximum de personnes d’une même classe d’âge (qu’en est-il ces convictions républicaines désormais) ?
D’autre part, n’est-ce pas favoriser l’idée que tout savoir doit être pensé comme une compétence, c’est-à-dire en vue de l’acquisition d’un métier (et dans ce cas, je ne donne pas cher des sciences sociales ou de leur utilisation – allez-vous devenir un sociologue au service du marketing ?) ? Et enfin, si on enlève l’université, est-ce qu’on ne s’apercevra pas que l’université permet de faire patienter tous ces chômeurs en devenir ?
C’est exactement l’inverse. C’est le refus doctrinal de l’introduction de la sélection à l’université qui a provoqué une marchandisation de l’enseignement supérieur en France, qui n’existait pas auparavant. Comme les places dans l’enseignement supérieur sélectif public sont contingentées, les étudiants et leurs familles se sont tournés vers le secteur privé, qui accueille aujourd’hui 20 % des étudiants en France. Outre le problème financier que cela induit (pendant combien de temps les classes moyennes accepteront-elles de payer deux fois l’enseignement supérieur de leurs enfants, par l’impôt et par les frais d’inscription dans le privé ?), cela oriente les étudiants vers des formations de court terme étroitement associées au marché au détriment des études fondamentales.
C’est parce que je suis un défenseur d’une université républicaine accueillant toutes les classes de la société dans un enseignement libre de toute contrainte politique ou marchande que je défends le principe de l’introduction de la sélection à l’entrée à l’université.
Maëlys : A votre avis, à partir de quand doit-on parler d’orientation ? Dès le collège ou à partir du lycée ? Et comment faire pour que les collégiens et/ou lycéens aient une bonne représentation à la fois de l’enseignement supérieur et des débouchés correspondant ? Les profs du secondaire sont-ils à même d’expliquer sans préjugés les différences entre BTS, IUT, prépa, fac, etc. ?
De fait, l’orientation se réalise tout au long du cursus scolaire, depuis le collège. L’enjeu est de rendre possible à tout moment, pendant la scolarité et au-delà, des passerelles. La logique de gestion de flux que nous connaissons a introduit partout des verrous, qu’il faut lever.
Quant à l’orientation postbac, il faut avant tout revaloriser l’image de l’université auprès des élèves, de leur famille, du corps enseignant du secondaire : tant qu’on considérera qu’on va à l’université par défaut, parce que toutes les autres portes sont fermées, il n’y aura aucune orientation positive à l’université.
Marc-Antoine : Vous ne parlez que de sélection, mais l’urgence n’est-elle pas de mettre plus de moyens sur les universités ? Peut-on accueillir encore 40 000 étudiants de plus l’an prochain avec le même budget (ou presque) pour les facs ?
Contrairement à un discours convenu, l’Etat mais aussi les collectivités locales ont investi beaucoup d’argent dans les universités depuis plusieurs décennies. Les effectifs d’enseignants universitaires ont crû dans des proportions considérables. Dans la plupart des cas, les locaux sont aujourd’hui propres et accueillants, en comparaison de ce qu’ils pouvaient être dans les années 1970.
Les masses d’effectifs que vous évoquez sont essentiellement en première année et sont pour une part plus « statistiques » que réelles. Quand on parle du taux d’échec en première année, on oublie que la plupart de ces « échecs » correspondent à des « défaillances » (des étudiants qui n’ont pas rempli toutes leurs obligations vis-à-vis des examens). En revanche, dans de nombreux établissements et de nombreux cursus, les universités peinent à remplir leurs masters avec des étudiants ayant le niveau requis.
F Pesanti : Comment pouvez-vous affirmer que l’Etat et les collectivités « ont investi beaucoup d’argent dans les universités depuis plusieurs décennies » ? Le budget par élève de l’université française est l’un des plus bas des grands pays scientifiques : ridicule par rapport aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, à la Suisse. Sur quelle statistique vous basez-vous pour dire que l’université française a les moyens ? Quant aux effectifs, quid du ratio effectifs/nombre d’élèves ou même effectifs universités/population globale ?
Il n’y a qu’en France que l’on fait le distinguo entre universités et grandes écoles. Et que l’on affirme le droit de tout diplômé de l’enseignement secondaire à poursuivre des études universitaires. Les comparaisons internationales sont donc difficiles. Ce que j’affirme est simplement que les moyens publics affectés aux universités ont crû de façon conséquente au cours de ces dernières décennies, sans pouvoir résoudre le problème. Le récent débat autour du tirage au sort a révélé la question jusqu’à la caricature : on a interdit l’accès à certaines filières à des étudiants désireux et en mesure de poursuivre le cursus pour pouvoir accueillir « sur le papier » des étudiants dont on sait qu’ils n’ont quasiment aucune chance d’arriver au terme du cursus. Comme on le voit, ce n’est pas le nombre de places qui manque, c’est qu’elles sont mal attribuées.
F Pesanti : A partir du moment où l’université va être sélective, ne va-t-on pas vers le développement de la rhétorique (très active dans la réforme des tuition fees [frais de scolarité] au Royaume Uni) affirmant que « ceux qui ont le privilège d’aller à l’université doivent payer pour l’université, car ce serait injuste que ceux qui en sont exclus payent », donc à l’accroissement des frais de scolarité ? Rhétorique que vous esquissez aussi dans votre remarque sur les classes moyennes qui paieraient doublement pour l’éducation (impôts + écoles privées) ? N’y a-t-il pas une équivalence, certes indirecte, entre sélection et financement privé, dans la mesure où il est difficile de faire contribuer des groupes sociaux qui seront exclus ou n’auront pas forcément de place de droit à l’université ?
La France a depuis la fin du XIXe siècle une politique fondée sur le principe de la gratuité ou quasi-gratuité de l’enseignement, à tous les niveaux. C’est là une des bases de la République. Il est évident que pendant très longtemps, en ce qui concerne l’enseignement supérieur mais également l’enseignement secondaire, cela a profité essentiellement aux couches les plus favorisées de la population puisque les autres dépassaient rarement le niveau de l’enseignement primaire. Ce principe républicain est toutefois ce qui a permis l’extension graduelle de la formation à des couches de plus en plus larges de la population.
L’enjeu de l’introduction de la sélection à l’entrée à l’université est de maintenir un enseignement supérieur public de haut niveau. Il est certain qu’il y a une certaine corrélation entre niveau académique et niveau social. Il faut lutter à tous les niveaux du cursus pour tempérer ce déterminisme social. Mais il est de l’intérêt de tous, y compris des couches les plus défavorisées de la société, que l’enseignement supérieur public reste une référence de qualité. Autrement, les universités seront dédiées aux populations socialement les plus défavorisées, les autres les ayant massivement désertées. Ce ne sera pas un progrès de la démocratie.
MT : Le problème de sélection et également d’orientation ne cacherait-il pas également un problème de connaissances du rôle de l’université. On a tous entendu « fais de bonnes études et tu auras un bon emploi ». Les gens s’y rendent tête baissée, déterminée à avoir un emploi dans le domaine qu’ils ont choisi. Or, l’université n’est pas le temple de l’emploi mais celui de la connaissance. Ainsi, certains proposent de professionnaliser des cursus… Professionnaliser tous les cursus plutôt que de mieux informer (en faisant comprendre que l’université n’a pas pour rôle premier de rendre les personnes employables) serait alors la solution ?
Votre remarque est tout à fait pertinente. Un des gros problèmes de la politique de formation en France, tous niveaux confondus, est qu’on la justifie en permanence d’un point de vue utilitariste, en relation avec l’emploi, le salaire. Or ce qui est vrai pour un individu isolé, la situation des autres ne bougeant pas, n’est pas vrai pour l’ensemble des individus. On a plus de chances d’obtenir un emploi si on a une licence que si on n’en a pas. Mais ce n’est pas pour cela que, si tout le monde obtient la licence, tout le monde aura un emploi.
Il faut comprendre que la formation est un bien en soi, indépendamment de ce à quoi elle donne droit sur le marché de l’emploi. Au début du XXe siècle, savoir lire et écrire vous distinguait encore au sein de la société. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Pourtant, lire et écrire restent des valeurs importantes. Comme vous le dites, l’université doit être un lieu de production, de conservation et de transmission du savoir, ouvert à tous les citoyens, à tous les âges de la vie. Une telle idée n’est pas forcément contradictoire avec l’existence de cursus professionnels, mais l’université ne saurait être effectivement une grande école professionnelle, surtout si elle est destinée à recevoir ceux qui n’auraient pas trouvé de place dans les autres écoles professionnelles.
Lili : Vous parlez de locaux propres et accueillants dans la plupart des endroits. Durant mes études, j’en suis à mon quatrième campus universitaire, à chaque fois ce sont : des amphithéâtres qui ont des fuites au plafond, auxquels ils manquent des chaises ; des salles de TD où 80 % des stores sont cassés ; des urinoirs inutilisables jamais réparés… Des locaux dont la propreté générale laisse clairement à désirer, et pour ce qui est d’être accueillant, c’est quand même compliqué quand la moitié des chaises de l’amphi sont hors d’état… Est-ce que je suis vraiment malchanceuse, ou alors est-ce que vous ne tombez que sur le seul amphi entretenu par campus, celui qui sert à organiser les conférences ?
Je ne sais pas dans quel campus vous avez fait vos études et à quelles dates. Au cours des années 1970, je suivais des travaux dirigés dans des baraquements datant de la guerre, chauffés au poêle à mazout. A Nanterre, qui n’est pas considéré comme un établissement particulièrement bien doté, la surface bâtie a été multipliée par deux depuis que j’y ai été nommé professeur, en 1992. Tout n’est pas parfait, assurément, mais les locaux sont beaucoup plus confortables que je ne les ai connus. Et il y a même du papier-toilette dans tous les sanitaires, grâce à l’intervention mémorable, il y a une quinzaine d’années, de ma collègue Martine Ségalen !