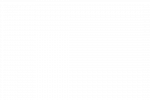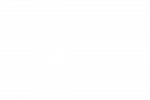Somalie : les leçons d’un carnage
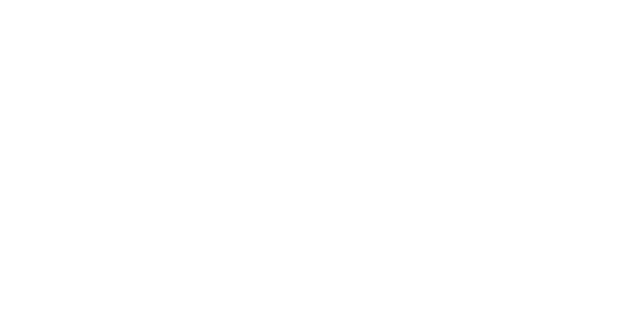
Somalie : les leçons d’un carnage
Editorial. L’attentat du 14 octobre, attribué aux Chabab, montre que ce groupe terroriste affilié à Al-Qaida exploite la faiblesse du gouvernement de Mogadiscio et l’impuissance de la communauté internationale.
A Mogadiscio, le 14 octobre, après un attentat qui a fait plus de 300 morts. | FEISAL OMAR / REUTERS
Editorial du « Monde ». Trois jours plus tard, à Mogadiscio, les sauveteurs tentaient encore désespérément de secourir de possibles survivants, ou au moins de retrouver dans les décombres les restes des quelque 300 victimes de l’attentat au camion piégé perpétré samedi 14 octobre dans la capitale somalienne. Trois cents morts et environ 500 blessés : c’est l’attentat le plus meurtrier de l’histoire est-africaine, une région pourtant souvent ciblée par le terrorisme.
Ce terrible bilan, alourdi par la présence, sans doute imprévue, d’un véhicule transportant du combustible à côté du camion bourré d’explosifs qui a aussitôt enflammé les lieux, explique peut-être que l’attaque n’ait pas encore été revendiquée. Elle est, cependant, largement attribuée aux sinistres Chabab (« les jeunes »), groupe né localement il y a dix ans et affilié à Al-Qaida, qui contrôle toujours une partie substantielle du pays en dépit des efforts engagés pour le combattre.
Comment expliquer la puissance et la résilience des Chabab ? D’abord par l’agilité d’un mouvement qui se nourrit des maux somaliens que personne ne souhaite vraiment résoudre : pauvreté, anarchie, corruption, rapacité des élites, divisions claniques, accaparement des terres, absence d’Etat de droit.
Tristes constats
Les Chabab s’infiltrent dans les failles d’un pays en reconstruction. Tant que ces conflits dureront, les Chabab prospéreront. Plus qu’un groupe terroriste ou une organisation criminelle, le mouvement chabab est un acteur politique habile, un immense réseau d’information et d’influence, qui comprend et exploite les dynamiques somaliennes.
Deuxième facteur : la faiblesse du gouvernement de Mogadiscio, coquille vide, minée par la corruption et dominée par des membres de la diaspora déconnectés du pays réel. Le nouveau président, Mohamed Abdullahi Mohamed, dit « Farmajo », a certes suscité un espoir. Mais, sept mois après son élection, le gouvernement ne contrôle qu’une parcelle du territoire somalien.
Ce constat conduit à un troisième : l’impuissance de la communauté internationale. Des milliards ont été consacrés à la reconstruction de la Somalie, à la lutte contre le terrorisme et à la formation d’un gouvernement. Rien qu’en 2016, les Etats-Unis ont dépensé plus de 500 millions de dollars en opérations de sécurité. Les chercheurs estiment que, en vingt-cinq ans, jusqu’à 50 000 soldats et policiers somaliens ont été formés pour assurer la sécurité de leur pays. Où sont-ils ?
L’armée somalienne existe essentiellement sur le papier. Quant à la mission de l’Union africaine en Somalie (Amisom), forte de 22 000 hommes, elle s’essouffle, sous-équipée, mal financée, marquée par les divisions entre pays rivaux.
Ces tristes constats posent inévitablement des questions difficiles, et pas seulement sur la gestion la plus appropriée du défi chabab. Pourquoi le Somaliland, territoire indépendant depuis 1991, est-il épargné par les Chabab ? Peut-être faut-il chercher dans cet exemple miniature de « Somalie qui marche », ou à peu près, ce qui pourrait servir à une autre échelle.
Peut-être est-ce là le contre-exemple d’une Somalie centralisée et harmonieuse fantasmée dans les grandes conférences internationales. Il faut aussi revoir la mission de l’Amisom. Cette force est indispensable à ce stade, mais son financement, ses méthodes et sa composition demandent à être repensés. Pour les dirigeants africains et internationaux, le moment est venu de regarder la Somalie en face.