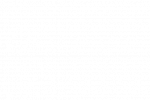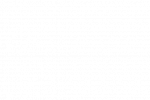« Durant mes trois années à l’université, personne ne nous a jamais parlé du sida et des autres IST »

« Durant mes trois années à l’université, personne ne nous a jamais parlé du sida et des autres IST »
Apeès avoir vu le film « 120 battements par minute », Réda Merida s’est interrogé sur la sensibilisation aux infections sexuellement transmissibles à l’université.
Chronique. Réda Merida, licencié ès sciences politiques et étudiant en Big Data et analyse sociale à Paris, évoque le manque de sensibilisation aux infections sexuellement transmissibles (IST) à l’université.
Le film 120 battements par minute, sorti fin août, est une fresque bouleversante qui retrace le combat acharné des militants d’Act Up-Paris durant les années sida. Sean, Thibault, Sophie, Nathan, Eva… sont des jeunes gens des années 1980, infectés ou affectés, ils se battent face à l’indifférence de la société, l’immobilisme politique et le vice des groupes pharmaceutiques pour le droit des malades à accéder aux traitements. Ce film a permis de remettre sur la table une histoire qu’on croyait finie, il pousse à la réflexion sur ce qu’étaient ces années, la souffrance des personnes touchées, l’engagement associatif et, surtout, sur la continuité de ce combat aujourd’hui, alors que 6 000 personnes se découvrent porteuses du virus chaque année en France.
En sortant de la salle, après avoir vu pour la première fois le vrai visage de la maladie au-delà du ruban rouge ; la maladie des corps veules et rongés, des visages balafrés et des vies enlevées, j’étais interloqué par le fait que, durant mes trois années à l’université, personne n’est jamais venu nous apprendre comment nous protéger des maladies vénériennes. Ou simplement à bien mettre un préservatif. Alors même qu’une étude de la Smerep a récemment révélé que l’ignorance des étudiants sur ce sujet était très grande, avec un véritable relâchement des pratiques : pour 46 % des étudiants, l’usage du préservatif n’est pas automatique.
Les chiffres de la contamination ne baissent plus depuis 2011, ils augmentent même quand ils concernent certaines infections sexuellement transmissibles, telle que la chlamydia. Qu’est ce qui est fait pour contrecarrer cela ? « Pas grand-chose », me répond une infirmière du Service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (Siumpps, communément appelé « infirmerie ») de l’Université de Lille qui, avec ses collègues médecins et psychologues, essaie de sensibiliser les étudiants à ces sujets. Encore faut-il que les étudiants fassent le premier pas vers cette structure, et même s’ils le font, ils ne pourront demander des informations sur des maladies dont ils ne connaissent pas l’existence. « Notre nombre ne nous permet pas d’aller vers les étudiants. On le ferait si on avait assez de personnel mais pour l’instant rien n’est fait pour cela », regrette-t-elle.
« Des étudiants s’organisent »
Samia, militante d’une organisation de lutte contre le sida, dit le désarroi et la frustration qu’elle partage avec ses camarades : « Nous aimerions tellement venir à votre rencontre [les étudiants], mais nos moyens ne nous le permettent pas. Nous devons prioriser, et dans ce cas, les usagers de drogues et les travailleurs du sexe viennent avant. » S’y ajoutent les freins de certaines directions des universités, qui compliquent le travail des associations. Marion et son association étudiante souhaitaient monter un stand à l’Université catholique de Paris lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida, avec la présence de l’infirmière du Siumpps : « Il nous fallait envoyer un courrier pour demander une autorisation auprès de l’administration. On n’a jamais eu de réponse, ni positive ni négative ! »
Pour palier ce manque d’action des autorités compétentes, des étudiants s’organisent avec les moyens dont ils disposent pour effectuer ce travail, à l’image de Bon Chic bon genre, une association étudiante visant à représenter les personnes LGBTQI et les réflexions féministes au sein de Sciences Po Lille. Cette association a aussi pris en main le volet de la prévention, avec beaucoup d’engagement et de pragmatisme ; lors du week-end d’intégration de cette année, ils ont distribué des flyers où on retrouve des informations très pratiques : chaque pratique sexuelle est énumérée suivie de son mode de protection, ou bien, comment réaliser soi-même une digue dentaire à partir d’un préservatif interne.
La présidente de Bon Chic bon genre, Caroline Ponceau, regrette le manque de prise en compte de ces questions : « Dans notre IEP, on n’a jamais eu de campagne, ne serait-ce que des flyers pour prévenir un petit peu. On n’en a jamais eu ! » Elle estime aussi complètement insuffisant le travail effectué auprès des jeunes homosexuels et des HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes). En effet, l’étude Prevagay alertait déjà en 2015 sur l’exposition et la prévalence de cette catégorie au VIH.
L’absence de campagne de sensibilisation ciblée et le manque de dépistage (14 % de l’ensemble des étudiants sondés disent se faire dépister systématiquement en cas de changement de partenaire), accentue leur vulnérabilité. Antoine, un ami étudiant en communication à Paris, est d’accord avec ce constat. Il n’a jamais eu d’éducation sexuelle durant sa scolarité : « J’aurais aimé savoir plus tôt par exemple qu’on pouvait choper le sida en pratiquant une fellation, je l’ai appris en parlant avec des amis, j’ai flippé et suis allé me faire tester. » Il avait 19 ans.
De l’autre côté, les médecins essaient tant bien que mal de faire bouger la situation. Vincent Lambert, médecin généraliste installé à Angers, s’étonne qu’il n’y ait pas encore un service sanitaire pour les étudiants en médecine durant lequel ils s’engageraient dans la société pour faire de la prévention sur différents sujets, les IST en l’occurrence : « Ça ne coûterait rien à l’Etat car de toute façon les étudiants en médecine sont payés dès la 4e année, et avec leur nombre croissant, ils pourraient même effectuer leur stage en dehors des services des hôpitaux. » Un tel service sanitaire, défendu par Emmanuel Macron durant sa campagne, devrait se concrétiser en mars 2018, a annoncé cet été le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner.
Retrouvez Reda Merida sur Twitter et Instagram.