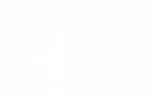Marie-Claude Pietragalla : « Quelle richesse de vieillir ! »

Marie-Claude Pietragalla : « Quelle richesse de vieillir ! »
Propos recueillis par Annick Cojean
Figure de la danse française, Marie-Claude Pietragalla met en scène et chorégraphie avec son compagnon « Être ou Paraître », actuellement au studio Hébertot à Paris. Elle s’est confiée à « La Matinale du Monde ».
Marie-Claude Pietragalla lors d’une répétition générale du Lorenzaccio, du poète et dramaturge Alfred de Musset, au château de Grignan le 19 juin. / ROMAIN LAFABREGUE / AFP
Je ne serais pas arrivée là si…
Si, à 8 ans, je n’avais pas ressenti que la danse allait me sauver d’une timidité maladive. Ce fut une vraie révélation. L’accès soudain à une expression où tout était possible. Où je pourrais oser, rêver, laisser émerger une autre « Pietra », et vivre collectivement des émotions, alors que dans la vie normale, ma timidité me paralysait et m’empêchait d’aller vers les autres enfants. Je voulais m’y jeter à corps perdu.
Comment en avez-vous eu l’intuition ?
En sortant bouleversée d’un spectacle de Maurice Béjart auquel mes parents m’avaient emmenée : Le Sacre du Printemps, L’oiseau de feu, Le Boléro… J’étais transportée. Et comme passait à ce moment-là à la télévision un feuilleton sur la danse et les aventures d’un petit rat de l’Opéra qui me passionnait – Les jours heureux - je me suis dit que c’était là que je devais étudier. Au palais Garnier, avec son dôme doré, ses lumières, ses costumes, ses couloirs mystérieux et ses toits interdits hérissés de statues. Là et pas ailleurs.
Vos parents ont-ils tout de suite été d’accord ?
Ils étaient sceptiques. Ne connaissant rien au milieu de la danse, ils pensaient qu’on ne prendrait pas une petite élève sans piston. Et puis ils avaient quelques préjugés désuets sur l’opéra, l’image de vieux messieurs donnant rendez-vous aux jeunes danseuses après la représentation… Mon père s’inquiétait aussi pour mes études. Il dirigeait un réseau médical dans un laboratoire, et je crois bien qu’il m’imaginait davantage une carrière de médecin que d’artiste. Car on ne savait rien à l’époque du statut d’artiste. Combien de fois me demandera-t-on plus tard, alors que je gagnais déjà ma vie dans le corps de ballet : « et à part la danse, qu’est-ce que tu fais ? »
Votre maman vous avait pourtant déjà inscrite à un cours de danse dès 6 ans.
Oui. « Pour canaliser mon énergie » disait-elle. J’étais une enfant unique, timide et solitaire, qui s’inventait des personnages, des amis, des frères et sœurs. Mais j’avais une énergie débordante. Un bulldozer. Je tournais, courais, bondissais, excessivement intrépide. Ma chance a été de tomber sur une professeure merveilleuse, une artiste dans l’âme, qui adorait le théâtre, jouait du piano, faisait de la peinture, mélangeait tous les arts. C’est drôle : je n’ai appris que bien plus tard qu’elle n’avait jamais dansé. Elle nous montrait les mouvements avec les mains, secondée par une assistante qui, elle, était danseuse. Mais qu’importe : elle nous faisait écouter de la musique et nous demandait d’improviser des mouvements à partir de ce que nous ressentions. Cela m’a marquée pour toujours. La primauté aux sensations, aux émotions, à l’humain. Avant la technique.
Vous souvenez-vous de ce jour où, avec 800 petites filles, vous passez le concours pour rentrer à l’école de danse de l’Opéra de Paris ?
Comment l’oublier ! Je me revois à 10 ans dans la cour du palais Garnier faire la queue avec une nuée de petites filles qui attendent avec leurs parents de passer les épreuves. Hélas, ma mère ne connaît rien à rien aux usages et m’a coiffée d’un bandeau alors que les autres filles portent toutes un chignon haut. Pire ! Elles sont toutes en tuniques roses, et moi, en jaune canari. J’ai peur qu’on me punisse. « On a vu arriver une petite fille, très jolie, mais alors, pas du tout dans le moule de l’opéra ! » m’a raconté plus tard Claude Bessy, la directrice de la danse, qui s’en souvenait très bien. Eh bien cela m’a poursuivi. Je n’ai jamais été dans le moule de l’Opéra de Paris. Je me suis toujours sentie atypique.
C’est pourtant une terrible école de rigueur et de discipline que vous intégrez !
En effet, fini l’insouciance ! Un concours détermine chaque année si on passe dans la classe supérieure ou si on est renvoyé. C’est implacable. Alors on travaille, travaille, travaille. La discipline est stricte, on serre les dents quand on se fait mal ou réprimander, on ne répond pas aux professeurs, on fait la révérence quand on croise un adulte dans le couloir. Mais cela ne me déplaît pas. Je me prends au jeu. J’avais connu bien pire à l’école des sœurs où m’avaient mise mes parents, faute de trouver une place à l’école publique – car j’avais un an d’avance. Et puis la magie et le rêve sont à portée de main. Je suis dans le saint des saints. Je ressens toutes les vibrations du théâtre, j’entends les appels de la scène, je me glisse dans les coulisses, je croise les danseurs du corps de ballet, parfois j’aperçois une étoile…
Jamais de révolte ou de découragement ?
Non. Ce n’est pas une vie d’enfant normale, mais c’est le chemin obligatoire pour arriver à ce que je veux faire. Je ne fais pas partie des danseuses qui disent que leur formation était inhumaine. Il va de soi qu’il faut une discipline et une exigence inouïes vis-à-vis de soi-même pour devenir un grand danseur, exactement comme un sportif de haut niveau. Il faut essayer de tendre vers la perfection et se remettre chaque jour à l’ouvrage. Je l’accepte, en pensant aux générations de danseurs qui ont transpiré et donné toute leur énergie dans ce même lieu. Leurs photos sont affichées dans le foyer de l’opéra, elles sont un phare, elles me stimulent. Et puis j’ai la soupape des vacances en Corse, le plaisir d’y retrouver mes vrais amis et l’état sauvage.
Six ans plus tard, toutes les étapes franchies, vous intégrez enfin le corps de ballet.
Oui, j’ai 16 ans, je reçois mon premier salaire, me voilà professionnelle… mais encore ado. C’est fou ! Je me sens soudain très légère, il y a les premières tournées à l’étranger, au Mexique, c’est le début d’une nouvelle aventure. Mais il faut encore faire ses preuves, prouver qu’on est autrement prometteur qu’un enfant un peu doué qui a juste eu de la chance, passer les concours internes qui permettent de grimper dans la hiérarchie du ballet : quadrille, coryphée, sujet, premier danseur… Je découvre la jungle. Il faut s’imposer sa propre discipline, se contraindre à prendre des cours, entretenir la technique et le corps. Le découragement peut être rapide, une sélection naturelle s’opère entre les batailleurs et ceux qui lâchent. Moi je redouble d’efforts. Je travaille comme une forcenée, samedi, dimanche, solitaire. Je sais qu’il n’y a pas d’acquis, je veux jouer les plus grands rôles.
Et vous côtoyez au quotidien Rudolf Noureev, star de la danse, et déjà légende.
Ah, Noureev ! C’est évidemment l’une des figures qui m’a le plus marquée. Il avait une culture chorégraphique stupéfiante. Et il avait fait une synthèse de toutes les écoles, russe, anglaise, française, italienne, américaine, pour révolutionner la manière de danser. Quand il est arrivé à l’opéra, en 1983, il a balayé toutes nos certitudes, et nous a imposé, à nous qui étions si jeunes et qui sommes vraiment la génération Noureev, un sens critique, un nouveau style, une esthétique très particulière qui n’avait rien à voir avec l’esthétique française de nos aînés. Le grand style. Quelle chance d’avoir pu faire ce virage-là ! Je l’observais beaucoup dans les coulisses parce que je voulais voir comment était l’animal. Comment il se présentait sur scène, comment il prenait la lumière, comment il se permettait toutes les folies, toutes les audaces. Brûlant, passionné, torturé, instinctif.
Redoutable !
Ah certes, il n’était pas simple ! Je crois même qu’un tel caractère ne passerait plus de nos jours. Il pouvait hurler des injures, en russe, pour un pied mal placé, lancer à travers le studio tout ce qui lui tombait sous la main sous le coup d’une colère. Il était imprévisible, avec des failles qu’il redoutait qu’on creuse. Pas très à l’aise avec les femmes je crois, presque sur la défensive, même s’il avait cet amour pour Margot Fonteyn avec qui il a croisé sa vie artistique. Je ris, aujourd’hui, à quelques souvenirs loufoques. Mais quelle chance incroyable d’avoir pu travailler plus de six ans avec cet homme visionnaire, d’avoir pu discuter, partir en tournée avec lui en Asie, en Amérique, etc.
Et Béjart ? Autre monstre sacré au regard laser…
Tellement impressionnant ! J’avais dansé une variation de son ballet Bhakti III lors d’un concours qui m’avait permis de passer de quadrille à choryphée. Du coup, il m’a confié le rôle et fait venir répéter chez lui, à Bruxelles, au Ballet du 20ème siècle. Sa compagnie était alors une légende. Elle représentait la modernité absolue, un souffle de liberté avec des danseurs atypiques, des hommes portant les cheveux longs, une nouvelle esthétique. Alors quand j’ai dû danser devant lui et tous ses danseurs alignés, dos à la glace, je peux vous dire que la pression était maximale !
Qu’appréciez-vous chez lui par-dessus tout ?
Un engagement mystique que je ressentais dans son travail et qui m’accompagne au quotidien. Cette idée que la danse est sacrée. Qu’il y a un mystère autour de l’être qui danse et qui s’élève. Qu’il y a dans sa quête quelque chose de spirituel – non pas religieux, je n’ai pas de croyance -, une volonté de s’extraire du monde réel et un désir fou de transcendance. Je retrouve cela aussi chez Carolyn Carlson ou même dans les écrits d’Isadora Duncan.
« On entre au studio comme on entre au temple, à la mosquée, à l’église, à la synagogue, pour se retrouver, se relier, s’unifier », écrit Béjart.
C’est exactement ça. Et c’est ce que j’essaie moi-même d’inculquer aux danseurs dans mes ateliers et master-classes. Nous ne sommes pas que des artistes qui savons bien danser. Il y a quelque chose qui va bien au-delà de ça. Sinon à quoi bon ce travail et cet acharnement à se dépasser ? Il faut que l’esprit s’élève, il faut un supplément d’âme. Il y a une dimension cosmique dans cette histoire. Et puis le spectacle vivant est l’un des derniers lieux de communication intense et mystérieux entre le public et les artistes. Dans les spectacles de Béjart, on entrait tous en communion.
Quand êtes-vous nommée danseuse étoile ?
Un soir de décembre 1990, à l’issue d’une représentation de Don Quichotte dans la version de Noureev. J’avais une déchirure au mollet et je ne savais pas, en entrant sur scène, si je pourrais terminer le ballet. A l’entracte, je me suis massée en me répétant : ça va aller, ça va aller. Et puis à la tombée du rideau, m’avançant au milieu de mes partenaires pour les saluts, j’ai vu Patrick Dupond et le directeur de l’opéra Jean-Albert Cartier entrer en scène et annoncer au public qu’on me nommait danseuse étoile. Quelle émotion ! Mes parents étaient là, eux qui m’avaient tellement portée dans l’aventure et avaient fait beaucoup de sacrifices. C’était le début d’une belle histoire avec Patrick Dupond, qui venait d’arriver à la direction de la danse, mais avait déjà marqué tous les danseurs par sa fougue, son animalité sur scène, sa gentillesse exquise.
Vous évoquez la douleur. Fait-elle vraiment partie du quotidien ? Je vous ai entendu dire : « De toute façon, au sortir du lit, le corps fait toujours mal. » Cela m’a sidérée.
Mais c’est vrai ! Vous ne seriez pas surprise d’entendre la phrase dans la bouche d’un boxeur ou d’un footballeur, alors pourquoi le seriez-vous pour un danseur ? On pousse le corps à l’extrême ! On le soumet à des épreuves insensées, on tire sur les articulations, on multiplie les mouvements anti-naturels ! Etes-vous déjà montée sur des pointes ? La douleur est intégrée dans notre vie. C’est un choix accepté depuis l’enfance, une compagne tout au long de notre chemin d’artiste. Et parfois, il y a une réelle satisfaction à dépasser la souffrance et à la sublimer. C’est le fameux mystère évoqué plus haut. La quête personnelle du danseur, son désir d’absolu… Nous ne sommes pas maso. Si la douleur n’était pas compensée par quelque chose de beaucoup plus grand, il vaudrait mieux arrêter !
Pourquoi quittez-vous prématurément l’opéra, à 35 ans, après avoir dansé tous les grands rôles, Kitri, Carmen, Giselle, la Sylphide, la Bayadère et travaillé aussi avec de grands chorégraphes contemporains ?
C’est vrai qu’il fallait du courage pour partir. L’opéra de Paris est une bulle protectrice, un cocon délicieux. Mais j’ai soudain senti que ma route était ailleurs. « Le temps brûle » comme dirait Aragon. Il faut saisir sa chance. Et j’avais envie de travailler mon propre univers chorégraphique et de créer. J’avais besoin de regarder le monde et de m’exprimer en toute liberté. Et puis je me rendais compte qu’à l’Opéra de Paris, on vous apprend à être des danseurs… de l’Opéra de Paris. Avec une esthétique que j’aime, mais un état d’esprit qui exalte la compétition et la rivalité et m’a toujours indisposée. Je pense que chaque artiste est unique, certainement pas interchangeable.
Partir diriger le Ballet de Marseille voulait dire commander aussi une nouvelle institution et un groupe humain…
Oui. Forcer ma timidité, fendre l’armure, trouver les moyens de me faire comprendre autrement qu’en dansant. Pas facile. Il y a eu beaucoup d’incompréhension et je crois que je n’ai jamais réussi à expliquer qui j’étais et ce dont je rêvais. Ma retenue m’a fait passer pour hautaine, inaccessible ; on m’a trouvée trop exigeante. Je me suis pourtant donnée à fond dans mon travail de création, j’ai bousculé beaucoup de choses. Le public a suivi. Pas la troupe. J’ai cru à tort que mon travail serait le seul élément pris en considération. Et j’ai été confrontée au sexisme. Une femme dirigeant une compagnie ? « Allons, ma petite, qu’est-ce que tu y connais ? » Je suis vite devenue la femme à abattre et j’ai pris de sacrés coups, malhabile et trop peu politique. Ça fait mal. Mais j’assume mes erreurs car je les ai commises en sincérité, et pour ne pas me trahir. Toutes les épreuves nous fortifient.
Vraiment ? Elles ne nous font pas plutôt perdre fraîcheur, idéal, confiance ?
On perd une innocence. On perd l’enfance. Mais il ne faut ni s’enfermer ni s’endurcir. Il faut à tout prix garder la capacité de découvrir et d’apprendre. La vie nous force sans cesse à grandir.
Même confronté au deuil ?
Sans doute. Il fait partie de la vie et du processus pour devenir adulte. J’ai été confrontée à la mort de mon père il y a des années, et c’est toujours aussi douloureux d’en parler. Je le fais très rarement. A son décès, j’avais été très forte parce qu’il fallait soutenir ma maman. Mais un an après, je me suis écroulée… Aujourd’hui, je sais que les gens aimés nous accompagnent en permanence. Je le sens très fortement, même sur scène, surtout sur scène. C’est la magie de cet endroit sacré, presque mystique, dont parle Béjart. Il disait qu’on y ressent des émotions et des accompagnements. Qu’il est même tellement sacré qu’il nous renvoie au fondamental et au tripal. Eh bien quand je monte sur scène, je pense toujours à mon père. Il est présent.
Et cela vous oblige ?
Cela m’oblige à être fidèle à ses valeurs, à sa droiture, et à continuer ma route dans cet art pour lequel je me sens faite. Car j’ai toujours su que j’allais être une femme qui danse. Et « Le théâtre du corps », la compagnie que j’ai créé en 2004 avec Julien Derouault, mon compagnon, me donne désormais une totale liberté pour explorer tous les thèmes qui me passionnent : la vie, la mort, l’engagement, l’éphémère et l’éternité, l’inconscient, le déséquilibre, l’enfermement, le destin… Autrefois, je n’étais pas très intéressée par le monde autour de moi. Aujourd’hui, c’est le contraire. Je brûle de l’observer, le questionner, le bousculer. En artiste militante. Et c’est vertigineux.
Travail en couple ? Lien fusionnel ?
Oui. Un double regard sur la création. Et la sensation d’écrire une partition à quatre mains. C’est un mode de vie, avec des discussions et une ébullition permanentes. L’un a une idée qui accroche l’autre, lequel va renchérir, rebondir, être moteur de l’autre. On se regarde et on s’emballe. On va au bout de notre rêve. S’il n’était les contraintes économiques, l’obligation d’autofinancer la petite structure dans laquelle on fait tout, on créerait beaucoup plus de spectacles par an ! En mêlant tous les arts, en cassant les codes et les barrières. Julien, en ce moment, dit et danse sur scène des textes d’Aragon et de Shakespeare.
Le geste amplifie le mot ?
Bien sûr ! La danse sert le texte. Elle est puissante et peut réveiller l’inconscient. Raviver une histoire inscrite dans notre chair. Car le corps a une mémoire ! Le corps hérite d’une histoire, d’une éducation, d’une famille, d’une culture, d’une géographie, de schémas complexes inscrits par des générations. Et le geste du danseur peut soudain faire rejaillir un souvenir ou une émotion enfouie avec plus de force que n’importe quelle parole. C’est le défi et le miracle de la danse ! Sade disait : « il n’y a pas de corps sans idées ni d’idées sans corps. » Tout cela ne fait qu’un. C’est ce que nous explorons avec jubilation, Julien et moi.
Ce serait finalement intéressant de vieillir ?
Mais oui ! On perçoit souvent cela comme une diminution et un rétrécissement. Moi je trouve que c’est une richesse ! Ce vécu qui nous accompagne et doit être une force. Toutes ces multiples questions qu’on ne se posait pas à 20 ans… J’ai cette chance, c’est vrai, que mon physique me permette encore d’être sur scène, car arrêter serait évidemment douloureux. Mais nos spectacles ouvrent désormais sur tant de champs…
Qu’est-ce qui a donné à la petite fille timide la force d’aller au bout de son rêve ?
Mon père avait affiché sur la cheminée de ma chambre une maxime de Napoléon, gravée sur une souche d’olivier : « quand on veut constamment, fortement, on réussit toujours ». J’ai vu cette phrase tous les jours, pendant des années, sans trop y réfléchir. Je crois cependant qu’elle a fini par m’imprégner.
Elle est galvanisante. Elle peut aussi être écrasante.
La barre est placée haut. Mais les réussites peuvent être de tous ordres. Ce qui est certain, c’est que je n’ai jamais accepté que quelqu’un d’autre décide de ce que je devais faire, ni ne me détourne du chemin que je m’étais fixé.
Propos recueillis par Annick Cojean
· Spectacle « Etre ou Paraître » actuellement au studio Hébertot à Paris, chorégraphie et mise en scène Pietragalla Derouault, textes d’Aragon et Shakespeare, joués et dansés par Julien Derouault.
· Livre : « La femme qui danse » de Marie-Claude Piétragalla et Dominique Simonette (Le Seuil 2008)
Retrouvez tous les entretiens de La Matinale ici