Rémunérations, missions « inutiles »… des CRS font part d’un « malaise profond »
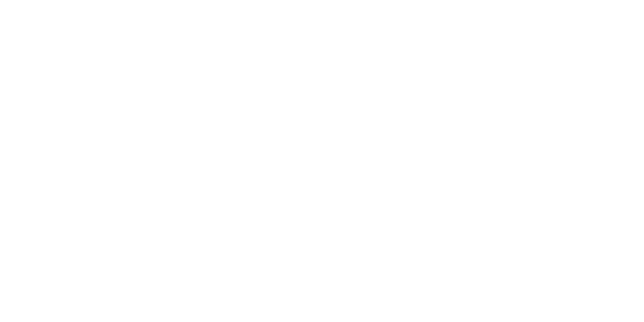
Rémunérations, missions « inutiles »… des CRS font part d’un « malaise profond »
Par Feriel Alouti (envoyée spéciale à Calais, Pas-de-Calais)
La réforme de l’indemnisation journalière d’absence temporaire (IJAT) suscite la colère et l’incompréhension chez les agents de ce corps spécial de la police nationale.
En commençant par le haut à gauche : Didier Sicart, du syndicat Alliance ; Guillaume Boyer, d’UNSA-Police ; Jacques Merinhos et Christian Rouane, tous deux délégués syndicaux Alliance, sur la plage de Calais.
Pour « la première fois », il y a quelques jours, Jacques Merinhos, CRS depuis 2005, a dit à son père à quel point il en avait « marre » de ses conditions de travail. « Prends ton mal en patience », lui a-t-il répondu. Mais après douze ans de service, ce trentenaire, originaire de Toulouse, n’est pas sûr d’y parvenir. « Les attentats ont largement augmenté la charge de travail, constate ce fonctionnaire, également délégué syndical UNSA-Police. Je passe presque la moitié de l’année en déplacement, et les missions sont de plus en plus difficiles. » Alors forcément, dans ces conditions, la réforme de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT) passe mal. « La goutte d’eau… », disent certains, « une agression » et « un manque de reconnaissance » estiment d’autres.
L’IJAT a été créée dans les années 1960 pour compenser la distance, la soixantaine de compagnies républicaines de sécurisation (CRS) cumulant en moyenne 170 jours par an en dehors du domicile. Jusqu’à présent exonérée de l’impôt sur les revenus, cette indemnité, qui s’élève à 39 euros par jour, représente en moyenne 6 300 euros net à l’année. Mais, le gouvernement entend désormais soumettre l’IJAT aux cotisations sociales. Si le ministère de l’intérieur a annoncé sa volonté de compenser cette fiscalité par une augmentation de la prime en 2018, les organisations représentatives des agents – organisées en intersyndicale – veulent qu’il en soit de même en 2019 et 2020. Ils demandent aussi que le délai de versement, qui devrait passer avec la réforme d’une semaine à deux mois, soit raccourci.
Faute d’un droit de grève pour protester, certains avaient décidé de se faire porter pâle le 21 septembre, jour de manifestation contre la réforme du code du travail. Ainsi, Guillaume Boyer, yeux bleus translucides et front large, est allé chez son médecin, parce qu’il estime que « 39 euros pour être loin de chez soi, ce n’est pas un cadeau », mais un « bonus », que ce délégué syndical Alliance réserve aux « loisirs » et aux « imprévus du quotidien ». « Le gouvernement prend l’argent où il est, sans considération », dénonce cet agent, entré dans les CRS en 2000 avec, entre-temps, un passage de trois ans en commissariat.
Egalement originaire de Toulouse, il passe chaque année plus de 150 jours en dehors de chez lui. Pendant ces cinq mois, il mène « une vie assez égoïste », reconnaît-il. Sa femme reste « seule » et « gère tout » pendant que lui « erre en survet’ dans les couloirs » de son hôtel, après avoir fait ses deux heures de sport quotidiennes et terminé sa vacation.
Absurdité de la situation à Calais
Lors de chaque déplacement, les agents passent entre deux et trois semaines dans la même ville. De nuit comme de jour, ils sécurisent des rencontres sportives, certaines cités HLM, interviennent sur les feux de forêt, les inondations, surveillent les marchés de Noël, les grandes surfaces, « partout où il y a du monde », résume Didier Sicart. Depuis les attentats de 2015, les agents sont également formés aux tueries de masse et aux attaques terroristes, afin qu’ils puissent intervenir au plus vite en cas d’attentat.
Depuis quelques années, Guillaume Boyer passe une bonne partie de son temps entre Paris et Calais. Même si « à la base, les missions sont variées », la lutte contre l’immigration clandestine représente désormais « un tiers » de son activité.
A Calais, certains CRS, comme Jacques Merinhos, ont le sentiment désagréable de ne pas « servir à grand-chose » : « On nous demande de bloquer les migrants pour les empêcher de monter dans les camions, mais on n’apporte aucune solution. » « Notre mission est très mal définie et complètement inutile », lance Guillaume Boyer, après y avoir effectué cinq séjours en un an. Photographie à l’appui, l’agent, attablé dans l’hôtel-restaurant où il loge avec les collègues de sa compagnie, veut montrer l’absurdité de la situation. On aperçoit sur le cliché un groupe de migrants en train de jouer au football, près de la rocade menant au port. « Vous voyez, s’ils décident de traverser la route et de poser leur ballon, on va devoir intervenir. Puis, ils vont retourner jouer au ballon et, nous, on va se remettre à côté d’eux », explique-t-il, à la fois las et agacé.
Christian Rouane, 59 ans, et Didier Sicart, 53 ans, délégués syndicaux Alliance, ne partagent pas le même avis : « On rassure la population locale et on sert à quelque chose quand on retire un tronc d’arbre [posé par les migrants sur la rocade pour ralentir la circulation et ainsi se cacher dans les camions] », assure le premier. « Mais c’est vrai qu’on se sent plus utile quand on part sur des inondations », concède le second.
« Une violence plus politique »
Ces dernières années, le contexte terroriste a forcément fait évoluer la mission des CRS, entraînant une charge de travail supplémentaire. « On a l’impression d’être pressés » comme des citrons, peste Guillaume Boyer. Sans parler des missions « ingrates », comme les gardes statiques devant les bâtiments sensibles. « Je ne suis pas entré dans la police pour passer huit heures devant une porte », proteste Jacques Merinhos, tout en reconnaissant être moins sollicité que ses collègues de l’opération Sentinelle.
Autre sujet d’inquiétude, la violence à laquelle ils sont confrontés dans certaines manifestations, notamment celles du printemps 2016 contre la loi travail. « Une violence plus politique », fait remarquer Christian Rouane, qui évoque avec nostalgie cette époque où « on ne portait pas de jambières, seulement un gilet qui protégeait les épaules et un casque ». Rien à voir avec le style « RoboCop » en vigueur aujourd’hui. « Quand il y a un attentat, on est remerciés, applaudis », fait remarquer Jacques Merinhos. « Mais le reste de l’année, on est des gros cons », complète, sourire aux lèvres, Christian Rouane. « C’est à ça que servent mes impôts ? », entendent-ils parfois sur leur passage.
Fuites d’eau et puces de lit
Ces CRS ne manquent pas non plus d’exemples lorsqu’il s’agit de dénoncer leurs conditions matérielles. A commencer par l’état des véhicules, qui affichent parfois « plus de 250 000 km » au compteur. « Pare-brise rayé », « intérieur pourri », « ceintures défectueuses », « alors qu’on y passe notre vie », maugrée M. Boyer. « Comment on fait si on tombe en rade aux Tarterêts [une cité difficile située à Corbeil-Essonnes] ? », s’interroge Christian Rouane, entré il y a trente-cinq ans dans cette « deuxième famille ».
D’autant que les distances parcourues sont parfois très longues. « Quand on part à Paris, explique M. Rouane, basé à Perpignan, il faut partir à 2 heures du matin pour y être à 13 heures, et parfois prendre quand on arrive la vacation de la journée. » Pour Calais, « il a fallu batailler », mais désormais ceux de Perpignan prennent le train. Quant aux conditions de logement, elles sont parfois déplorables, selon des délégués syndicaux. Fuites d’eau et peintures qui s’effritent dans les bâtiments du ministère, où logent parfois les CRS ; puces de lit et gale dans certains hôtels.
Autant de griefs qui expliquent, selon Jacques Merinhos d’UNSA-Police, « le malaise profond » des agents et même les « dépressions » de certains. Alors il prévient : « Si les négociations ne débouchent sur rien, il y aura encore des malades. »







