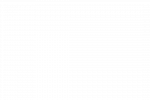Logements HLM : « Si on continue comme ça, il n’y aura plus de mixité »
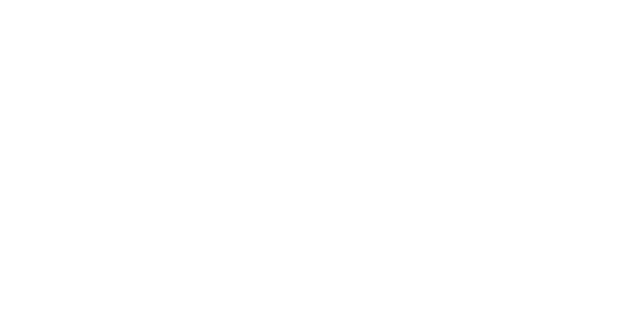
Logements HLM : « Si on continue comme ça, il n’y aura plus de mixité »
Par Feriel Alouti
Le gouvernement s’apprête à écorner l’un des principes fondateurs du logement social, le droit au maintien dans les lieux, une perspective diversement appréciée par les locataires.
Quand, il y a cinquante ans, Daniel a posé ses valises dans ce logement social de la rue Emeriau, dans le 15e arrondissement parisien, il a vraiment « trouvé ça beau ». Certes, « c’était plus cher » que son ancien logis, mais c’était aussi « autre chose », se remémore ce retraité de la SNCF. Il quittait ainsi un appartement sans chauffage, avec les toilettes sur le palier, pour un trois-pièces doté de tout le confort qu’offraient alors les « trente glorieuses » : « Le jour et la nuit », lance l’octogénaire.
Comme Daniel, ils sont des dizaines à avoir investi cette résidence habitation à loyer modéré (HLM) dès 1968, date de sa construction. A l’époque, la zone du Front-de-Seine, située entre les quartiers Javel et Grenelle, faisait l’objet d’une intense rénovation. Les immeubles, considérés comme insalubres, étaient détruits et remplacés par des tours imposantes et de larges artères. De nombreuses familles du quartier ont ainsi été relogées, à deux pas de la tour Eiffel, dans ces logements sociaux gérés par Immobilière 3F, le plus grand bailleur social privé de France.
Aujourd’hui, alors que le gouvernement, pour favoriser l’arrivée de nouveaux locataires dans les HLM, s’apprête à écorner l’un des principes fondateurs du logement social, le droit au maintien dans les lieux – même si le locataire paye un surloyer de solidarité –, les anciens de la résidence évoquent avec nostalgie cette époque où tout le monde venait du « même coin ». Et ils observent, parfois avec réserve, l’arrivée d’un nouveau type de locataires. « Pas le même genre », souffle de son côté Jean-Claude, 78 ans dans quelques jours.
Plus jeunes, plus précaires, parfois issus de l’immigration, ces nouveaux résidents « aux revenus beaucoup plus bas », précise Jean-Claude Driant, professeur à l’Ecole d’urbanisme de Paris et spécialiste de l’habitat social, sont amenés à cohabiter avec des locataires qui « profitent, dans une certaine mesure, d’une rente de situation ». Or le projet de réforme du gouvernement vise justement à stimuler la mobilité des habitants des HLM.
Le taux de rotation des logements est, en effet, extrêmement bas et les personnes de plus de 50 ans sont surreprésentées : 49 %, en 2013, selon l’Union sociale pour l’habitat. Seuls 10 % des résidents HLM déménagent chaque année (seulement 4 % à Paris), contre 31 % dans le parc privé.
« Il faudrait laisser la place ? »
Jean-Claude, croisé au pied de la résidence, « n’envisage absolument pas de partir ». Et même s’il se sait « protégé » – la loi interdit à un bailleur social d’expulser un locataire âgé de plus de 65 ans –, cela ne l’empêche pas de se « méfier » : « Si on continue comme ça, dans quelques années, il n’y aura plus de mixité sociale » mais « que des gens aux revenus très faibles », s’insurge cet ancien employé EDF, qui acquitte chaque mois, comme 17 % de ses voisins, un surloyer. Et d’ajouter : « C’est comme ça qu’on crée des ghettos ! »
Rue Emeriau, seuls 23,19 % des résidents sont éligibles à l’APL, dans un arrondissement qui comptait, en 2016, 17,3 % de logements sociaux, deux points de moins que pour l’ensemble de la capitale (19,7 %).
Face à Jean-Claude, Valérie, 65 ans, entend, elle aussi, cette « petite chanson » selon laquelle « ceux qui vivent dans des HLM sont des privilégiés ». « Parce qu’il y a des plus pauvres, il faudrait laisser la place ? », s’agace cette ancienne assistante de direction.
Valérie était adolescente quand elle a emménagé avec ses grands-parents et ses parents – un père cadre dans l’aérospatial, une mère au foyer – dans cette résidence. Quand son grand-père est mort, elle est allée vivre avec sa grand-mère, puis quand celle-ci est morte à son tour, elle a troqué son trois-pièces contre un deux-pièces. Elle s’est ensuite mariée, et a une nouvelle fois changé d’appartement. « A l’époque, ça se faisait beaucoup. On s’arrangeait entre locataires et avec le bailleur social », se rappelle Valérie.
« Il ne fallait pas me laisser y entrer »
En cinquante ans, mise à part la façade de l’immeuble et le jardin, « peu de choses ont changé », fait-elle remarquer. Alors oui, il y a bien des nouveaux, « issus de l’immigration », mais « ça se passe très bien ».
« C’est même plus sympa car ils sont moins râleurs. Avant, il y avait des gens qui se croyaient un peu au-dessus des autres et qui pestaient dès qu’ils entendaient des enfants jouer en bas. »
Tous les locataires ne font pas preuve d’un tel enthousiasme à l’idée de découvrir de nouvelles têtes. « Il y a des choses qu’on ne voyait jamais avant, comme des sacs-poubelles qui traînent par terre, la saleté dans les ascenseurs. Mais bon, je crois que c’est partout pareil », relève Daniel, pressé de se débarrasser de ses courses.
Claude, arrivée en 1991 par le biais de son entreprise – à l’image de nombreux résidents –, remarque également à quel point « la résidence a changé », tout comme le quartier. Elle évoque ces « gens sales et bruyants » qui ne « saluent personne ». Et cette cohabitation qui peut, parfois, s’avérer difficile. D’autant que bénéficier du « 1 % patronal rien à voir, dit-elle, avec le fait de réclamer un logement social à la mairie parce que l’on ne parvient pas à payer son loyer [dans le parc privé] ».
Locataire d’un trois-pièces de 60 mètres carrés, cette mère célibataire, salariée d’un groupe pharmaceutique, débourse chaque mois 900 euros, dont 176 euros au titre du surloyer. Si elle s’estime « très chanceuse » de bénéficier d’une telle surface pour une telle somme, qui plus est dans un quartier prisé, Claude considère, elle aussi, qu’il est important de « conserver un équilibre » entre les différents profils de locataires : « Ça fait trente ans que je suis là, je ne trouverais pas normal d’être sortie. A ce moment-là, il ne fallait pas me laisser y entrer. »
De la rue à un HLM, en passant par un squat
Fofana fait partie de ces « nouveaux résidents ». Face à un écran plat branché sur la chaîne France 24, elle entame le récit de ses huit années d’« humiliations et de galères ». Tout commence avec le décès de son époux, juste avant la naissance du quatrième enfant. A l’époque, cette auxiliaire de vie habite dans le privé. Incapable d’assumer seule le loyer, elle se retrouve à la rue et échoue dans un premier squat, porte de La Chapelle.
Bien qu’elle y paye uniquement l’eau et l’électricité, elle décide d’emménager dans un hôtel social. Un séjour de « deux ans et huit mois » au cours duquel elle dépensera de quoi « acheter un studio en province ». La chambre coûte une petite fortune : 3 400 euros par mois, dont 1 300 euros à la charge de Fofana. « Il me restait chaque mois 300 euros pour vivre », dit-elle, assise au bord d’un canapé en faux cuir.
Pour tenter de susciter l’intérêt des autorités, elle multiplie les courriers. En tout, « mille cent lettres » rédigées par l’une de ses filles et envoyées à l’ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë. En 2007, première bouffée d’oxygène, Fofana obtient pour dix-huit mois un logement provisoire grâce au dispositif Louez solidaire. Le principe : un propriétaire accepte de proposer son bien à un loyer inférieur au prix du marché.
La libération survient fin 2008 lorsque sa demande de logement social aboutit. Elle quitte alors le « désordre » de l’est parisien pour rejoindre la résidence de la rue Emeriau. Depuis, « c’est que du bonheur. Jamais de problème, jamais de bruit ». De bonnes écoles, des voisins discrets. A son entrée dans ce quatre-pièces, Fofana payait 600 euros par mois, presque dix ans plus tard, elle en débourse 200 de plus, et ne bénéficie plus des APL. Signe qu’elle aussi gagne mieux sa vie, et que la situation des locataires évolue.