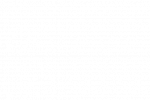Une agriculture 100 % biologique pourrait nourrir la planète en 2050

Une agriculture 100 % biologique pourrait nourrir la planète en 2050
Par Audrey Garric
Selon une étude scientifique, le scénario est possible à condition de réduire le gaspillage alimentaire et de limiter la consommation de protéines animales.
Les bénéfices du bio pour la santé et pour l’environnement sont aujourd’hui prouvés. Mais pour ses contempteurs, ce type de production ne pourrait pas être généralisé, faute de rendements suffisants pour subvenir aux besoins d’une planète à la démographie galopante. Une idée répandue que réfutent des chercheurs européens dans une nouvelle étude publiée par la revue Nature Communications, mardi 14 novembre.
Dans ce travail, le plus abouti sur la question, ils affirment qu’il est possible de nourrir plus de 9 milliards d’êtres humains en 2050 avec 100 % d’agriculture biologique, à deux conditions : réduire le gaspillage alimentaire et limiter la production et la consommation de produits d’origine animale. Et ce, sans hausse de la superficie de terres agricoles et avec des émissions de gaz à effet de serre réduites. Un défi de taille, alors que le bio ne représente que 1 % de la surface agricole utile dans le monde – 6 % en France.
« Un des enjeux cruciaux est aujourd’hui de trouver des solutions pour basculer dans un système alimentaire durable, sans produits chimiques dangereux pour la santé et l’environnement, avance Christian Schader, l’un des coauteurs de l’étude, chercheur à l’Institut de recherche de l’agriculture biologique, situé en Suisse. Or cette transformation inclut une réflexion sur nos habitudes alimentaires et pas seulement sur les modes de production ou sur les rendements. »
L’intensification de l’agriculture, si elle a considérablement accru la quantité de nourriture disponible au cours des dernières décennies, a dans le même temps conduit à des « impacts environnementaux négatifs considérables », rappellent les scientifiques, qui citent la hausse dramatique des émissions de gaz à effet de serre, le déclin de la biodiversité ou encore les pollutions de l’eau et des terres. Or, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la production agricole devra encore augmenter de 50 % d’ici à 2050 pour nourrir une population mondiale de plus de 9 milliards d’humains. De quoi fragiliser encore davantage l’environnement et le climat, et donc la sécurité alimentaire.
Un verger de nectarines bio à Saint-Genis des Fontaines (Pyrénées-Orientales), en juillet 2017. / RAYMOND ROIG / AFP
Comment produire autant mais autrement ? En se basant sur les données de la FAO, les chercheurs, financés par l’institution onusienne, ont modélisé les surfaces agricoles qui seraient nécessaires pour produire le même nombre de calories (2 700 par jour et par personne) en 2050, avec différentes proportions d’agriculture biologique (0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 %), et en tenant compte de plusieurs niveaux d’impact du changement climatique sur les rendements (nul, moyen, élevé).
Première conclusion : convertir la totalité de l’agriculture au biologique nécessiterait la mise en culture de 16 à 33 % de terres en plus dans le monde en 2050 par rapport à la moyenne de 2005-2009 – contre 6 % de plus dans le scénario de référence de la FAO, essentiellement basé sur l’agriculture conventionnelle. Cette conversion des sols serait nécessaire pour compenser les plus faibles rendements du bio. En découlerait une déforestation accrue (+ 8 à 15 %), néfaste pour le climat.
Réduction des impacts environnementaux
Mais dans le même temps, l’option avec 100 % de bio entraînerait une réduction des impacts environnementaux : moins de pollution due aux pesticides et aux engrais de synthèse et une demande en énergies fossiles plus faible. L’un dans l’autre, les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture bio seraient 3 à 7 % inférieures à celles du scénario de référence, « un gain faible », notent les auteurs.
Pour contrebalancer les effets négatifs du tout bio, les chercheurs proposent d’introduire deux changements dans le système alimentaire : réduire le gaspillage alimentaire – aujourd’hui responsable de la perte de 30 % des aliments de la fourche à la fourchette – et limiter la concurrence entre la production de nourriture pour les humains et celle pour le bétail. Aujourd’hui, un tiers des terres cultivables de la planète sont utilisées pour produire l’alimentation des animaux d’élevage (soja, maïs, blé, etc.) alors que ces céréales pourraient nourrir les humains. Un tel changement reviendrait à réduire la quantité de bétail et donc la consommation de produits d’origine animale (viande, poisson, œufs, laitages) qui pourrait être divisée par trois.
« Nous ne promouvons pas le tout bio ou tel ou tel régime alimentaire, prévient Christian Schader. Nous montrons, à travers 162 scénarios, ce qui est possible et à quelles conditions. La direction à prendre est ensuite un choix politique et de société. » « Les auteurs ne peuvent pas être accusés d’être pro-bio, confirme Harold Levrel, professeur à AgroParisTech et chercheur au Centre international de recherche sur l’environnement et le développement, qui n’a pas participé à l’étude. Ils ont choisi des hypothèses très conservatrices, en considérant par exemple que la consommation d’eau est la même en bio et en conventionnel. »
50 % de bio pourraient nourrir les Français en 2050
Pour l’expert, cette approche « multifactorielle et systémique » est « très intéressante », car « c’est la première fois qu’on répond à la question de savoir si le bio peut nourrir le monde en intégrant à la fois la question des rendements, de l’occupation des sols, des effets environnementaux ou encore des émissions de CO2 ».
Un exercice de prospective similaire avait déjà été mené à l’échelle française : le scénario Afterres 2050, publié en 2016 par l’association Solagro, tournée vers la transition énergétique, agricole et alimentaire. Il concluait qu’une agriculture 50 % biologique peut nourrir 72 millions de Français en 2050 sans augmenter la quantité de terres arables, tout en divisant par deux les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’énergie et celle d’eau l’été, et par trois les pesticides.
A deux conditions toutefois – les mêmes que celles de l’étude publiée dans Nature Communications : la diminution des surconsommations et des pertes, ainsi que le changement de régime alimentaire de la population. « Actuellement, nous consommons deux tiers de protéines animales pour un tiers de protéines végétales. Il faudrait faire l’inverse, c’est-à-dire diviser par deux notre consommation de produits animaux. Un changement déjà engagé chez les consommateurs de bio », détaille Philippe Pointereau, l’un des coauteurs, qui dirige le pôle agroécologie de Solagro.
« Une agriculture 100 % bio est également possible mais on ne l’a pas présentée pour ne pas rebuter les gens », glisse l’expert. Un optimisme que partage Harold Levrel : « La baisse des rendements entraînée par le bio, de 25 % en moyenne, n’est pas rédhibitoire. On peut récupérer des terres, notamment dans les 100 000 hectares qui se transforment chaque année en friches. »
Une révolution, mais à quel prix ?
Ces modèles présentent toutefois une limite : le manque d’azote. A l’inverse du système actuel, dans lequel les excès de nitrates dus aux engrais de synthèse polluent l’environnement, le scénario de 100 % bio engendre un déficit en azote, pourtant indispensable à la fertilisation des cultures. Des solutions existent, comme semer des légumineuses qui fixent l’azote de l’air ou encore maintenir des sols couverts, mais elles sont encore insuffisantes.
Reste une dernière interrogation, qui n’est pas abordée par l’étude : la faisabilité économique d’une telle révolution. Dans un monde 100 % bio, les agriculteurs seraient-ils autant rétribués qu’aujourd’hui – la concurrence entraînant une baisse des prix ? Les consommateurs pourraient-ils se payer cette alimentation actuellement plus chère ? « L’agriculture reçoit beaucoup de subventions publiques. Il paraît logique que cet argent aille vers une agriculture et une alimentation durables pour minimiser les coûts externes comme la pollution de l’eau ou les impacts sur la santé publique, juge Philippe Pointereau. Pour les consommateurs, le prix de l’alimentation peut coûter un peu plus cher même en consommant moins de viande et de produits laitiers. Mais, compte tenu des bénéfices, peut-être investiront-ils plus dans leur alimentation. »