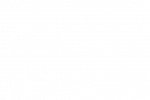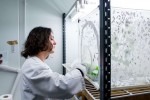Le ressort brisé de l’économie britannique

Le ressort brisé de l’économie britannique
LE MONDE ECONOMIE
La croissance britannique sera inférieure à 1,5 % jusqu’en 2021. Outre le Brexit, l’économie pâtit d’un sérieux problème de productivité.
Le chancelier de l’Echiquier britannique, Philip Hammond, pose pour les médias devant sa résidence officielle du 11 Downing Street, muni de la traditionnelle mallette rouge contenant son discours sur le budget, à Londres, le 22 novembre. / Frank Augstein / AP
Il y a quelque chose de cassé dans l’économie britannique. Et ce n’est pas vraiment lié au Brexit… Mercredi 22 novembre, le chancelier de l’Echiquier, Philip Hammond, a été obligé d’avaler une pilule amère en présentant son budget pour l’année 2018-2019 (l’année fiscale commence en avril). Les projections officielles prévoient désormais que la croissance ne dépassera pas 1,5 % par an jusqu’en 2021. Après 1,5 % cette année, elle doit reculer à 1,4 % l’année prochaine et à 1,3 % en 2019 et 2020, avant de remonter légèrement.
Si ces prévisions se concrétisaient, il s’agirait de la période économique la plus molle du Royaume-Uni depuis la crise financière de 2008. Et ce, tandis que le reste de l’économie mondiale connaît une période florissante.
Bien sûr, le Brexit n’aide pas. Le référendum du 23 juin 2016 a provoqué une forte dévaluation de la livre sterling, générant de l’inflation et réduisant d’autant le pouvoir des ménages. Dans le même temps, de nombreuses grandes entreprises ont suspendu leurs projets d’investissement.
Mais le vrai problème se situe ailleurs. « Malheureusement, notre productivité continue à décevoir », résume M. Hammond. Depuis quelques années, les économistes constatent, sans vraiment la comprendre, une étrange baisse de la productivité britannique. Celle-ci est historiquement faible, mais depuis 2008 elle a décroché. Aujourd’hui, un travailleur britannique est 20 % moins productif qu’en France et 14 % moins que dans la moyenne des pays du G7, les sept Etats les plus industrialisés de la planète.
Emplois précaires et mal payés
Le sujet est essentiel parce que la croissance économique provient principalement de deux leviers : soit il y a une augmentation du nombre de travailleurs (ou du nombre d’heures travaillées), soit il y a une hausse de la production par personne. Depuis une décennie, une part majeure de la croissance britannique est venue du premier facteur. En effet, la forte immigration issue de l’Union européenne a rempli les emplois du pays, et une fraction de la population britannique, qui était sortie du marché du travail, y est revenue. Le phénomène est purement quantitatif : le produit intérieur brut (PIB) progresse parce qu’il y a plus de gens au travail. La productivité, elle, stagne. Elle est aujourd’hui au même niveau qu’en 2007.
Juste après la crise, ce phénomène n’était pas nécessairement une mauvaise chose. Alors que la récession de 2008-2009 a été brutale, le chômage n’a pas explosé, atteignant un pic de seulement 8 %. Plutôt que de licencier, les employeurs ont réduit les salaires et développé le temps partiel. Concomitamment, le nombre d’autoentrepreneurs a augmenté de manière sensible. Autrement dit, les Britanniques ont conservé un emploi, même si celui-ci était précaire et mal payé. Mathématiquement, le phénomène a fait baisser la productivité, mais il a évité une crise sociale trop aiguë.
Aujourd’hui, cette logique touche à sa fin. Avec 4,3 % de chômage, le Royaume-Uni est presque en situation de plein-emploi. « Désormais, la seule façon d’avoir de la croissance est d’augmenter la productivité », souligne Vicky Pryce, économiste au Centre for Economics and Business Research. C’est la solution pour que les salaires augmentent enfin, après une décennie de stagnation.
Malheureusement pour les Britanniques, cela ne semble pas se profiler. Longtemps, l’Office for Budget Responsibility (OBR), un organisme semi-indépendant chargé de réaliser les prévisions économiques de l’Etat, a parié sur une reprise de la productivité. Année après année, ses projections se sont révélées fausses. Mercredi, il a décidé d’en tirer les conséquences, reconnaissant que la productivité n’allait sans doute pas retrouver son rythme de croissance d’autrefois. C’est ce constat qui explique que les prévisions de croissance soient revues à la baisse.
Si les économistes peinent à l’expliquer, ils savent en revanche dater la chute de la productivité britannique : avant 2007, celle-ci augmentait d’environ 2 % par an ; depuis la crise, elle ne progresse plus.
« La principale explication est que les entreprises demeurent extrêmement réticentes à investir », souligne Mme Pryce, qui était chargée des questions de productivité quand elle codirigeait le service économique du gouvernement, jusqu’en 2010.
Coupes dans les investissements
Les statistiques lui donnent raison. Au cours de la décennie qui a précédé la crise, les investissements augmentaient en moyenne de 2 % par an. Depuis 2010, le rythme est passé à 0,8 % par an.
Pourquoi ? Mme Pryce estime qu’il s’agit notamment d’une conséquence de l’austérité, qui a débuté en 2010. Pour réduire le déficit, le gouvernement britannique a coupé dans ce qu’il y avait de plus simple : les dépenses d’investissement. En repoussant la construction de nouvelles voies de chemin de fer ou d’universités, le Royaume-Uni a sapé progressivement une partie de son économie.
Une autre explication est technologique. Les emplois de la nouvelle économie ne sont pas nécessairement très productifs. Un chauffeur d’Uber ou un coursier de Deliveroo fournissent un service à faible valeur ajoutée. La fragilité du système de formation professionnelle du Royaume-Uni est aussi régulièrement évoquée.
Conscient du problème, le gouvernement de Theresa May tente de relancer quelques grands projets. « La clé pour augmenter les salaires des travailleurs britanniques est d’augmenter les investissements, publics et privés », estime M. Hammond. Il a créé un fonds d’investissement national pour la productivité, qui va dépenser près de 8 milliards d’euros par an quand il atteindra son rythme de croisière, dans trois ans. Le chancelier de l’Echiquier cite des projets de routes, de voies ferrées, de transports publics… Mais il le sait : réparer une décennie sans investissement prendra du temps.