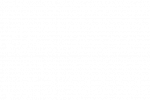« Macron, les femmes et l’Afrique : un discours de sélection sexuelle et de triage colonial »

« Macron, les femmes et l’Afrique : un discours de sélection sexuelle et de triage colonial »
Par Elsa Dorlin
La philosophe Elsa Dorlin répond au président français sur sa rhétorique « féministe », qu’elle estime douteuse, et sur ses préjugés sur la surnatalité du continent.
Les propos sur la natalité en Afrique tenus par Emmanuel Macron lors du sommet du G20 à Hambourg, le 8 juillet, ont été quasi unanimement qualifiés de racistes. Le président français s’est-il ressaisi au Burkina Faso le 28 novembre ? Non, il a sciemment abordé de nouveau le sujet, sous une autre forme, et il s’agit ici de comprendre pourquoi ; pourquoi aurait-il été trop coûteux de renoncer à parler des « femmes africaines », qui ne sont qu’un butin rhétorique cher à la politique française ?
Les termes utilisés à Hambourg par le chef d’Etat pour appréhender cette question étaient marqués d’un passé impérial qui continue d’imposer l’ordre du discours sur « l’Afrique ». En parlant de « défi civilisationnel », Emmanuel Macron comprenait les enjeux de la « transition démographique » et, en la matière, il rendait hommage à l’un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, qui, dans l’amphithéâtre de la prestigieuse université Cheikh Anta Diop de Dakar, s’était senti totalement légitime d’expliquer à « l’homme africain » comment s’extraire du temps cyclique de la nature, où il n’y a pas de place ne serait-ce que pour « l’idée du progrès ».
Devant ses homologues, ce jour de juillet, Emmanuel Macron déclarait : « Quand des pays ont encore sept à huit enfants par femme, vous pouvez décider de dépenser des milliards d’euros, vous ne stabiliserez rien ». Les femmes, donc ; cette fois, ce sont les femmes africaines qui sont visées, comme leur enlisement dans le temps cyclique de la reproduction sans limite ; ces ingrates Africaines à la sexualité débridée et irresponsable, assimilées, en somme, à des femelles n’ayant aucune conscience des investissements consentis – la dite « aide au développement » – pour qu’elles arrêtent enfin de lester ce continent d’enfants qui en diffèrent l’entrée dans l’Histoire.
Ce « vous pouvez décider de dépenser des milliards », c’est en fait un « nous » (nous, les pays riches qui supportons ce fardeau de l’aide et de la philanthropie paternaliste), c’est l’argent de la France et du monde (puisque l’Afrique n’en est pas, de ce monde, elle qui n’a d’autre destin que de constituer le souci majeur de son avenir, le boulet du développement, l’en dehors de la civilisation).
« La force noire »
On aura beau rappeler, sources, archives et études à l’appui, qu’il s’agit là d’un des lieux communs les plus éculés de la gestion coloniale des populations et que la France a constamment activé dans son propre intérêt ce mythe de la surpopulation des territoires colonisés, rien n’y fait. Pourtant, depuis la période esclavagiste, la gestion du cheptel humain s’est matérialisée dans diverses technologies politiques qui ont savamment entravé ou, au contraire, encouragé sa reproduction selon les cours, les flux et les circuits de la traite. Puis, après l’abolition de l’esclavage, la rationalisation de la manne économique d’un lumpenprolétariat racialisé a contraint les ex-colonisés à des conditions « contractuelles » de travail inhumaines, à une division raciale du travail assignant les uns à la terre et à sa rentabilisation avant que les grandes réformes économiques liées à la transformation de certains territoires en parcs à touristes en décident autrement.
Manne économique, mais aussi manne militaire historique : quand, au début du XXe siècle, les plus grands généraux français se targuent de posséder face à l’Allemagne une botte secrète, une arme infaillible, il s’agit de « la force noire », à savoir ces millions de sujets de l’Empire mobilisables à l’envi. Enfin, n’oublions pas que ces corps et ces vies sans valeur, exploitables ou tuables à l’infini, ont permis de constituer des laboratoires d’expérimentation pour toutes sortes de traitements : vaccins, médicaments… mais aussi techniques contraceptives, ce dont témoignent les premiers essais cliniques de traitements hormonaux ou les opérations de stérilisation forcée.
Le paradoxe est que cette gestion coloniale des populations se décline en différentes techniques de stérilisation sociale qui reposent toutes sur un postulat : il faut que la natalité des indigènes, des colonisés et aujourd’hui des « Africains » continue d’être galopante, précisément parce que cela permet d’user et d’amputer ces vies (au travail, sur le front, devant la maladie ou la mort…), comme si elles étaient indéfiniment remplaçables.
Faire le sale boulot
Aujourd’hui, c’est encore ce préjugé de la surnatalité, conséquence des politiques d’appauvrissement du continent africain (comme de ses relais autoritaires locaux) et de sa mise sous tutelle monétaire, économique et frontalière, qui active ici ce sentiment d’indifférence face à ces corps abandonnés, parqués sans chaussures, sans toilettes, sans nourriture en Europe, échoués en Méditerranée, face à ces esclaves torturés dans des zones de trafic, à ces corps affamés sur des zones de conflits où seules les ressources minières, fossiles ou les découpages géostratégiques émeuvent. Il ne s’agit que de vie de chiens issus de portées en surnombre et qu’on élimine.
Si certaines femmes ont été stérilisées de force – comme le rappelle Françoise Vergès dans Le Ventre des femmes –, cela signifie aussi que les politiques ont toujours pensé de façon globale cette gestion de la natalité : quand les territoires des DOM-TOM devaient cesser de se reproduire, d’autres territoires d’influence étaient ponctionnés sans limite sans jamais que l’on ait à s’inquiéter de l’épuisement de la ressource. Or, au cœur de ce régime, entre mythe de la surnatalité et technologies de stérilisation, les politiques démographiques ont aussi consisté à contraindre à la migration.
Cette migration-déportation a eu et continue d’avoir des objectifs politiques tout à fait réfléchis : extorquer des ressources humaines, intellectuelles et culturelles, créant par des politiques universitaires et des privilèges de circulation des ponctions dans la jeunesse et les élites ; prétendre le faire au nom des valeurs et de la qualité supérieure des systèmes éducatifs comme des mœurs métropolitaines, alors qu’il s’agit dans ces mêmes néo-métropoles d’aller faire le sale boulot (usines, mines et ports, puis vigiles et gardiens, petites mains dans les intérieurs bourgeois, garde d’enfants, de malades, de vieux, aides-soignantes ou infirmières).
Quoi qu’il en soit, à couleur de peau différente, les mêmes diplômes n’ont pas la même dignité. Organiser une gestion indirecte de la démographie par la migration a historiquement eu pour caractéristique de cibler la migration des femmes dans le but de résorber la surnatalité, mais aussi d’alimenter la mythologie d’une République française égalitaire et attentive à l’éducation comme à l’émancipation des filles : de fait, il s’agit d’une rhétorique féministe qui s’inscrit dans la pure tradition des grands discours impérialistes du XIXe siècle sur l’émancipation des femmes.
Chevalier blanc ?
Alors, en ce 28 novembre à l’université de Ouagadougou, Emmanuel Macron a-t-il pris quelques précautions ? Certes, il n’a pas parlé de la sexualité irresponsable des femmes et de leur progéniture surnuméraire, mais il a repris par la bande ses propos sur les « sept, huit, neuf enfants par femme ». Il a toutefois été beaucoup plus fin, plus au fait des subtilités historiques des politiques dans lesquelles il se tient comme un héritier. Emmanuel Macron n’a pas « de leçons à donner », et, pour nous en convaincre, il ne va effectivement pas donner de leçons à « l’Afrique » quant à l’irresponsabilité de ses femmes ; au contraire, il va défendre ces femmes africaines : les sept, huit ou neuf enfants par femme, êtes-vous sûrs, vous, hommes africains, que c’est le choix de vos femmes ?
Emmanuel Macron a donné le ton : son discours sera féministe, ou plutôt « fémocolonialiste », parce que, dans la défense du choix des femmes africaines quant à leurs droits et choix reproductifs, le président français se place en chevalier blanc. Evoquant l’octroi de bourses d’études par les consulats français, il déclare que ces bourses seront en priorité offertes à des jeunes filles. A ce moment de son discours, la salle se manifeste. L’image est saisissante : Emmanuel Macron laisse cette rumeur quelques secondes lui répondre, il en profite pour boire une gorgée d’eau, il sourit d’un air entendu parce que l’effet rhétorique qui vient est désormais sûr de faire mouche :
« N’ayez pas peur, je n’ai pas dit qu’il n’y en aura que pour les jeunes filles, j’entendais cette mâle réaction visant à protester. Mais je vous le dis avec la même franchise, je regarde avec inquiétude, parfois dans certains quartiers de mon propre pays, la déscolarisation des jeunes filles progresser, et je le vois dans certains pays africains. Si l’Afrique veut réussir, et la France avec elle, ce grand basculement du monde, nous devons former et éduquer tout le monde, et nous devons éduquer les jeunes filles, nous devons avoir des jeunes filles et des femmes libres, libres de choisir. Et je le dis pour vous, jeunes hommes qui êtes là, c’est bon pour vous. »
Dans ce discours, il y a quelque chose de particulièrement écœurant. Sous couvert d’un engagement qui emprunte au féminisme son lexique, il n’est question que d’une forme actualisée de triage colonial : à la surnatalité prétendue des femmes africaines, l’Etat français propose, comme il l’a toujours fait, la migration prétendument éducative et diplômante.
Or, si cela relève clairement d’une action positive ou, plus exactement, d’une biopolitique par définition sélective, le seul et unique effet visé est précisément de stigmatiser les hommes du continent africain pour leur patriarcat d’un autre temps, eux qui ne laissent pas choisir leurs femmes. En plus d’ignorer les mouvements féministes et d’émancipation africains – dans la ville même où fut assassiné Thomas Sankara –, il s’agit de faire des femmes africaines des complices de ce nouvel impérialisme si elles acceptent la façon dont, pour l’Etat français, il convient qu’elles se libèrent.
Humilité de façade
En la matière, cela relève aussi d’un double discours : la situation des femmes en France qu’évoque Emmanuel Macron et les phénomènes de déscolarisation des jeunes filles pour raisons de maternité ne relèvent pas d’un phénomène social ni même d’une tendance sociologiquement observable. Il le sait, il surjoue l’empathie : nous aussi nous aurions connu ce phénomène, aujourd’hui devenu exception historique, pour mieux insister sur l’ampleur supposée du dit phénomène africain qui ne peut relever que d’un trait anthropologique.
A l’opposé de cet impérialisme soft, ce que l’on peut rétorquer à Emmanuel Macron, c’est que dans son pays, la présence des jeunes femmes à scolarité comparable se raréfie sérieusement aux portes des grandes écoles ou dans les recrutements à des postes et concours à haute valeur sociale ajoutée. Cela a un nom : le sexisme institutionnel. Celui-ci a la dent dure et fait tache quand on prétend porter l’étendard de la liberté des femmes.
Le président a-t-il proposé des quotas en France pour lutter contre le plafond de verre ? Non. Ce qu’il fait alors qu’il pérore en Afrique avec une humilité de façade relève d’une instrumentalisation pure et simple du féminisme dans le cadre d’une stratégie française en Afrique déjà largement engagée par ses prédécesseurs et modelée sur les croisades de libération des femmes « d’ailleurs », menées par nombre de ses homologues occidentaux. Ce qui n’est pas acceptable en Afrique, comme le dit si bien Macron, c’est que des chefs d’Etat puissent, en riant, venir choisir qui aura le droit de venir bénéficier des lumières de la France et qui sera puni à rester aux portes de la « civilisation ».
Ici, la promotion des femmes africaines, forme de sélection genrée, n’est qu’un autre moyen d’ériger des frontières de race et de creuser des lignes de couleur. Quant au libre choix des femmes – là-bas, ici, ailleurs, partout –, ce n’est certainement pas à un homme d’Etat d’en décider. Idéalement, il peut œuvrer pour que des politiques publiques assurent les conditions matérielles de ce libre choix, a minima il peut se taire et, surtout, nous épargner ce « fémocolonialisme », terreau du racisme comme de l’antiféminisme, qu’il faut abattre urgemment.
Elsa Dorlin est professeure de philosophie au département de science politique de l’université Paris 8. Elle vient de publier Se défendre. Une philosophie de la violence, Paris, Zones, 2017.