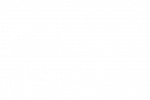Cecilia Bartoli : « Quand j’écoute Bach ou Mozart, Dieu existe, c’est clair ! »

Cecilia Bartoli : « Quand j’écoute Bach ou Mozart, Dieu existe, c’est clair ! »
Propos recueillis par Annick Cojean
L’une des plus grandes stars de l’art lyrique est de passage à Paris pour un concert à la Philharmonie et la sortie de son nouveau disque. La mezzo-soprano italienne s’est confiée à « La Matinale du Monde ».
Je ne serais pas arrivée là si…
… Si maman n’avait pas eu l’idée lumineuse de m’inviter à faire des vocalises, un dimanche après-midi où il pleuvait tristement sur Rome. J’étais très jeune, peut-être 13 ou 14 ans, et elle a présenté cela comme un jeu. « Allez viens Cecilia, on va essayer un truc marrant ! » J’ai dit : « Non non, je n’ai pas envie ! » Mais elle s’est mise joyeusement au piano : « Viens donc ! Juste pour rigoler ! » J’ai traîné les pieds : « C’est votre boulot, à toi et à papa ; mais ce ne sera pas le mien. » Elle a ri : « Allez, viens à côté de moi ! Tu n’as rien d’autre à faire. Il pleut, tu ne vas pas sortir avec tes copines, alors amusons-nous toutes les deux. »
Et voilà ! Elle a réussi à m’attirer à son piano. A me faire essayer une note, puis une autre, puis une autre. Je ne serais donc pas arrivée là… s’il avait fait beau ce dimanche-là.
Votre maman aurait attendu l’hiver. Car elle savait très bien ce qu’elle faisait !
C’est vrai. Elle a rusé ! Avec une intelligence et une habileté redoutables. Il était clair depuis le début que j’avais de l’oreille. Mais elle était désormais convaincue que j’avais aussi une voix. Restait à me la faire découvrir. Sans me braquer ! Car je ne rêvais nullement de faire de l’art lyrique. Et mes deux parents, tous les deux chanteurs d’opéra, respectaient trop la personnalité de leurs trois enfants pour leur imposer quoi que ce soit. Tout juste nous avaient-ils incités, très jeunes, à étudier chacun un instrument.
Moi, j’avais choisi la trompette, avant de prendre des cours de piano. Et puis voilà que j’ai eu un coup de foudre pour le flamenco. J’ai même rêvé de devenir une grande danseuse. Vous voyez, l’avenir n’était pas dessiné ! J’étais comme le Chérubin des Noces de Figaro qui papillonne et tournoie, attiré par mille choses.
Mais la musique avait imprégné votre enfance.
C’était mon univers. J’ai grandi avec ça. A 4 ans, je jouais dans les décors d’Aïda pendant que mes parents chantaient un peu plus loin sur la scène. Il y avait des pyramides en polystyrène, des palmiers en carton et de vrais éléphants. Tout me paraissait fantastique. A 6 ans, j’avais déjà vu plusieurs spectacles magnifiques. Et à 8 ans, j’avais même joué un petit rôle de berger dans Tosca.
L’opéra était partout dans ma vie puisque mes parents répétaient à la maison, se donnaient la réplique, se corrigeaient mutuellement. C’était leur truc, je le tenais pour acquis, mais ça ne m’empêchait pas, moi, de m’intéresser aux chanteurs pop et rock. Mon frère aîné adorait la chanteuse Rita Pavone, et on chantait ses chansons toute la journée. Et puis il y avait les Pink Floyd, les Rolling Stones…
C’est là que maman a joué finement. Un petit exercice par-ci, un autre par-là. Jamais trop longtemps. Juste de quoi m’intriguer et me mettre au défi. Mine de rien. Quand elle voyait que j’avais accroché, elle refermait le piano : « Fini ! On continuera demain si tu en as envie ! » Si bien que c’était moi, le lendemain, qui disais : « Maman, quand tu rentreras du travail, on pourra faire dix minutes de chant ? » Et, de jeux en exercices, les dix minutes sont devenues un quart d’heure, une demi-heure, une heure…
Vous mordiez à l’hameçon ?
J’ai surtout commencé à entendre ma voix. Et j’ai été sidérée de ce qui sortait de ma gorge. C’était si proche de mon âme que j’en étais bouleversée. « Ben dis donc… Je ne me savais pas capable de produire un son pareil ! » Maman ne disait presque plus rien, mais elle poussait un peu plus loin les exercices. La leçon devenait quotidienne, le travail méthodique. Je me suis cramponnée et j’ai vite progressé. Je suis entrée au conservatoire Santa Cecilia de Rome. Mais c’est avec ma mère que j’ai continué à travailler toute la technique vocale.
Votre destin tout entier tenait donc dans cette voix…
La voix humaine ne cesse de me fasciner. Comment de simples petites cordes qui vibrent en faisant « pitipitipitipiti » parviennent-elles à exprimer l’âme mieux que n’importe quel autre instrument ? Par quel mystère le chant peut-il troubler, émouvoir un autre être humain ? Que dis-je ? Un autre être vivant, puisque même les animaux sont touchés par un chant. Comment expliquer cette puissance qui se double d’une immense fragilité ?
Qu’est-ce, pour vous, une belle voix ?
C’est une voix capable de faire éprouver des émotions. Au-delà des notes.
Et au-delà même de ce que pouvait rêver le compositeur ?
Comment le savoir ? La plus grande partie des compositeurs qu’on chante aujourd’hui ont vécu au XVIIIe ou au XIXe siècle. Et tant de facteurs interviennent ! Parfois, c’est l’alchimie très particulière entre le soliste et l’orchestre. Parfois, c’est la ferveur singulière d’un public. Mais quand survient le moment de grâce, l’instant sacré, c’est prodigieux. Le temps est suspendu. Comme le souffle du public. On est tous transportés. Et c’est encore plus perceptible entre deux mouvements de musique, dans ce qu’on appelle la « pause musicale ». Public, chanteurs et musiciens sont à l’unisson. Oui, on est tous dans un état de grâce.
Et que permet-il ?
Il permet de dire que Dieu existe.
Vous le pensez ?
J’en suis sûre ! Quand j’écoute la musique de Bach, la musique de Mozart, Dieu existe, c’est très clair.
Parce que cette musique n’est pas « humaine » ?
En effet. Elle est d’une autre dimension. Elle dépasse l’être humain. De même que, derrière une peinture de Caravage, il y a forcément une intervention divine…
L’opéra aurait donc une valeur sacrée ?
Mais oui ! L’opéra est lié à la spiritualité. Réfléchissez : on y va comme à l’église, pour partager, dans un même lieu, une expérience singulière. Et ce n’est pas par passion de l’histoire qui nous est contée. On la connaît par cœur ! Il n’y a aucun suspense, si ce n’est celui touchant à l’interprétation de la musique. Et pourtant, on pleure en entendant La Traviata. On pleure quand Violetta se meurt, et même avant. Et Norma ! Mon dieu ! On pleure tout le temps avec Norma, alors qu’on en connaît l’intrigue, le drame, jusqu’à la moindre phrase. Chaque fois, Norma secoue, bouleverse, fait accéder à une gamme d’émotions les plus intimes qui soient.
Ce sont ces moments-là que vous chérissez ?
Moi, j’essaie d’être le personnage. Je ne joue pas. Je suis. Et cela veut dire jouir, souffrir, vivre intensément les passions et les tourments de la condition humaine. C’est une chance, pour une cantatrice, que de pouvoir ainsi vivre de nombreuses vies. D’expérimenter la fragilité de l’être, les subtilités de l’âme. J’ai l’impression d’une naissance chaque fois que j’interprète un rôle.
Deviendrait-on meilleure chanteuse en mûrissant ?
J’en suis certaine. On a personnellement été confronté à davantage d’émotions. On peut donc aller plus loin dans la vérité des sentiments humains. Et puis on connaît mieux son instrument, son élasticité, sa force et aussi ses limites. Cela ne s’est pas fait en un jour. Il a fallu beaucoup travailler, apprendre la technique, garante de longévité. Je chante depuis trente ans. On se connaît donc bien, ma voix et moi ! A cela se greffe l’expérience d’avoir travaillé avec Karajan, Barenboïm, Harnoncourt, Abbado, Muti… C’est ça qui fait la différence !
Justement, y a-t-il eu une rencontre déterminante au début de votre carrière ?
Oui. Barenboïm. Fondamentale. C’est même une belle histoire. Figurez-vous qu’en 1987 – j’avais 21 ans –, j’ai été invitée à remplacer au pied levé une artiste qui devait chanter à l’Opéra Garnier dans une soirée d’hommage à Maria Callas. Le gala était diffusé en direct à la télévision française et présenté par Eve Ruggieri. J’avais un trac fou et j’ai chanté le rondo de La Cenerentola sous la direction de Georges Prêtre. Or Barenboïm était à Paris et répétait à la Salle Pleyel. Lorsqu’il est rentré chez lui, ce soir-là, sa femme, Elena, l’a appelé devant l’écran de sa télé. Il n’en avait aucune envie, pressé de dîner et de se reposer. Mais elle a insisté. Et le lendemain, il me cherchait partout ! J’ai auditionné pour lui, et c’est grâce à lui que j’ai commencé à étudier et chanter Mozart.
Et Karajan ?
Ah, lui aussi était devant sa télé ! Ce monde est tout petit, vous savez, et quand une jeune artiste apparaît, telle une étoile filante, elle est tout de suite dans les radars. Karajan a donc appelé Barenboïm pour savoir ce que je valais quand il a appris qu’il m’avait entendue in vivo. Et je me suis rendue à Salzbourg pour une audition avec le Maestro dans la grande salle du Festspielhaus. Quel trac à nouveau ! La scène était immense, la salle plongée dans le noir, et Karajan invisible. Mais sa voix a surgi d’un micro, dans un italien déformé par un fort accent allemand : « Alors, mademoiselle Bartoli, qu’allez-vous me chanter ? » Oh my God !
Qu’éprouviez-vous alors ? Terreur ? Griserie ?
L’inconscience de la jeunesse, la fraîcheur, la sincérité vous poussent à faire des choses et escalader des montagnes que vous croyiez infranchissables. J’étais terrifiée, mais heureuse. A ma place. Soucieuse de bien faire, d’apprendre, de progresser.
On vous dit perfectionniste. Et vous avez la réputation d’être la dernière à quitter les répétitions et de fermer le théâtre avec le gardien.
C’est vrai ! Je suis très travailleuse. Exigeante. Je sais la nécessité d’une discipline vocale intransigeante. Et je veux toujours aller jusqu’au bout des répétitions.
Quelle vie cela donne-t-il ?
Pas du tout une vie facile. Au départ, il y a une voix, certes. Mais la médaille a son revers. Il faut aussi avoir le caractère. Et la discipline. Il faut avoir la force. Et le nerf. S’il suffisait de chanter… Mais être cantatrice, ce n’est pas seulement chanter, c’est affronter, chaque fois qu’on est sur scène, deux mille personnes pleines d’attentes. Il faut tenir psychologiquement. Disposer d’une sacrée force intérieure.
D’où vient la vôtre ?
Franchement ? De mes racines italiennes. Et de ma grand-mère Silvana, qui habitait une ferme à 11 km de Parme et travaillait la terre. Je viens d’une famille simple, qui a connu la guerre et un grand dénuement. Mais dont les femmes ont un tempérament très fort. Il se peut que cette force soit génétique.
Vous avez dit un jour que votre philosophie était résumée dans un très bel air de Haendel : « Lascia la spina, cogli la rosa » (« Laisse l’épine, cueille la rose »).
Oui ! Je fais ce choix. Car la tristesse affleure souvent. Et de plus en plus avec l’âge. On a des souvenirs qu’on essaie de retenir. De moments heureux, d’êtres disparus… Mais dans les moments de tristesse absolue, nous, les musiciens, pouvons toujours nous en sortir avec la musique. Elle nous embrasse. Elle nous dit qu’on peut, qu’on doit continuer à vivre. C’est un grand baume. Pour tous les êtres humains. Les animaux sont aussi d’une grande aide. Ils captent nos émotions comme personne. Ils me fascinent.
Etes-vous sensible à ce déferlement de paroles de femmes qui, dans tous les domaines, y compris ceux de l’art, dénoncent violence, harcèlement et domination masculins ?
Bien sûr ! Je n’ai pas vécu personnellement de mauvais traitements. L’art lyrique me paraît assez préservé. Mais regardez les orchestres ! C’est impressionnant de voir à quel point ils sont encore composés en très grande majorité d’hommes. Y compris les plus connus, comme l’Orchestre philharmonique de Vienne. Le recrutement est essentiellement masculin, parce que, vous comprenez, les femmes sont plus fragiles, les femmes ont des enfants, bla-bla… Toujours la même histoire.
Et je ne parle pas des chefs d’orchestre, chez qui la proportion de femmes est infime. Comme dans tous les postes de direction musicale. Lorsque j’ai été nommée directrice du Festival de Pentecôte de Salzbourg, en 2012, j’ai succédé à une lignée de chefs d’orchestre hommes, plutôt âgés. Les hommes se cooptent entre eux. C’est hallucinant.
Vous avez un appétit d’expériences que personne ne pourrait freiner !
J’ai besoin d’adrénaline, et j’aime tant entreprendre de nouvelles choses ! Je viens par exemple de former un orchestre baroque qui s’appelle Les Musiciens du prince, à Monaco. On a fait une tournée fantastique en Europe. Pour le prochain Festival de Salzbourg, je prépare une programmation sur le thème « 1868 », année de la mort de Rossini, mais aussi année de la création des Maîtres chanteurs de Nurenberg, de Wagner, et de La Péricole, d’Offenbach. Période foisonnante ! Et je vais inviter des artistes magnifiques. Vous voyez, je me déploie au-delà de mon métier de cantatrice. Mais je viens aussi de faire un disque avec l’incroyable Sol Gabetta, qui m’inspire et me donne l’impression de chanter avec son violoncelle.
Que croyez-vous avoir appris au fil du temps qu’il vous semble important de transmettre ?
J’ai appris ma façon à moi de faire de la musique. Et j’ai appris à me faire confiance. Comment vous dire ? Quand je lis la musique d’un compositeur, je sens aussitôt ce qu’il faut en faire, en tout cas ce que moi, je peux en faire. J’écoute les grandes chanteuses du passé, bien sûr, je tiens compte de qui a été fait, dit, analysé. Mais après, je fais à ma façon. Je suis ma voie. Et je pense que, dans un monde globalisé qui tend à l’uniformisation, où la mode et les réseaux sociaux émettent des diktats qui rendent les jeunes si conformistes, il est urgent de résister. De refuser les diktats d’une beauté standardisée. Non, ce n’est pas ça la beauté. C’est en soi-même qu’on la trouve. Il faut être authentique, écouter sa voix intérieure, se fier à sa propre intuition. Voilà ce que j’aimerais dire aux jeunes gens.
Propos recueillis par Annick Cojean
Nouvel album « Dolce Duello » : une sélection de chefs-d’œuvre baroques où s’allient la voix de Cecilia Bartoli et le violoncelle de Sol Gabetta (Decca Classics).
En concert lundi 4 décembre à la Philharmonie de Paris.
Retrouvez tous les entretiens de La Matinale ici