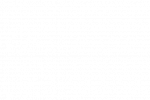Le jour où Johnny est devenu La France

Le jour où Johnny est devenu La France
Le professeur de philosophie Thomas Schauder analyse comment le chanteur décédé a pris une fonction symbolique, essentielle dans toute communauté politique, comme l’a montré Jean-Jacques Rousseau.
Lors de l’hommage à Johnny Halliday, le 9 décembre à Paris. AFP / Eric FEFERBERG / ERIC FEFERBERG / AFP
Chronique Phil d’actu. Même si la décision de Donald Trump de déplacer l’ambassade des États-Unis en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem est en train de créer une réaction en chaîne qui peut s’avérer catastrophique, comme l’a très bien expliqué Jean-Pierre Filiu sur son blog, et qui a déjà commencé à montrer ses effets au Proche-Orient et même en Europe, la France n’avait de regard, la semaine dernière, que pour les funérailles de Johnny Hallyday.
Loin de moi l’envie d’ironiser sur cet événement, qui est, bien au contraire, absolument révélateur à la fois de notre époque et, plus généralement, de l’essence de notre République. Bien sûr, en voyant comment les élites ont brutalement cessé de railler le chanteur populaire et comment peu de mauvais esprits ont rappelé les rapports houleux que « l’idole des jeunes » entretenait avec le fisc français, je ne résiste pas à l’envie de citer Georges Brassens : « Les morts sont tous des braves types ». Mais au-delà de l’homme pleuré par ses proches, au-delà du chanteur et de l’acteur pleuré par ses fans, un autre Johnny est apparu cette semaine : le symbole.
Le symbole et sa fonction.
Petit rappel : qu’est-ce qu’un symbole ? En Grèce antique, le symbolon était un tesson de poterie. Quand deux personnes passaient un contrat, elles cassaient ce tesson en deux parties et chacun avait la sienne. Cela permettait à leurs ayant-droits d’apporter la preuve du contrat passé auparavant : il suffisait de faire s’emboîter les deux morceaux. Le symbole est donc un signe, un objet (au sens large) qui rapproche des êtres différents. Par extension, il est devenu ce qui rapproche une réalité sensible d’un concept. Un feu rouge est le symbole de l’arrêt, le cœur est le symbole de l’amour, etc.
Johnny Hallyday était déjà un symbole pour beaucoup de gens : le symbole de leur jeunesse, de la révolte, de la liberté. Pour d’autres, c’était le symbole de l’américanisation de la France dans l’Après-guerre, du mauvais-goût, du kitsch. Pour d’autres, comme moi, ce n’était pas un symbole, mais juste une personne. Mais voilà, d’un coup d’un seul, au moment où je signalais qu’on ne commémorait pas suffisamment le centenaire de la mort de Durkheim, Johnny a subi une transsubstantiation : il est devenu La France…
Certains esprits avisés (comme les youtubeurs du Mock) n’ont pas manqué de faire le rapprochement entre Johnny Hallyday et Victor Hugo, dont l’annonce du décès en 1885 provoqua une vague d’émotion populaire et un vaste rassemblement d’hommage. Il me semble qu’Alain Finkielkraut, quant à lui, a eu tort de juger que « mettre sur le même plan Booz endormi [poème extrait de La Légende des siècles, 1859-1883] et Allumer le feu, c’est tourner la page de l’identité nationale » (RCJ, 10/12/17). Car ce qui compte, ce n’est pas la qualité intrinsèque du symbole, et d’ailleurs Victor Hugo n’avait pas manqué, en son temps, d’être l’objet de toute sorte de polémiques aussi bien politiques que littéraires (et la violence des premières représentations de sa pièce Hernani en 1830 peut rappeler les chaises brisées aux premiers concerts de rock). Ce qui compte, c’est que ce symbole joue son rôle, qu’il rapproche des éléments épars, qu’il unisse, qu’il fasse communier. Et c’est là où le politique et la religion se rejoignent et se confondent.
La dimension religieuse.
On peut critiquer le discours qu’a prononcé le Président de la République sur les marches de l’Église de La Madeleine samedi, que ce soit au nom de la laïcité ou de son contenu littéralement pathétique (qui joue uniquement sur le registre de l’émotion), mais il faut avoir l’honnêteté de reconnaître que ce discours jouait son rôle, comme Johnny, bien malgré lui, jouait le sien : celui de créer une émotion collective, de créer un récit capable de fabriquer du commun, de passer du chacun à de l’ensemble. Cette fonction symbolique est essentielle dans toute communauté politique, comme l’a montré le philosophe Jean-Jacques Rousseau.
Dans ses œuvres politiques, notamment Du contrat social (1762), l’une des plus importantes dans la fabrication théorique de la République française, Rousseau soutient qu’un État ne peut exister uniquement sur des bases rationnelles, sur le calcul de l’intérêt et sur le respect des lois. Il est nécessaire qu’il s’appuie sur des sentiments, des émotions, des fictions. C’est pourquoi il préconisait l’institution d’une « religion civile » capable d’instiller des « sentiments de sociabilité, sans lesquels il est impossible d’être bon Citoyen ni sujet fidèle » (livre IV, chap. VIII). Qu’on le veuille ou non, cette dimension religieuse existe dans tout système politique, dans « les mœurs, les coutumes […] l’opinion » (livre II, chap. XII). La France a ses héros, ses hymnes, ses grands événements, ses élus, ses symboles. Les funérailles de Johnny obéissaient à ce principe. Le choix du lieu (les Champs Élysées), l’image de la foule amassée et en larmes, le discours d’Emmanuel Macron (qui a poussé la référence biblique jusqu’à parler du « fils prodigue »)… Johnny a été canonisé par la République.
Le chanteur et le concert.
Pourquoi Johnny ? Pourquoi lui plutôt qu’un autre ? Il est paradoxalement bien plus facile pour quelqu’un comme moi qui, sans les détester, n’appréciait pas particulièrement ses chansons, de proposer une réponse à cette question que pour un fan pur et dur. Car le fan a un rapport intime avec son idole, des souvenirs, des images, bref du particulier. Or, je pense que si Johnny a pu mieux qu’un autre accéder à ce statut de symbole de la France, c’est parce qu’il est indissociable d’un phénomène purement collectif : le concert.
Les concerts de Johnny sont mythiques, leur mise en scène pharaonique. Et tout le monde s’accorde à dire que la voix de Johnny se révélait réellement sur scène. Mais surtout, et M. Macron l’a également rappelé dans son discours, dans ces concerts le public chantait avec lui, et même parfois à sa place. Il se constituait un chœur, or le chœur est, toujours selon Rousseau, le modèle parfait de la communauté politique, le symbole de la « volonté générale ». En effet, si tout le monde parle en même temps, on ne s’entend pas, alors que quand on chante en chœur, c’est comme si nous ne faisions qu’un. De même, la volonté générale n’est pas qu’une somme des volontés particulières, elle est ce qu’il y a de commun à toutes ces volontés. Johnny, comme le Législateur ou le Prophète chez Rousseau, faisait advenir cette union totale dans le chant. C’est pourquoi il pouvait devenir, dans la mort, ce symbole de la communauté nationale.
La nécessité des fictions.
En conclusion, on a tort, selon moi, de minimiser l’événement de la mort de Johnny. Il nous montre, au contraire, l’importance des symboles pour que nous puissions nous réunir. Dans le monde actuel, où la technique règne en maître, où les normes et les dispositifs ont tendance à remplacer les récits, nous vivons la « panne de rêve collectif », comme le dit le psychanalyste Roland Gori dans un entretien qu’il m’a aimablement accordé :
« Aujourd’hui à la place du projet, on a le programme […] et un programme si possible établi par les calculs de probabilité qui viennent à la place du rêve. On voit bien comment tout ce qui peut favoriser l’émergence de fiction, c’est-à-dire de sacré […] a été dévalorisé. »
Bien sûr, que ce besoin de sacré s’attache à des figures et non à des projets collectifs est un problème. Qu’il soit tourné vers le passé, vers les Trente Glorieuses, et non vers le futur l’est également. Les gouvernants ont beau jeu de nous offrir du spectacle pour compenser « la crise de légitimité » du politique. « Qu’on me donne l’envie » chantait Johnny Hallyday. Qu’on nous donne l’envie de célébrer autre chose que la mort des chanteurs...
Pour aller plus loin :
- Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, GF Flammarion, 2012 ; Essai sur l’origine des langues, GF Flammarion, 1993
- Roland Gori, Un monde sans esprit, Les Liens qui Libèrent, 2017
(pour podcaster l’intégralité de mon entretien avec Roland Gori, cliquez ici)
PS : je profite de cette occasion pour rendre hommage à M. Robert Damien, professeur émérite au département de philosophie à l’Université de Nanterre, qui avait dirigé mon mémoire de Master sur les rapports entre la musique et la politique dans l’œuvre de Rousseau et qui nous a malheureusement quitté le 26 octobre 2017.
A propos de l’auteur de la chronique
Thomas Schauder est professeur de philosophie. Il a enseigné en classe de terminale en Alsace et en Haute-Normandie. Il travaille actuellement à l’Institut universitaire européen Rachi, à Troyes (Aube). Il est aussi chroniqueur pour le site Pythagore et Aristoxène sont sur un bateau.
Voici ses dernières chroniques Phil d’actu :