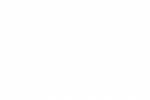Consulter un site djihadiste ne suffit pas à être condamné

Consulter un site djihadiste ne suffit pas à être condamné
Par Franck Johannès
Pour la seconde fois, le Conseil constitutionnel a estimé que l’article du code pénal créant ce délit portait atteinte aux libertés fondamentales
Le Conseil constitutionnel a censuré, une nouvelle fois, vendredi 15 décembre, le délit de consultation habituelle des sites terroristes, quasiment dans les mêmes termes que dix mois plus tôt. Il avait en effet jugé inconstitutionnel le 10 février un article de la loi antiterroriste du 3 juin 2016 qui entendait condamner à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende la consultation de sites « provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme », sauf si elle était faite « de bonne foi », par des chercheurs, des enquêteurs ou des journalistes.
La décision n’avait pas découragé les parlementaires et, trois jours plus tard, le sénateur Philippe Bas (Les Républicains, Manche), pourtant président de la commission des lois, avait réintroduit la disposition devant la commission mixte paritaire, en convenant « ne pas pouvoir exclure que le Conseil constitutionnel s’oppose à une nouvelle rédaction ». Eric Ciotti, député (Les Républicains) des Alpes-Maritimes, avait été un peu plus direct et avait estimé que « cette décision du Conseil constitutionnel, même si nous n’avons pas à la commenter et qu’elle s’impose à tous, laisse incrédule et traduit la faiblesse de nos démocraties face à cette barbarie qui a décidé de nous attaquer (…). Personne ne peut comprendre cette forme d’angélisme ».
Les parlementaires ont ainsi rajouté quelques mots à l’article 421-2-5-2 du code pénal. Il s’agissait désormais de condamner la consultation habituelle « sans motif légitime » de sites terroristes, « lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie » du site. Et, pour la seconde fois, Me Sami Khankan, appuyé par la Ligue des droits de l’homme et la Quadrature du Net, a plaidé le 4 décembre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et obtenu une censure du Conseil dans les mêmes termes. La haute juridiction rappelle, en effet, qu’aux termes de la Déclaration de 1789, la libre communication des pensées et des opinions « est un des droits les plus précieux de l’homme ». La loi peut y porter atteinte, à condition que la mesure soit « nécessaire, adaptée et proportionnée ».
Pouvoirs déjà « étendus »
Or, le Conseil rappelle que le code pénal fourmille de possibilités de sanctions pour prévenir le terrorisme, que les magistrats et les enquêteurs « disposent de pouvoir étendus » pour intercepter les communications électroniques, qu’ensuite « l’autorité administrative » et les préfets ont « de nombreux pouvoirs » pour prévenir tout passage à l’acte – pouvoirs encore élargis par la loi du 30 octobre – et, qu’enfin, les services de renseignement ont déjà accès aux données de connexion. De ce fait, le nouveau délit ne répond pas à « l’exigence de nécessité » de l’atteinte à la liberté de communication.
Il n’est pas plus « adapté » ni « proportionné » : « Si le législateur a ajouté à la consultation, la manifestation de l’adhésion à l’idéologie » des sites, tranche le Conseil, « cette consultation et cette manifestation ne sont pas susceptibles d’établir à elles seules l’existence d’une volonté de commettre des actes terroristes ». Quant au « motif légitime », il est des plus vagues et laisse planer un doute sur le droit d’aller sur Internet « rechercher des informations ».
La décision du Conseil, fortement charpentée, ne laisse guère de place à une troisième version de la loi. « Avec ce délit ressuscité, on se trouve affronté à une forme d’acharnement parlementaire qui confine à l’obstination déraisonnable, avait plaidé Me François Sureau pour la Ligue. D’un côté, la République réinvente l’index. De l’autre, elle remet au goût du jour la loi des suspects. »