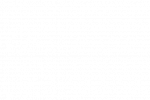« Contre Trump ou pour défendre les minorités, les étudiants de Columbia s’engagent »

« Contre Trump ou pour défendre les minorités, les étudiants de Columbia s’engagent »
De son passé tumultueux en 68 à ses engagements antiracistes et antisexistes actuels, en passant par la réaction à l’élection de Donald Trump, Pierre-Yves Anglès retrace l’engagement des étudiants de l’université new-yorkaise.
Des autocollants de l’une des nombreuses associations étudiantes LGBTQ de Columbia distribués à la rentrée universitaire. / PIERRE-YVES ANGLÈS
Chronique new-yorkaise. Diplômé de Sciences Po et étudiant dans un master de littérature à l’Ecole normale supérieure et à la Sorbonne, Pierre-Yves Anglès tient une chronique pour raconter son semestre d’échange à l’université de Columbia, à New York.
Comme sur l’essentiel des campus américains, l’élection de Trump a été une douche froide à Columbia. En janvier, des étudiants se sont rendus à la marche des femmes de Washington devenue une grande célébration anti-Trump. L’école de droit était particulièrement représentée. Quelques semaines plus tôt, le président de Columbia, Lee Bollinger, avait critiqué cette élection publiquement en déclarant : « L’université n’est pas une institution politique. On ne prend pas position sur les questions politiques, mais lorsque que vous avez un discours qui mène à un président et un vice-président mettant en péril l’idée centrale d’université, alors il faut agir. » Columbia s’est notamment érigée en sanctuaire pour les DREAMers en assurant qu’elle protégerait et financerait ses étudiants sans papiers.
Récemment, c’est la réforme fiscale portée par les républicains qui préoccupe les universités. Elle entend notamment revoir le statut des étudiants en master et en doctorat. Ils seraient désormais imposables sur les frais de scolarité dont ils sont exonérés et que l’on comptabiliserait subitement comme revenus. La banqueroute serait inévitable pour beaucoup d’étudiants et la recherche deviendrait la chasse gardée des plus riches, sans parler de l’effondrement de la compétitivité américaine dans ces domaines. La semaine dernière Columbia nous a fait savoir par e-mail qu’elle avait mobilisé ses relais à Washington pour « informer » les élus. L’université mène donc un lobbying agressif contre ce projet.
La liberté d’expression contestée
Sur le campus, le large consensus anti-Trump a des airs d’indifférence au quotidien. On en parle peu car il y a plus intéressant à faire, mais les piques ne manquent pas. Une de mes professeuses nous rapportait ainsi une conversation avec un touriste italien pour déterminer qui était pire entre Sarah Palin et Silvio Berlusconi – comme une partie de cartes Pokémon qui tourne mal –, mais elle a immédiatement conclu avec un sourire dépité : « C’était en 2008, avant que l’effroi n’atteigne un tout autre niveau dans ce pays. »
Un seul de mes professeurs nous a mis en garde pour que chacun n’estime pas vivre dans une bulle anti-Trump parfaitement progressiste. Trump a bien eu des électeurs et cet enseignant en appelle au pluralisme et à la pensée critique. Il déplore également qu’on étudie aucun auteur conservateur à Columbia, un campus à la solide réputation libérale – « libéral » au sens américain de progressistes et ancré à gauche. Cette attitude participerait, selon lui, au creusement d’un fossé entre les élites universitaires et les citoyens américains.
Les débats sur la liberté d’enseignement et d’expression font rage aux Etats-Unis. En octobre, des étudiants ont perturbé le discours de Tommy Robinson, un activiste britannique d’extrême droite et suprémaciste blanc invité par les républicains de Columbia. Au nom de la liberté d’expression et du code de conduite de l’université, ces étudiants ont été poursuivis par Columbia et menacés d’expulsion. Envoyer les intervenants les plus polémiques sur les campus pour provoquer des incidents fait aussi partie de la stratégie républicaine qui en nourrit ses réseaux sociaux et s’insurge de l’autoritarisme et du mépris universitaires.
Défense des sciences sociales et de l’environnement
La culture générale est perçue comme un bien commun pour lequel les anciens étudiants de Columbia savent se mobiliser. Invités chaque année à une grande journée nostalgie sur le campus et émus de retrouver un peu de la liberté et des contenus intellectuels qui ont marqués leur formation – avant que la vie professionnelle ne les astreigne à de longs tableurs Excel –, les anciens étudiants deviennent de formidables donateurs. Ils acquièrent par là même un droit de regard sur les décisions de l’université. C’est ainsi qu’ils se sont opposés au projet de supprimer les cours de sciences sociales obligatoires pour les étudiants en licence. Bien que ce dispositif coûteux ne semble pas avoir de finalité tangible – comprenez de rentabilité immédiate –, les alumni ont estimé que cette culture générale leur avait servi professionnellement et peut-être encore davantage dans leur développement personnel. Le président de Columbia a depuis réexprimé son attachement à ce « core curriculum ».
Les étudiants aussi savent faire pression sur le porte-monnaie. En 2016, ils se sont fait entendre pour que l’université retire ses investissements dans les énergies fossiles. Le sit-in de l’association Columbia Divest for Climate Justice a même reçu le soutien très médiatique de l’ancien candidat à l’investiture démocrate à l’élection présidentielle Bernie Sanders. Columbia a depuis annoncé une réorientation de ses investissements et en a profité pour communiquer sur son engagement pour le développement durable et adresser une énième pique à la Maison Blanche.
« Identity politics »
Dans un tout autre domaine, les étudiants de Columbia semblent très investis sur les questions d’« intersectionnalité », concept développé au sein de leur université par Kimberlé Crenshaw, à la fin des années 1980. Il s’agissait alors d’envisager les discriminations sociales comme cumulatives selon une série de facteurs : classe sociale, race, genre, âge, handicap, etc. Ce prisme d’analyse nourrit les mouvements d’identity politics – que l’on pourrait maladroitement traduire comme « politiques de reconnaissance des identités ». L’un des plus fameux est Black Lives Matter (2013, « La vie des Noirs compte »), qui a sa propre antenne à Columbia.
Le 9 octobre, les étudiants ont manifesté lors de Columbus Day, un jour férié qui célèbre la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. Ils demandaient que cette journée soit rebaptisée « Indigenous Peoples’Day » en mémoire des populations amérindiennes exterminées ou marginalisées par les premiers colons. Le 11 octobre, le campus a aussi célébré la Journée internationale du coming out et chacun pouvait arborer les stickers arc-en-ciel distribués par plusieurs associations. Les étudiantes et les étudiants de Columbia sont également très actifs dans la lutte contre le sexisme et le harcèlement, des sujets discutés depuis longtemps sur les campus américains.
En 68, l’opposition à la guerre du Vietnam
Ceux qui nient le bien-fondé des « identity politics » à Columbia sont perçus comme réactionnaires, dans le déni des discriminations qui ont cours sous leurs yeux. A gauche, d’autres détracteurs craignent néanmoins que ces questions, qui ont largement émergé dans les années 1960, n’éclipsent d’autres débats, notamment l’anticapitalisme. Cette multiplication des engagements à gauche a été reprochée à Hilary Clinton qui aurait « trop » fait campagne sur les questions minoritaires et délaissé les classes populaires. Le mouvement Occupy, qui a connu un succès retentissant aux Etats-Unis, semblait néanmoins mêler les revendications de l’« ancienne » et de la « nouvelle » gauche.
Nous reparlerons bientôt d’Occupy, lorsque nous fêterons les 50 ans de Mai 68 et le cortège d’événements contestataires de cette année. Avec les « printemps arabes », le mouvement des indignés et celui d’Occupy, 2011 serait l’héritière la plus récente de 68. Plusieurs chercheurs américains et français planchent sur ces vagues transnationales de contestation où les universités semblent avoir des rôles déterminants. En 68, et malgré une répression policière sévère, Columbia se mobilisait contre la guerre du Vietnam et l’ouverture d’une salle de sport ségréguée entre étudiants noirs et blancs. Avec l’université de Berkeley voisine de San Francisco, Columbia était alors parmi les campus les plus progressistes du pays, tête de proue de la côte est.