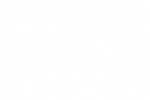Soins funéraires aux séropositifs : « Comment a-t-on pu priver des proches de leur deuil ? »
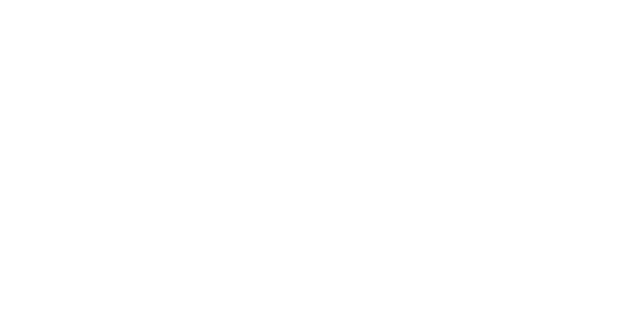
Soins funéraires aux séropositifs : « Comment a-t-on pu priver des proches de leur deuil ? »
Par Camille Bordenet
Pendant plus de trente ans, les défunts atteints du VIH ont été privés de soins de conservation. Une stigmatisation qui a pris fin le 1er janvier, après des années de mobilisation.
C’était son dernier rendez-vous avec l’homme qu’il a aimé pendant dix-huit ans. Il lui aura fallu des années et l’aide d’un psychologue pour effacer cette image et l’exhalaison putride qui l’a longtemps poursuivi. Christian, qui sentait d’ordinaire si bon le vétiver, à la morgue, son visage rongé par des tâches noires de décomposition. Une odeur de viande avariée qui prenait à la gorge.
« Pas une touche de maquillage n’avait été mise pour camoufler, rien, on ne touche pas un mort du sida », s’indigne encore son ex-compagnon, Frédéric Navarro, échalas de 57 ans sous un toupet de cheveux rouges. Au milieu du capharnaüm de leur appartement parisien, ce lieu qu’il tente toujours de se réapproprier depuis la mort de Christian, il raconte sa bataille. L’une de celles qui auront participé à mettre fin à une stigmatisation vieille de trente ans : l’impossibilité, pour les défunts atteints du VIH ou d’hépatites virales, de bénéficier des soins funéraires de conservation.
Christian est mort en juillet 2010. Il avait 47 ans. Sa santé s’était dégradée, il a fait un arrêt cardiaque, alors qu’il se trouvait seul dans leur appartement. Les pompiers l’ont emmené à l’institut médico-légal, où une autopsie a été pratiquée. Frédéric n’a été autorisé à le voir que treize jours plus tard, une fois l’enquête bouclée. Treize jours durant lesquels Christian, qui était séropositif, n’a pas eu le droit à des soins funéraires de conservation — l’injection d’un produit conservateur à la place du sang pour retarder la décomposition du corps.
Un décret de 1986
La loi l’interdisait en vertu d’un décret pris en 1986, au plus fort de l’épidémie de sida, par crainte d’exposer les thanatopracteurs à des contaminations. Cette réglementation est restée en vigueur, malgré l’évolution des connaissances et les progrès des traitements permettant de vivre avec une charge virale indétectable, sans risque de transmettre le virus.
En dépit, également, du fait que le respect des précautions universelles par les thanatopracteurs assure leur protection, comme l’ont souvent rappelé les associations et les institutions qui se sont prononcées pour la levée de cette interdiction (du Conseil national du sida en 2009 à l’IGAS en 2013). De fait, aucun cas de transmission du VIH dans le cadre de soins funéraires n’a jamais été rapporté.
Cette interdiction, Frédéric en avait entendu parler dans le milieu associatif d’Act Up. « Mais il fallait y être personnellement confronté pour réaliser que ça existait vraiment. Christian a été traité comme un pestiféré parce qu’il était porteur d’un virus dont on craint toujours la contamination, par méconnaissance. »
De rage, il a eu envie de retourner le cercueil. De prendre une photographie pour que la société prenne conscience de l’existence de « cette discrimination jusque dans la mort », rendant le deuil encore plus difficile aux proches… Mais il a tenu la promesse faite à Christian : lui donner un dernier baiser. Et il en a exaucé une autre : se battre pour dénoncer cette situation. Ce qui l’a conduit à prendre la tête d’Act Up Paris, de 2012 à 2013.
Amalgame avec la séropositivité
Son combat rejoint celui de Jonathan Denis, cadre bancaire de 33 ans. Ce matin de décembre 2008, lorsque Jonathan se présente aux pompes funèbres alors qu’il vient de perdre son père d’un cancer, on lui annonce être dans l’attente des résultats d’un test sérologique. Son père était homosexuel ; M. Denis soupçonne l’hôpital d’avoir fait l’amalgame avec le fait qu’il puisse être séropositif. La phrase, lâchée sans détour, résonne encore : « Si les résultats s’avèrent être positifs au VIH, votre père ne pourra pas avoir de soins de conservation. Son corps ne pourra pas être présenté à la famille car il faudra procéder à une mise en bière immédiate avant la sortie de l’hôpital. »
« J’avoue ne pas tout comprendre sur l’instant », se souvient Jonathan Denis, qui demande à voir l’arrêté en question. Et le découvre avec stupeur : « Cela existait donc vraiment ? » La journée fut longue, figé par la peur de ne pas pouvoir dire adieu à son père. Jusqu’au retour des résultats : négatifs. Son père a donc pu avoir des soins funéraires. « Mais la rage, elle, est restée. » Il fait remonter son histoire à Jean-Luc Romero, président d’Elus locaux contre le sida (ELCS), qui interpelle les pouvoirs publics et relance la mobilisation associative autour de cette question.
« Moi j’ai eu la chance d’avoir une dernière belle image de mon père. Je ne pense pas que j’aurais pu faire mon deuil sans cela. Mais les autres ? Comment la loi a-t-elle pu priver des proches de leur deuil pendant plus de trente ans ? Combien de familles ont vécu cela ? »
A cette dernière question, impossible de répondre. Peu de cas sont remontés aux associations, qui ignorent si cela signifie qu’il y a eu peu de familles touchées par cette interdiction — la cause du décès n’ayant pas toujours été notifiée par les médecins — ou si certaines, qui y auraient été confrontées, n’en ont pas parlé.
Xavier Cœur-Jolly, vice-président et porte-parole d’Act Up Paris, a perdu son premier compagnon, Jérôme, en 1992, à une époque où la question des soins funéraires se posait moins, « tant on mourrait du sida en masse et tant il y avait de combats à mener ». Il voulait toutefois que Jérôme puisse en bénéficier, pour que son corps, abîmé par la maladie, soit présentable à ses grands-parents, qui venaient de Bretagne.
« Ils auraient voulu pouvoir veiller leur petit-fils selon leur tradition. Quand ils ont vu le cercueil fermé et qu’ils ont compris qu’ils ne pourraient pas le voir, le grand-père, un ancien résistant emprisonnés dans des camps nazis, a eu du mal à croire qu’il existait encore des lois de la République qui ciblent des catégories de personnes. »
« Des familles n’auront plus à vivre cela »
Vingt-cinq ans plus tard, cette interdiction vient d’être levée. Depuis le 1er janvier, les défunts atteints du VIH ou des hépatites B ou C ont droit à des soins de conservation. Cette décision a été accompagnée de mesures visant à mieux encadrer la pratique de la thanatopraxie au domicile des défunts et de l’obligation pour les thanatopracteurs de se vacciner contre l’hépatite B, les spécialistes estimant que le véritable enjeu se situait à ce niveau.
« Comme cela s’est fait dans de nombreux pays, il aurait été possible de lever, il y a bien longtemps, la prohibition des soins de conservation pour les personnes atteintes du VIH et hépatites virales si l’on avait accepté plus tôt de mieux encadrer l’activité de thanatopraxie », souligne la juriste Lisa Carayon, dans un rapport consacré au sujet.
« Aujourd’hui, c’est un soulagement de se dire que les séropositifs seront enfin respectés dans leur mort. Et que des familles n’auront plus à vivre cela », se réjouit Frédéric Navarro. « Il en aura quand même fallu, du temps ! », regrette-t-il, évoquant ces longues années de mobilisation associative et de concertations avec les pouvoirs publics, l’attente face aux promesses politiques, « alors que le milieu scientifique avait démontré, depuis plusieurs années déjà, que cette interdiction n’avait plus lieu d’être ».
Reste une autre source d’amertume : la levée de l’interdiction demeure contestée par un syndicat de thanatopracteurs. Une position dénoncée par d’autres représentants de la profession, mais qui inquiète les associations. « Preuve que le combat n’est jamais terminé », estime M. Navarro.
« C’est la fin d’une discrimination post-mortem, mais que dire de toutes les autres, qu’on subit de notre vivant ? » Il ne compte plus les dentistes qui ont refusé de le soigner. D’autres se sont vus refuser des soins gynécologiques, la souscription de prêts bancaires, l’accès à certains métiers… « Raison de plus pour continuer à se battre », estime Frédéric. Il sourit en passant sa main sur une photographie de Christian : « On aura fini par lui rendre la dignité qu’on lui devait. Aujourd’hui, je peux enfin garder de lui le souvenir de sa belle gueule. »