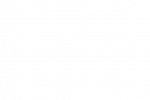Réfugiés palestiniens : « Il n’y a pas d’alternative à ce que fait l’agence de l’ONU »

Réfugiés palestiniens : « Il n’y a pas d’alternative à ce que fait l’agence de l’ONU »
Propos recueillis par Piotr Smolar (Jérusalem, correspondant)
Pierre Krähenbühl, responsable de l’agence des Nations unies pour les réfugiés de Palestine, explique l’importance de la mission alors que Washington menace de ne plus payer sa part.
Le sort des réfugiés palestiniens est engagé dans le rapport de force diplomatique entre l’administration Trump et l’Autorité palestinienne (AP). Washington menace l’UNRWA, l’agence de l’ONU qui leur prête assistance depuis près de soixante-dix ans, de geler une partie de son importante contribution financière, pour obliger le président palestinien, Mahmoud Abbas, à accepter des négociations sous conditions américaines avec Benyamin Nétanyahou.
Dans un entretien au Monde, le commissaire général de l’agence, Pierre Krähenbühl, souligne l’importance qu’elle revêt pour la stabilité au Moyen-Orient, et renvoie les parties impliquées à leurs responsabilités.
L’UNRWA a-t-elle déjà fait l’objet, par le passé, d’attaques aussi vives de Washington ?
Il faut faire une distinction. L’UNRWA a déjà fait l’objet d’attaques sur son mandat, sa création à l’attention d’une seule communauté, les réfugiés de Palestine. Lorsque vous travaillez dans un environnement aussi polarisé que le Moyen-Orient, au cœur du conflit entre Israël et Palestine, vous êtes souvent exposés à la critique. Il est déjà arrivé, dans le passé, que des donateurs réduisent ou coupent leur contribution.
La situation actuelle diffère. Le principal donateur historique de l’UNRWA – les Etats-Unis –, qui a été extrêmement généreux pendant des décennies, a un débat sur la façon de donner à la suite de ce qui s’est passé à l’Assemblée générale de l’ONU sur Jérusalem [à savoir la condamnation de la reconnaissance unilatérale, par Washington, de Jérusalem comme capitale d’Israël]. Ils ont décidé d’intégrer le financement de l’UNRWA dans cette analyse. Il y a un débat en cours. Mais aucune décision ne nous a été communiquée.
Quelles seraient les conséquences d’un retrait américain ?
L’UNRWA dépense entre 1,2 et 1,3 milliard de dollars par an. Si on prend l’ensemble de la contribution américaine, elle représente 300 millions de dollars. Le manque à gagner serait très important. Mais l’Union européenne et ses Etats membres représentent plus de 55 % des fonds. Nous avons de solides soutiens ailleurs. Il est de ma responsabilité que les 5 millions de réfugiés, dont 500 000 élèves dans 700 écoles, de Syrie à Gaza en passant par le Liban, la Cisjordanie et la Jordanie, puissent continuer à avoir accès à nos services. S’il devait y avoir une décision négative, il faudrait bien sûr que nous lancions des plans alternatifs, qu’on trouve de nouvelles alliances. On ne va pas abandonner cette communauté.
On a l’impression que le financement de l’UNRWA est en fait menacé depuis des années…
« Menacé », non, car ce mot donne le sentiment qu’il y aurait une espèce de plan pour mettre l’organisation en faillite. Ce serait injuste, d’autant que les donaateurs sont confrontés à une multiplicité de crises. Les contributions n’ont pas été à la baisse, mais les besoins de l’UNRWA sont en augmentation. Lorsque vous êtes confrontés à la guerre de 2014 à Gaza, ou depuis sept ans aux besoins des 500 000 réfugiés palestiniens en Syrie, il faut mobiliser davantage. Ma position consiste à dire aujourd’hui : n’aggravons pas l’instabilité actuelle au Moyen-Orient. Je pense qu’il n’est dans l’intérêt de personne d’avoir, par exemple, 270 000 enfants dans la bande de Gaza soudain privés de scolarisation.
On reproche parfois à l’UNRWA de permettre à la direction palestinienne de ne pas assumer ses responsabilités. Que répondez-vous ?
Ce genre de commentaires vient d’abord de gens qui se sont eux-mêmes déresponsabilisés politiquement par rapport au conflit. Si l’UNRWA existe après soixante-dix ans, elle n’en avait pas l’intention. C’est parce que la communauté internationale et les parties ont échoué de façon dramatique dans leur engagement à résoudre le conflit. Dans les accords d’Oslo [signés en 1993], un plan de transition sur cinq ans était prévu, selon lequel l’UNRWA aurait remis ses installations et son personnel, en Cisjordanie et à Gaza, à l’Autorité palestinienne. L’UNRWA a grandi parce que le processus d’Oslo est un échec.
J’ai aussi entendu dire qu’on boucherait les horizons pour les réfugiés eux-mêmes. La plus belle découverte que j’ai faite à l’UNRWA, après avoir travaillé vingt ans à la Croix-Rouge internationale, a été de voir un fonctionnement totalement différent des organisations humanitaires traditionnelles. Dans l’humanitaire, on regarde d’abord les victimes d’une catastrophe, de violences, d’un conflit. On les aide à surmonter la crise. Quand on investit comme l’UNRWA dans l’éducation, depuis les années 1950, avec plus de deux millions de personnes qui ont fini leurs études, on ne crée pas de la dépendance, mais les capacités de développement personnel.
Benyamin Nétanyahou réclame le transfert progressif des fonds de l’UNRWA vers le Haut-Commissariat aux réfugiés de l’ONU. Qu’en pensez-vous ?
Qui peut croire qu’en supprimant l’UNRWA, les Palestiniens n’aspireraient plus à une solution juste et durable, qu’ils ne ressentiraient plus le besoin de régler une injustice profonde ? C’est une illusion. A l’Assemblée générale de l’ONU, le mandat de l’ONU vient d’être reconduit par 167 membres pour trois ans sans modification. L’UNRWA est reconnu pour son rôle indispensable.
Les Israéliens ne comptent-ils pas sur une révision de la définition de réfugié palestinien, pour la rendre plus étroite ?
Un des arguments les plus souvent utilisés et les plus faux concerne les différences de définition. L’UNRWA a été établi avant le Haut-Commissariat aux réfugiés (UNHCR). Ce n’est pas l’UNRWA qui a défini ce qu’est un réfugié palestinien mais la communauté internationale, qui le reconfirme tous les trois ans.
J’ai longtemps travaillé en Afghanistan. Il y a des familles afghanes qui sont réfugiées au Pakistan ou en Iran depuis quarante ans et l’invasion soviétique de leur pays. Le HCR les reconnaît comme tels et les assiste, de même que leurs enfants. On nous reproche de transférer ce titre de réfugié de génération en génération palestinienne. Le HCR fait de même ! La seule grande différence entre un réfugié afghan et un réfugié palestinien, c’est que le premier peut rentrer dans un pays certes en situation difficile, mais indépendant. Les réfugiés de Palestine, eux, n’ont pas le choix. Les acteurs qui ne contribuent pas à une solution négociée perpétuent aujourd’hui le statut de réfugié palestinien.
Il y a bien sûr des choses que j’aimerais voir évoluer. On a 500 000 enfants dans les écoles. Le grand défi n’est pas seulement de leur fournir une éducation de qualité. Que va-t-il leur arriver après leurs études ? Après neuf ans dans nos établissements, dans la bande de Gaza, 65 % des jeunes se retrouvent sans emploi. Il s’agit d’un défi de société dans un contexte de conflit armé et d’occupation.
Cela ne relève-t-il pas de la responsabilité de l’AP ?
La réalité sur le terrain, celle de l’occupation militaire, est qu’il n’y a pas d’alternative à ce que nous faisons aujourd’hui. La dernière chose dont nous avons besoin au Moyen-Orient est qu’un acteur et contributeur majeur à la stabilité se retrouve en insécurité financière. On peut aussi voir cela d’une perspective européenne. Que se passerait-il dans la durée s’il n’y avait ni horizon politique ni fourniture de services à cette communauté ? Vous pensez que les cinq millions de réfugiés palestiniens resteraient tous dans la région ? On ne peut à la fois se soucier de l’arrivée des migrants en Europe et ne pas vouloir investir ici dans la région. Il faut donner un horizon.
Allons à l’essentiel. Et si c’était moi et ma famille ? Si vous avez le sentiment que l’avenir de vos enfants n’est pas garanti, que l’institution qui vous a permis d’obtenir vos diplômes est affaiblie, que le Moyen-Orient est déterminé par les conflits, et qu’en plus, malgré toutes les promesses faites depuis vingt-cinq ans sur l’intérêt de la modération en politique, rien ne se passe, on se dit qu’il va falloir créer cet horizon ailleurs. Dans ce cas, on n’émigre pas vers le sud… Je ne veux pas faire croire que ce genre de phénomène peut survenir d’un jour à l’autre. Mais souvenons-nous des Syriens.