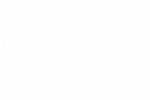A Fresnes et Marseille, les surveillants de prison excédés par leurs conditions de travail

A Fresnes et Marseille, les surveillants de prison excédés par leurs conditions de travail
Par Luc Leroux (Marseille, correspondant), Jean-Baptiste Jacquin
Sous-effectifs, violence, insécurité, incivilités... Ils étaient plusieurs dizaines jeudi matin à bloquer l’entrée des prisons pour exprimer leur ras-le-bol.
C’est devenu un rituel. A 6 heures du matin, jeudi 18 janvier, devant l’entrée principale de la maison d’arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), une cinquantaine de représentants syndicaux et de syndiqués ont achevé de bâtir de grandes barricades constituées de palettes de bois et de pneus. Seuls l’UFAP-UNSA, le syndicat majoritaire qui main dans la main avec la CGT négocie actuellement avec le directeur de l’administration pénitentiaire, et FO, qui a refusé les négociations, sont représentés. Seize cars de CRS sont positionnés à moins de 100 mètres.
« Nous demandons que le quartier d’évaluation de la radicalisation [QER] soit fermé », explique Frédéric Godet, secrétaire local UFAP-UNSA. Ce quartier où la dangerosité des personnes détenues pour des affaires liées de près ou de loin au terrorisme est évaluée par une équipe pluridisciplinaire pendant huit semaines compte quinze places. A la différence d’Osny et Fleury-Mérogis, les deux autres prisons franciliennes à accueillir un QER, ici, il n’est pas séparé du reste de la détention, c’est un bout de coursive.
M. Godet reconnaît que l’agression de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), jeudi 11 janvier, qui a provoqué le mouvement de protestation dans les prisons n’a été « qu’une étincelle qui a mis le feu aux poudres ». La radicalisation islamiste de certaines personnes détenues fait peur. « Les agressions en détention, cela arrive partout, mais les radicalisés sont des gens déterminés. On n’a pas tiré les leçons de l’agression d’Osny de septembre 2016. C’est comme si on attendait qu’il y ai un mort pour réagir. » A Fresnes, ils sont une centaine, dont soixante condamnés ou prévenus dans des affaires de terrorisme et quarante pour des affaires de droit commun mais identifiés comme radicalisés.
A 6 h 30, plusieurs centaines de surveillants, gradés et personnels qui affluent pour commencer leur journée de travail. La porte d’entrée n’est pas bloquée, mais personne ne pénètre. A 6 h 45, heure théorique de la prise de service, à coup de litres d’essences, la barricade s’embrase dans une ambiance festive.
« La violence est quotidienne en détention, se plaint Cédric Boyer, secrétaire local de FO Pénitentiaire qui tente de lancer quelques slogans. Il manque 70 surveillants sur un effectif de 750 agents alors que le taux d’occupation est de 203 %. » « S’il y avait 400 ou 500 personnes détenues de moins sur les 2 800, cela faciliterait les choses en matière de sécurité », reconnaît un membre de l’équipe de la direction qui préfère garder l’anonymat. A Fresnes, il y a trois ou quatre agressions de surveillant par semaines, « mais c’est parfois une simple bousculade ou un crachat », relativise un gradé.
« Incivilités quotidiennes »
Aurélie, 24 ans, surveillante titulaire à Fresnes depuis un an après une année comme stagiaire, assure « n’avoir encore jamais eu peur en détention », même s’il lui est arrivé d’être seule pour gérer une coursive. Son « record » : 142 détenus. « C’est sûr que ce n’est pas très sécuritaire, concède-t-elle. Certains services sont géniaux, car les personnes détenues sont détendues, et d’autres, on ne sait pas pourquoi, où c’est le bordel. »
« Le problème, ce sont les incivilités quotidiennes, raconte, las, Louis, 34 ans, dont huit passés à Fresnes. On récupère ceux que la société n’a pas éduqués, et ce n’est pas en prison qu’ils vont progresser. Certains adultes sont de vrais enfants, à peine on ouvre la porte, et c’est les insultes. Sans compter les fous qui n’ont rien à faire en prison. »
A 7 h 30, les pompiers se rapprochent tandis que des échanges discrets se font entre le responsable de la police, le directeur de Fresnes et les responsables syndicaux. Un policier en civil a compté près de 150 « manifestants ».
A 7 h 55, dans une ambiance bon enfant, après deux sommations de théâtre, les CRS vont déloger un à un les manifestants. Les chants et les blagues fusent. A 8 h 15, la porte s’ouvre et les personnels s’y engouffrent. Ils prendront leur service avec près de deux heures de retard. De quoi désorganiser toute la journée alors que les sorties en promenade, au parloir, à l’infirmerie ou en activités sont minutées.
« On n’a pas d’avancée sur notre sécurité »
Au même moment, à Marseille, une trentaine de surveillants étaient délogés par les CRS alors qu’ils bloquaient deux entrées du centre pénitentiaire des Baumettes, comme ils le font depuis le début de la semaine. L’intervention s’est faite avec le sourire aux lèvres devant la porte du bâtiment historique, de façon un peu plus musclée, quelques centaines de mètres plus loin devant les Baumettes 2, ouvert en mai 2017. Un feu de palettes, matelas et canapé a auparavant été noyé par les marins-pompiers.
« On n’a pas d’avancée de la part du ministère sur notre sécurité, voilà pourquoi on est là, explique Sylvain, surveillant de coursive aux Baumettes historiques, deux vieux bâtiments appelés à fermer en 2018. On veut juste être sûr de rentrer chez nous le soir après le travail, pas d’aller à l’hôpital voire, pire, ailleurs. »
Entré dans la pénitentiaire en 2010, il témoigne d’une « montée de la tension en détention. Et dans les situations difficiles, c’est le surveillant qui est en première ligne. Avec les jeunes générations de détenus, la moindre frustration débouche tout de suite sur la violence. Un parloir fantôme – lorsque la famille est absente –, une cantine pas livrée, un oubli d’inscription sur la liste du sport… la moindre étincelle peut déclencher un incendie. »
« On veut juste travailler en sécurité »
Coup de poing au visage, entorses, luxations : Anthony, 29 ans dont sept passés dans la pénitentiaire, affirme avoir subi quatre agressions physiques au cours des trois dernières années. Il a déposé autant de plaintes qui, assure-t- il, ont toutes été classées par le procureur. « On demande des effectifs, c’est vrai, mais aussi que les juges fassent leur travail car la violence physique devient de plus en plus fréquente. » Anthony qui a passé le concours de la pénitentiaire « par défaut » veut à tout prix « entrer dans la police nationale. La pénitentiaire, j’en peux plus ».
Les insultes, les crachats ne donnent même plus lieu à des rapports d’incident, assure Olivier, 32 ans. Un responsable CGT évoque aussi les menaces de certains prisonniers sur ses collègues : « On sait où tes enfants vont à l’école… On sait que tu roules dans telle voiture. Avant l’ouverture d’un parking fermé pour le personnel, c’était un véhicule de surveillant par mois en moyenne qui flambait dans la rue. On veut juste travailler en sécurité. »
Des surveillants assurent qu’une partie des détenus soutient leur mouvement. « Ils m’ont demandé ce qu’ils pouvaient faire pour nous aider », dit un manifestant. Coralie, jeune surveillante est poussée par ses collègues à rapporter les insultes qui fusent parfois derrière les portes : « Sale pute ! Viens me… » Elle aussi a « envie de [se] barrer mais on est là, on a signé et puis j’aime mon travail », dit la jeune femme. Je suis là pour aider les détenus car le contact humain est important ».