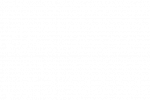Le consensus politique tunisien, étouffoir des idéaux de la révolution de jasmin

Le consensus politique tunisien, étouffoir des idéaux de la révolution de jasmin
Par Frédéric Bobin (Tunis, correspondant)
Tunisie, où vas-tu ? (1/6). L’alliance entre les « modernistes » et les « islamistes » a permis de préserver la paix. Mais elle a un coût : le retour du conservatisme.
C’est un paradoxe amer, un dégât collatéral de la stabilisation politique de la Tunisie. La démocratie a besoin de paix pour s’épanouir mais quand celle-ci vire au consensus opaque, à l’arrangement à huis clos, la concorde apparente ne devient-elle pas un masque, le faux nez d’un pouvoir confisqué ? Cette question, un nombre croissant de Tunisiens attachés à la transition démocratique de leur pays, célébrée à l’étranger comme un « modèle » dans le monde arabo-musulman, se la posent avec inquiétude.
Le consensus partisan qui prévaut depuis 2015 entre Nidaa Tounès (« moderniste ») et Ennahda (« islamiste »), les deux mouvements alliés dans une coalition gouvernementale après s’être violemment combattus en 2012-2013, ne s’est-il pas dégradé – au-delà de la vertu du calme recouvré – en étouffoir ? En machine à tout neutraliser ? En chambre secrète de transactions entre états-majors se partageant les positons d’influence ? En compromis conservateur tenant en suspicion tout contre-pouvoir ?
L’interrogation n’est pas qu’académique. Elle surgit inévitablement alors que l’inventaire de la transition démocratique en Tunisie, sept ans après la révolution de 2011, quatre ans après l’adoption d’une Constitution éminemment progressiste, dévoile un chantier non seulement inachevé – ce qui est compréhensible – mais à la dynamique enrayée. L’élan printanier de 2011, ce nouveau pacte civique scellé autour de la démocratie et de la justice sociale, s’est comme enlisé. Comparé au désastre des autres printemps arabes – Egypte, Syrie ou Libye – le grippage tunisien pourrait sembler bénin. A cette aune-là, la Tunisie demeure un exemple roboratif. Mais au regard de ses propres espoirs de changement exprimés en 2011, le dépit est évident.
« Rente démocratique »
Sur la seule sphère politique – et en mettant de côté la scène sociale où la désaffection est encore plus crue comme l’ont montré les récentes protestations – on ne compte plus les retards, les ratés, les faux pas, voire les régressions. Parmi les plus notables : un Parlement infantilisé, une Cour constitutionnelle dans les limbes, une commission électorale indépendante affaiblie, une décentralisation à la peine, une justice transitionnelle contestée, un arbitraire policier rémanent. Et puis, il y a ce nouvel air du temps, cette petite musique distillée par des gramophones réactivés qui entonnent la nostalgie d’un ordre à poigne tout en démonétisant la rupture de 2011, une sorte de révisionnisme de la révolution.
Tous ces signes ne suffisent pas à accréditer la thèse d’une contre-révolution en marche, d’un retour programmé à l’ancien régime du type Ben Ali. Les choses ne sont pas aussi simples. La « rente démocratique », qui est à la Tunisie ce que le pétrole est à l’Algérie, interdit d’emblée toute restauration qui coûterait aux autorités de Tunis la bienveillance internationale – en tout cas occidentale – garante de précieux soutiens financiers en ces temps de diète économique. Un exemple parmi d’autres de cette cote diplomatique toujours très élevée : le retrait sans difficulté de la Tunisie, mardi 23 janvier, de la liste des paradis fiscaux établie début décembre par l’Union européenne (UE). « Il faut sauver le soldat Tunisie », unique rescapé de la vague des printemps arabes, est un peu le mot d’ordre des bailleurs de fonds, tel le Fonds monétaire international (FMI). Ce crédit moral est forcément lié à l’expérience démocratique en cours et nul dirigeant à Tunis ne le sacrifierait. Le risque existe pourtant que cet ordre démocratique, à préserver dans sa forme, soit vidé d’une partie de sa substance au fil d’insidieux renoncements.
Les islamistes conquérants puis accommodants
Etait-ce le prix à payer pour cette prouesse politico-diplomatique qui évita à la Tunisie de basculer en 2013 dans les abysses de la guerre civile ? Car la configuration actuelle, produit d’une magistrale opération de sauvetage, activement encouragée par les Occidentaux (surtout les Américains et les Allemands), a permis de résorber la fracture qui ne cessait de s’ouvrir depuis la révolution entre deux camps irréductibles. D’un côté, les tenants de l’islam politique regroupés autour d’Ennahda qui dominait la coalition gouvernementale (la « troïka ») au pouvoir à partir de la fin 2011. De l’autre, les « modernistes » et les « laïcs » gravitant autour de Nidaa Tounès, éventail s’étirant de l’extrême gauche jusqu’aux anciens soutiens de Ben Ali. Ces derniers sont farouchement hostiles à l’islamisation d’une société tunisienne dont une grande partie demeure attachée au réformisme sociétal – notamment les droits des femmes – inauguré dès l’indépendance de 1956 par Habib Bourguiba, le « père de la nation ».
En cette terrible année 2013, la tension fut à son comble entre les deux camps à la suite de l’assassinat de deux figures de l’opposition laïque (Chokri Belaïd en février et Mohamed Brahmi en juillet). La rue s’enfièvra. Début août, des manifestations monstres réclamèrent le départ du pouvoir d’Ennahda, dénoncé comme responsable de la montée de la violence islamiste.
C’est dans une suite de l’hôtel Le Bristol, à Paris, que la réconciliation a été amorcée le 14 août 2013. Ce jour-là, Béji Caïd Essebsi, ex-lieutenant de Bourguiba et fondateur de Nidaa Tounès, rencontra Rached Ghannouchi, le « cheikh » d’Ennahda revenu à Tunis dès la chute de Ben Ali après 22 ans d’exil. Le pacte qui s’esquissa à ce moment-là déboucha sur une coalition gouvernementale au lendemain des élections législatives et présidentielle de la fin 2014 gagnée par le parti de Béji Caïd Essebsi, lequel tendit une main magnanime à des islamistes soudain accommodants après avoir été conquérants. Depuis lors, la Tunisie est dirigée par ce condominium qui a sans nul doute sauvé la Tunisie du chaos, mais dont la logique profonde, celle d’une cooptation entre élites politiques (l’établie et l’émergente), manque cruellement de transparence.
Il n’est pas anodin que cette rencontre au Bristol ait eu lieu un peu plus d’un mois après le coup d’Etat du 3 juillet 2013 en Egypte contre le président d’alors, Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans. A distance, l’événement a traumatisé les islamistes tunisiens, réveillant chez eux la crainte d’une répression à domicile dont ils avaient durement souffert à partir des années 1990 : 22 000 arrestations, torture dans les prisons, familles entières ostracisées. Cette mémoire de l’« éradication » continue de hanter les islamistes tunisiens et l’on ne peut comprendre leur revirement de l’été 2013 qu’à cette lumière-là. « Oui, cette angoisse existentielle a beaucoup joué », admet sous le sceau de l’anonymat un dirigeant d’Ennahda. Ce dernier ajoute qu’une telle réaction de survie a concerné la direction plus que la base, laquelle a toutefois fini par se rallier au virage pragmatique.
Un pacte scellé à l’hôtel Le Bristol
Quels furent les termes de ce fameux pacte du Bristol ? Evidemment, il n’y a pas eu de document. A en juger par le scénario qui s’est ensuite mis en place, on peut sans grand risque résumer ainsi le marché conclu. Un : Ennahda aida Béji Caïd Essebsi à accéder à la magistrature suprême. Deux : le chef de Nidaa Tounès s’engagea en contrepartie à protéger Ennahda des ardeurs d’éradication des faucons de son propre camp. Le premier acte se rééalisa très vite avec l’abandon par Ennahda – qui domine toujours alors la « troïka » au pouvoir – d’un projet de loi visant à exclure de la vie politique les titulaires de fonction sous la dictature passée, ainsi que sa renonciation à un article du projet de Constitution imposant une limite d’âge à un candidat à la présidence de la République. Cette double hypothèque levée, Béji Caïd Essebsi, né en 1926 et qui fut ministre sous Bourguiba et président du Parlement sous Ben Ali, put se présenter à l’élection présidentielle de décembre 2014. Il la remporta avec l’évidente complicité d’Ennahda.
Le deuxième acte se joua ensuite avec la formation du gouvernement de coalition début 2015. Même confiné à une participation minimale dans l’exécutif, Ennahda se sentit rassuré face au risque d’un retour de bâton répressif à un moment critique où soufflait le vent de la contre-révolution en Libye, en Egypte et en Syrie. Son assurance grandit même alors que les scissions successives au sein de Nidaa Tounès, plongé dans une violente guerre de clans, rétrogradèrent ce parti en deuxième position à l’Assemblée. Ennahda devint mécaniquement et à son insu le premier groupe parlementaire.
En dépit de ce rapport de forces qui évolue de facto en sa faveur, le parti islamiste ne se dépare pourtant pas de l’attitude conciliante, discrète, coopérative qui est sa nouvelle option stratégique. Ironie de l’histoire, ses dirigeants s’inquiètent même de la crise interne au sein de Nidaa Tounès dont le nouveau chef, Hafedh Caïd Essebsi, fils du chef de l’Etat, est entouré de partisans de l’alliance avec Ennahda. « Cette alliance est dans notre intérêt commun, c’est l’intérêt du pays », déclarait Hafedh Caïd Essebsi au Monde le 4 mars 2016.
Ennahda privilégie la stabilité
Cette occasion historique d’isoler les éradicateurs au sein de la mouvance dite « moderniste », Ennahda ne veut pas la rater. Il lui faut donc éviter que le Nidaa Tounès de Hafedh Caïd Essebsi ne s’affaiblisse trop. Le mantra du parti devient : « Il faut préserver le rapport de force électoral de 2014 [Nidaa Tounès en numéro un et Ennahda en numéro deux] », résume Saïd Ferjani, membre du bureau politique d’Ennahda et conseiller du chef du parti, Rached Ghannouchi. « Nous devons aider Nidaa Tounès », ajoute-t-il. « Nous n’avons aucun intérêt à redevenir dominant, précise un autre dirigeant du parti islamiste. Cela réveillerait la polarité de 2014. » Or Ennahda redoute par-dessus tout une résurgence de cette polarité dans l’actuel contexte géopolitique régional hostile aux Frères musulmans. « Nous n’avons pas vocation à être réprimés et à entrer en conflit avec l’Etat, souligne-t-il. Notre intérêt est dans la stabilité. »
Tel est le décor où va se déployer le fameux consensus tunisien qui produit aujourd’hui ses effets pervers. Au nom de la sacro-sainte « stabilité » à préserver à tout prix, Ennahda avalise sans broncher toute une série de mesures initiées par la présidence de la République ou Nidaa Tounès, lesquels ont recyclé de nombreux réseaux issus du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), l’ex-parti unique sous Ben Ali. La plus emblématique de ces mesures a été l’adoption à l’automne 2017 de la loi dite de « réconciliation administrative » qui permet d’amnistier les cadres de l’Etat ayant prêté leur concours aux malversations de l’ancien régime. « La connivence entre Nidaa Tounès et Ennahda est malsaine, déplore Selim Kharat, le président d’Al-Bawsala, une association qui milite pour une plus grande transparence dans la vie publique. Elle ne fait que renforcer le statu quo. »