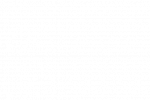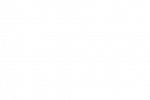« J’ai apprécié la grande audace intellectuelle à l’université Columbia »

« J’ai apprécié la grande audace intellectuelle à l’université Columbia »
De retour de son semestre d’échange à New York, Pierre-Yves Anglès en fait le bilan, sans oublier de raconter la période des examens et un cours sur Tocqueville riche d’enseignements sur la société américaine.
La bibliothèque Avery de l’école d’architecture, sur le campus de Columbia. / Pierre-Yves Anglès via Campus
Chronique new-yorkaise. Diplômé de Sciences Po et étudiant en master de littérature à l’Ecole normale supérieure et à la Sorbonne, Pierre-Yves Anglès tire le bilan de son semestre d’échange à l’université Columbia, à New York.
Après avoir rendu mes derniers devoirs pour Columbia au début de janvier, j’en reçois les résultats ces derniers jours. Les évaluations américaines se font en lettres, de A à C. Peut-être est-il possible d’aller plus bas, mais avoir moins de « B » serait déjà un très mauvais résultat dans ce système de notation plutôt généreux.
Ce séjour n’a pas manqué de densité intellectuelle et les cours que j’ai suivis me laissent un excellent souvenir. Un de mes séminaires sur Tocqueville proposait notamment une étude comparée des institutions, de la politique et des mœurs françaises et américaines. C’était aussi mon seul cours avec des étudiants en licence et cela m’a rappelé les limites du « tout participatif » assez courant aux Etats-Unis. La posture émotionnelle et politique de nombreux élèves s’est souvent révélée problématique. Elle empêche d’approfondir un sujet et de l’aborder de manière scientifique. La décontextualisation des œuvres me semble tout aussi dommageable. Un étudiant s’est par exemple insurgé que Flaubert ait dit « Madame Bovary, c’est moi », l’accusant d’usurper une identité féminine qui lui est étrangère. Difficile de parler de littérature, de psychologie ou d’un auteur quand on se limite à l’ériger en salaud.
Ce que Tocqueville révèle de l’Amérique
Heureusement, le professeur de ce cours avait quelques talents de chef d’orchestre. Un ami m’a très justement fait remarquer que, comme le judoka utilise la force de son adversaire pour le battre, il se saisissait des remarques les plus creuses pour nourrir et raviver le débat.
La lecture de Tocqueville m’a surtout permis de mieux comprendre les Etats-Unis, notamment son rapport à l’élitisme, très différent du nôtre. Dépositaire d’une culture aristocratique, la France postrévolutionnaire s’est empressée de créer une noblesse d’Etat et affectionne les honneurs. Elle s’est ainsi constituée comme une démocratie de la défiance où un « peuple » chercherait régulièrement à renverser des « élites », au moins symboliquement. La démocratie américaine se serait, elle, davantage construite sur un modèle de coopération au sein de communautés émigrées très homogènes — qui excluaient tout de même les Amérindiens, pratiquaient l’esclavage et marginalisaient les femmes. Au sein de cette petite communauté politique sans passé aristocratique, chacun devait pouvoir accéder à toutes les fonctions conformément au mythe égalitaire au cœur de la Déclaration d’indépendance.
Ces observations ne sont pas déconnectées du présent et justifient beaucoup des différences culturelles entre la France et les Etats-Unis. Il existe évidemment des élites américaines, notamment entrepreneuriales et industrielles, mais les distinctions néoaristocratiques fondées sur l’apparence, le diplôme ou la maîtrise d’une certaine culture semblent moins présentes dans les rapports quotidiens. Cela explique un peu de la sociabilité plutôt joviale aux Etats-Unis et cette idée fallacieuse que « tout le monde peut réussir », que tout le monde jouit de chances égales.
Tocqueville prend les langues antiques comme exemple. En France, avoir étudié le grec ou le latin reste une marque de distinction universitaire, mais Tocqueville pressentait déjà que les Etats-Unis y prêteraient peu d’égards. J’ai ainsi pu constater avec quelle maladresse beaucoup de professeurs abordaient les cultures antiques alors qu’elles revêtent une certaine sacralité dans les cours de lettres et de sciences sociales en France. Là où une professeure américaine s’amusait de confondre le latin et l’italien, un Français aurait certainement jeté un grand voile pudique sur son ignorance.
L’intérêt que j’ai trouvé dans mon cours sur Tocqueville ne doit rien au hasard. Columbia attire quelques-uns des meilleurs professeurs du monde avec des rémunérations et des services imbattables. Certains professeurs sont démarchés comme des footballeurs — même si les montants restent bien inférieurs —, à l’image de l’historien spécialiste des études gays et lesbiennes George Chauncey, qui a quitté Yale pour Columbia. Il renforce ainsi la capacité de recherche de l’université new-yorkaise, alors que Yale s’était fait une spécialité des études de genre.
Les professeurs américains jouissent d’un certain prestige social et le modèle économique des universités privées leur permet d’avoir un bureau, des aides à l’emprunt, des périodes libres d’enseignement pour conduire leurs recherches ou simplement du temps pour leurs étudiants. Les office hours, des plages horaires où les professeurs rencontrent leurs élèves individuellement pour parler de projets universitaires ou personnels, sont courantes aux Etats-Unis et j’en ai beaucoup bénéficié.
La valorisation des professeurs et de la recherche détermine largement l’attractivité universitaire américaine. Elle explique aussi que les Etats-Unis soient souvent à l’avant-garde de la recherche internationale, en sciences sociales et en humanités littéraires au moins. Ce qu’on y découvre a de bonnes chances d’être enseigné en France une décennie plus tard. Cela a notamment été le cas avec les études intersectionnelles et postcoloniales, aussi car elles ont des implications politiques différentes en France. Plus largement, j’ai eu le sentiment qu’il y avait beaucoup d’audace intellectuelle à Columbia. Le fait que les disciplines soient moins rigoureusement cloisonnées qu’en France n’y est pas pour rien. Si une parole plus libre peut induire des bavardages assommants, elle permet aussi de manier les œuvres avec plus de liberté, sans sacraliser les auteurs ni craindre la sentence du professeur.
L’allée appelée « college walk », l’un des axes principaux du campus de Columbia, illuminée pendant la période des fêtes. / Pierre-Yves Anglès
Frénésie de décembre à Columbia
Au-delà des cours dont j’ai largement profité, il a bien fallu que je me confronte aux examens de fin de semestre. Décembre à Columbia a des faux airs de « Koh-Lanta », sauf que vous êtes certain de gagner l’épreuve de confort puisqu’on vous abreuve de chocolat chaud et qu’on vous offre des biscuits à la bibliothèque. Pour le grand éclairage des décorations extérieures, l’université propose même du vin chaud et les chorales sont de sortie. J’étais plus dubitatif quand on a ramené des chiens à caresser et à photographier à la bibliothèque, pour un feed Instagram craquant entre deux sessions de révision.
Les bibliothèques du campus débordent à la fin du semestre. Certains y restent toute la nuit et d’autres ont cours tout le samedi. L’université se fend alors de messages pour rappeler ses étudiants à leurs besoins vitaux : le sommeil et l’alimentation. Je n’ai pas échappé à la frénésie ambiante. La fin du séjour induit une hyperactivité assez désespérée car il est impossible de profiter de tout ce que New York peut offrir en seulement quatre mois.
Je me suis assis dans l’avion pour Paris avec un kilo de cernes sous chaque œil et un profond sentiment de gratitude envers toutes celles et ceux qui m’ont permis de partir ces quelques mois, ainsi que pour les professeurs et les amis que j’ai rencontrés. Et je me suis envolé en repensant à ce texte de Sartre : « Le ciel de New York est beau parce que les gratte-ciel le repoussent très loin au-dessus de nos têtes. Solitaire et pur comme une bête sauvage, il monte la garde et veille sur la cité. » Si l’avenir m’en donne l’occasion, je retrouverai ces paysages entêtants avec plaisir.