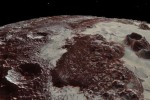Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari de nouveau affaibli par Boko Haram

Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari de nouveau affaibli par Boko Haram
Par Joan Tilouine
Le rapt de 111 écolières dans le village de Dapchi montre que la défaite des djihadistes promise par le chef de l’Etat est loin d’être acquise.
Une fois encore, la violence qui sévit dans le nord-est du Nigeria choque au-delà des frontières du pays le plus peuplé d’Afrique. Un nouvel enlèvement spectaculaire s’est produit à Dapchi, village de l’Etat de Yobe, lové au bord de la route qui mène à la frontière avec le Niger. Dans la soirée du 19 février, des djihadistes lourdement armés y ont fait irruption à bord de camions et de 4 x 4. Sans tuer de villageois, ils se sont dirigés vers le collège pour filles, d’où ils sont repartis avec 111 écolières, sans être poursuivis par les forces de sécurité, bien lentes à réagir. Une lenteur qui a provoqué l’ire du gouverneur de Yobe. Ibrahim Gaidam a fustigé l’armée nigériane, qui a retiré ses troupes de Dapchi une semaine avant ce kidnapping, comme ce fut le cas, en avril 2014, au lycée de Buni Yadi, où 59 élèves avaient péri sous les balles ou dans les flammes. La même année, 276 lycéennes furent capturées par le groupe djihadiste à Chibok, entraînant une indignation internationale.
Après une semaine de silence pesant, le gouvernement a fini par reconnaître les faits dimanche 25 février, suspectant les assaillants d’être « une faction du groupe Boko Haram ». Le président Muhammadu Buhari a qualifié l’événement de « catastrophe nationale » et a présenté ses excuses aux familles des victimes de Dapchi.
Grave crise humanitaire
Bien que divisé et affaibli, le groupe djihadiste, dont une faction opère sous la bannière de l’organisation Etat islamique, continue de déstabiliser toute la région du bassin du lac Tchad. La secte salafiste formée en 2002 à Maiduguri, capitale de l’Etat de Borno, s’est muée sept ans plus tard en l’un des mouvements armés les plus violents d’Afrique. Le conflit en cours depuis 2009 a causé la mort de plus de 20 000 personnes et provoqué le déplacement de 2,6 millions d’habitants, plongeant le nord-est du Nigeria dans une grave crise humanitaire.
Si Boko Haram perd du terrain et semble aujourd’hui incapable de contrôler un territoire, il démontre avec ce kidnapping sa capacité de résilience. La date ne semble pas improvisée : par la terreur, Boko Haram s’invite dans le champ politique nigérian, d’ores et déjà mobilisé pour les élections générales de février 2019.
C’est un coup dur pour le chef de l’Etat, dont l’administration a souvent affirmé que Boko Haram était « complètement défait ». « Cet enlèvement, politiquement instrumentalisé par l’opposition, va avoir un impact sur les élections, souligne Idayat Hassan, directrice du Centre pour la démocratie et le développement, un think tank établi dans la capitale fédérale, Abuja. Rien n’a fondamentalement changé depuis l’enlèvement des filles de Chibok en 2014 : l’armée et les autres agences de sécurité ont une fois encore démontré leur incapacité à se coordonner pour réagir vite et bien. »
Le chef d’Etat se retrouve un peu plus fragilisé, attaqué par son opposition qui lui demande des comptes et exige une enquête parlementaire pour mieux comprendre les dysfonctionnements au sein de l’armée ayant permis le kidnapping de Dapchi. En ce début d’année, deux anciens chefs d’Etat, Ibrahim Babangida (1985-1993) et Olusegun Obasanjo (1976-1979 puis 1999-2007), ont appelé M. Buhari à ne pas briguer de second mandat en 2019. « J’appelle le frère Buhari à considérer un repos mérité à ce moment et à cet âge », a écrit M. Obasanjo dans une lettre ouverte, en janvier, présentant par la même occasion sa nouvelle coalition politique. Le président Buhari ne s’est pas encore prononcé, mais son proche entourage laisse peu de doutes sur ses intentions. Même si dans les cercles du pouvoir, à Abuja, la santé du président de 75 ans, qui a été absent une grande partie de l’année 2017 pour se faire soigner à Londres, alimente les inquiétudes.
Rivalités ethnico-religieuses
Général à la retraite, lui-même originaire du nord, M. Buhari s’était engagé à éradiquer Boko Haram lors de sa campagne de 2015. Alors que pointe la fin de son premier mandat, le bilan reste mitigé. Malgré l’intensification des opérations militaires, le pouvoir s’est vu contraint à négocier avec les djihadistes, à leur verser des millions de dollars pour obtenir la libération de filles capturées à Chibok ou, en février, pour sauver des enseignants et des élèves de l’université de Maiduguri. « De vrais efforts ont été faits par cette administration au nord-est, mais ce n’est pas suffisant, constate Nnamdi Obasi, analyste à l’International Crisis Group. Même s’ils ne sont pas liés entre eux, les foyers de tension se sont multipliés dans tout le pays et la violence a considérablement augmenté ces dernières années. »
Dans le nord, la colère couve à Zaria parmi les disciples de l’imam chiite Ibrahim Zakzaky, détenu au secret depuis son arrestation en décembre 2015 par l’armée, qui a tué des centaines de ses partisans et de civils. Au centre du pays, le vieux conflit entre éleveurs et agriculteurs s’est ravivé sur fond de rivalités ethnico-religieuses, causant la mort de près de 168 personnes depuis le début de l’année, selon Amnesty International. Dans le sud, les groupes armés de la zone pétrolière du delta du Niger menacent de reprendre les attaques des tankers et des oléoducs, bien conscients de leur capacité à plonger le pays dans la récession, comme en 2016. A cela s’ajoutent les gangs mafieux urbains et les sécessionnistes du Biafra, qualifiés de « terroristes » par Abuja. Muhammadu Buhari orchestre la bataille sur plusieurs fronts. La guerre contre Boko Haram reste une priorité, la promesse faite aux Nigérians est un symbole qui peut influer sur le cours du rendez-vous électoral de 2019.