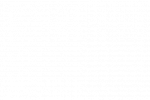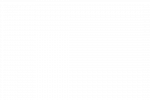« L’interdiction de “Much Loved” reste une blessure »

« L’interdiction de “Much Loved” reste une blessure »
Propos recueillis par Charlotte Bozonnet (Marrakech, envoyée spéciale)
Le réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch revient sur le tollé provoqué par son précédent film et sur la sortie en salles de son nouveau long-métrage, « Razzia ».
Il y a trois ans, la sortie de votre film Much Loved, qui racontait le quotidien de quatre prostituées à Marrakech, provoquait un tollé au Maroc. Le film a été interdit, l’une des actrices a été agressée. Quel impact cela a-t-il eu sur vous ?
Nabil Ayouch Ça reste d’abord une blessure. On fait des films pour les montrer. L’interdire dans mon pays d’origine, c’était couper le lien avec ce public. De plus, la manière dont il a été interdit en a fait ce qu’il n’était pas : un objet diabolique. Le torrent de violence et de haine qui a suivi m’a choqué. Dans le même temps, ça m’a permis d’éprouver ma relation avec le Maroc. Je me suis rendu compte que j’étais très attaché à ce pays, aux gens. Mais je n’oublie pas. Les mots que j’ai entendus, lus. Cela va bien au-delà des milliers de « like » sur des pages Facebook appelant à ma mort. Ce sont les insultes sur mes origines, ma famille.
Avec le recul, vous avez compris pourquoi le film avait provoqué un tel déferlement de haine ?
Parce qu’il présente une sorte d’anthropologie inversée : si j’avais construit des personnages féminins harcelés, dominés, battus, il n’y aurait pas eu de réaction. Mais j’ai construit des personnages féminins qui ont pris le pouvoir, des femmes fortes et indépendantes. Surtout, c’est une blessure narcissique. On se focalise toujours sur ce que vont penser les autres de nous. Le problème n’est pas la prostitution mais de faire un film qui en parle. Il faut arrêter de se poser cette question car elle est paralysante. Nous ne sommes ni meilleurs, ni pires que les autres.
Ce souvenir a-t-il pesé lorsque vous avez travaillé sur votre nouveau film, Razzia ?
Non, ça a au contraire renforcé ma conviction qu’il y a une urgence à dire, à montrer, et à parler librement. Et puis c’est trop difficile de faire un film – trois ans de ma vie – pour qu’à l’arrivée, il ne soit pas en accord avec ce que je pense.
Le film a-t-il eu des difficultés pour sortir ?
Non. J’ai suivi la procédure classique en demandant un visa au Centre cinématographique. Par contre, il a été interdit aux moins de 16 ans. Une décision totalement injustifiée et qui nous coupe d’une partie du public.
Much Loved était né de l’observation de femmes obligées de se prostituer à Marrakech pour gagner leur vie. Quelle est l’origine du film Razzia ?
Des rencontres que j’ai pu faire depuis vingt ans que je vis ici, et ma propre expérience de vie. Je me sens proche de certains personnages. Hakim, le musicien qui veut devenir rock star : c’est une partie de ma jeunesse en banlieue parisienne, et celle d’un jeune rencontré au centre culturel de Sidi Moumen. Inès, c’est un peu ma fille et ses copines à l’école française. Joe, le restaurateur juif marocain, ça vient beaucoup de moi. Pas seulement parce que ma mère est juive mais aussi par cette capacité à vivre dans le déni. Il y a des choses que je ne veux pas voir car elles m’affecteraient trop, alors je regarde ailleurs pour avancer. Il y a aussi Salima, très inspirée par Maryam [Touzani, actrice, coscénariste du film et compagne de Nabil Ayouch] qui a un immense courage.
Qu’est-ce que tous ces personnages ont en commun ?
Une soif incommensurable de liberté, de vivre comme ils l’entendent. Une soif d’aimer, de s’aimer. Mais aussi une solitude profonde.
Vous pensez que les libertés individuelles régressent ou progressent au Maroc ?
C’est très variable. De temps à autre, sur certains sujets, il y a des avancées. On a récemment adopté une loi contre le harcèlement. Mais nous avons aussi reculé, par exemple sur la place des femmes dans la société – je ne parle pas de leurs droits. Il y a vingt ans, il y avait des femmes en politique avec des postes importants, aujourd’hui nous avons une femme ministre et deux ou trois secrétaires d’Etat reléguées au bout de la table. Nous avons un gouvernement et un espace politique d’hommes. Même chose dans l’espace public : il est aussi beaucoup plus dur à conquérir pour les femmes. On a laissé trop d’espace à ceux qui veulent confiner la femme et nous ramener à un modèle de société ancestral.
Dans Razzia, vous situez la source de ces problèmes aux années 1980 avec ce personnage d’instituteur, dans les montagnes de l’Atlas, contraint par l’Etat de faire la classe à ses élèves, non plus en berbère, leur langue, mais en arabe auquel ils ne comprennent rien.
Oui, pour moi, c’est la source : le grand virage de l’éducation n’a pas été pris. Il est extrêmement difficile de trouver la bonne manière de faire avancer une société dans un contexte d’ignorance. Ce n’est pas seulement à cause de la langue, mais de l’hégémonisme culturel que ça a amené. Aujourd’hui, pour beaucoup de gens, être Marocain, c’est être un bon musulman pratiquant. Je ne sais pas si ça a été totalement volontaire. Disons qu’à un moment de l’histoire, on a cru pouvoir se développer sans passer par la case éducation. Quand on en a pris conscience, il y a quinze ans, il était trop difficile de repartir en arrière. Ça n’est pas fichu mais ça ne viendra pas seulement de la politique. Il faut que les acteurs économiques, sociaux, prennent des initiatives. Je suis de ceux qui pensent que les grands changements viennent de minorités agissantes qui influent sur le destin d’une nation.
L’autre grand thème de Razzia – avec celui des libertés individuelles – est la question sociale et celle des inégalités. Le film montre des manifestations – comme le royaume en a connu cette dernière année – mais aussi de la violence. Vous pensez que c’est un danger qui guette le Maroc ?
Oui, si on n’arrive pas à résoudre l’équation des inégalités et de l’injustice sociale, ces mouvements vont se multiplier. C’est une inquiétude. Nous avons atteint une certaine limite dans le domaine de la justice sociale, mais aussi des libertés individuelles. Il faut faire des choix clairs, qui vont nous engager, en matière de répartition des richesses, d’éducation, d’inclusion des jeunes, du statut de la femme.