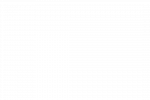« Le président Macron met enfin l’aide au développement au service des pays les plus pauvres »

« Le président Macron met enfin l’aide au développement au service des pays les plus pauvres »
Par Olivier Lafourcade et Serge Michailof
Dans une tribune, Olivier Lafourcade et Serge Michailof se félicitent de la décision de Paris de favoriser les dons directs aux Etats.
Tribune. Après tant de promesses, la main sur le cœur, de présidents français successifs, nous ne parvenions plus à croire à une reprise du contrôle de notre aide publique au développement (APD), condition essentielle, selon nous, de son efficacité. A chaque fois, Bercy, la main sur le portefeuille, s’empressait « d’oublier » les promesses présidentielles.
Ne jetons pas la pierre à nos hauts fonctionnaires, qui ont le souci du bon emploi de nos impôts. Ils se débrouillaient année après année pour maximiser les chiffres de notre APD, soit en gros 10 milliards d’euros, tout en veillant à en minimiser le coût pour le contribuable. Notre effort budgétaire effectif est ainsi inférieur au quart des 10 milliards annoncés.
Et puis, considérant sans doute que notre aide bilatérale, faite directement aux Etats, était suspecte, ce qui autrefois n’a pas toujours été faux – le spectre de la Françafrique n’a-t-il pas longtemps plané au-dessus de l’Elysée ? –, le ministère des finances faisait transiter les deux tiers de cet effort budgétaire par les grandes institutions internationales multilatérales : le Fonds européen de développement (FED), la Banque mondiale, les institutions des Nations unies. Notre argent n’était-il pas ainsi en de bonnes mains ?
Fourre-tout et martingale
Mais voilà, la notion même d’aide au développement prête à confusion. L’APD ne correspond pas à des transferts réels vers les pays pauvres, mais aux dépenses qui, dans notre budget, peuvent être imputées à l’aide aux pays en développement. On y trouve un fourre-tout incluant aussi bien le financement de projets concrets que des annulations de dette, des frais de scolarité d’étudiants étrangers – faisant de la Chine, gros pourvoyeur de jeunes dans nos universités, l’un des grands bénéficiaires de notre aide – ou encore de mystérieux frais administratifs. Nous respections après tout à la lettre les définitions de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Nous avions aussi découvert une martingale gagnante : en confiant un euro à l’Agence française de développement (AFD, partenaire du Monde Afrique), on arrivait, par le biais de prêts, à faire figurer un montant de 16 euros dans notre APD. Cette belle mécanique financière ignorait au passage les multiples rapports parlementaires et plaidoyers d’experts et d’ONG dénonçant depuis des décennies le paradoxe de cette approche. En se focalisant sur l’instrument prêt, qui « produisait » seize fois plus d’APD que les dons, notre aide bilatérale avait ainsi abandonné les pays les plus pauvres ! Pour ces pays, qui ne parviennent même plus à payer leurs fonctionnaires, il faut faire des dons, comme le font tous les autres pays de l’OCDE, en veillant à la bonne utilisation de ces fonds.
Et puis, à confier l’essentiel de nos ressources à des bailleurs de fonds internationaux, nous avions aussi perdu le contrôle de ce qu’ils faisaient de notre argent. Nous ne pouvions intervenir ni sur le choix des pays récipiendaires, ni sur le type de projets mis en œuvre. Enfin, en termes d’efficacité, la croyance en l’expertise supérieure des grandes institutions multilatérales est à relativiser. Le FED, grand gestionnaire de nos ressources, est une impossible bureaucratie. La Banque mondiale dispose d’une expertise exceptionnelle dans bien des domaines, mais elle connaît mal le Sahel, et il est peu avisé de demander à un expert pakistanais ou brésilien de s’occuper d’institutions construites sur le modèle français.
La grande incohérence était que, au moment où, au Sahel, nos militaires étaient les premiers à expliquer que le problème relevait d’abord du développement et de la gouvernance, nous n’avions plus d’instrument pertinent à notre disposition. Sur nos 10 milliards d’APD, l’AFD ne disposait que de 200 millions d’euros pour faire des dons à partager entre 19 pays. Les bonnes années, le Sahel recevait moins de la moitié de ce montant, soit 1 % de notre APD et 4 % de notre effort budgétaire. Absurde !
Renforcement de l’AFD
Malgré des annonces présidentielles encourageantes, le projet de loi de finances 2018 suivait encore largement cette logique, prévoyant toujours que deux tiers de notre effort budgétaire transitent par les grandes agences multilatérales, contre un tiers d’aide bilatérale. Le montant des dons transformés en projets par l’AFD était toujours de l’ordre de 200 millions d’euros. On avait l’impression que l’engagement du président Emmanuel Macron de porter à 0,55 % de notre revenu national brut le montant de notre APD risquait d’être reporté à la fin du quinquennat. Les mots « Sahel » ou « Mali » ne figuraient même pas dans les 89 pages d’annexe de la loi de finances consacrée à l’aide au développement.
Et puis, le 8 février, discrètement, le comité interministériel de la coopération internationale et du développement a démenti les orientations de la loi de finances. Derrière des décisions apparemment très techniques, dont un renforcement important des capacités de l’AFD, un virage majeur : le rapport bilatéral-multilatéral sera progressivement inversé et le montant des dons-projets confiés à l’AFD porté à 1 milliard d’euros en 2019.
Nous attendions depuis dix ans cette réforme fondamentale qui va enfin permettre à notre pays d’avoir une aide au développement au service à la fois des pays les plus pauvres et de sa politique étrangère. Espérons aussi qu’en lui permettant de reprendre en partie le contrôle de l’aide internationale au Sahel, elle pourra limiter la pagaille qui, en Afghanistan, a conduit au naufrage. Le temps presse et les mesures prises récemment doivent être suivies sans tarder d’actions concrètes.
Olivier Lafourcade est président d’Investisseurs et Partenaires pour le développement. Serge Michailof est chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et auteur d’Africanistan (Fayard).