« Mon stage au Congrès à Washington offre un point de vue imprenable et touchant sur l’Amérique »
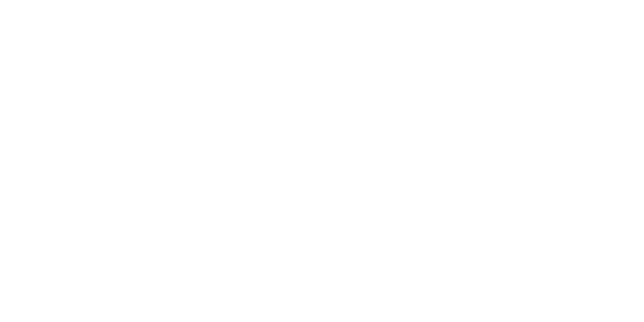
« Mon stage au Congrès à Washington offre un point de vue imprenable et touchant sur l’Amérique »
Etudiant français parti en échange universitaire à Washington, Léo Amsellem a postulé avec succès auprès d’un sénateur démocrate et raconte son quotidien au Capitole.
Pour sa troisième année à Sciences Po et à la Sorbonne Paris-IV, Léo Amsellem est parti en échange universitaire à la George Washington University. Il raconte le stage qu’il effectue le temps d’un semestre auprès d’un sénateur, à Washington.
« A mon arrivée à Washington en août, j’observais depuis l’avion en phase d’atterrissage le Capitole, bâtiment impressionnant de style néo-classique, où siège le Congrès. Il évoque immédiatement le pouvoir immense qui s’y concentre et charrie tous nos fantasmes et préjugés issus de séries américaines. J’étais alors loin de me douter que, quelques mois plus tard, j’y travaillerai comme legislative intern (stagiaire législatif) d’un sénateur démocrate. Une expérience qui, par un hasard du calendrier, a débuté le jour du discours de Donald Trump sur l’état de l’Union, devant le Congrès. Ce jour-là, j’arborais ma plus belle cravate, certes moins folklorique que celles des hauts dignitaires américains, qui affichaient fièrement canards et palmiers.
Pour y parvenir, j’ai simplement fait des recherches sur Internet, sur cette institution et d’autres qui m’intéressaient, et postulé par voie officielle directement sur le site du Sénat. J’avais visé trois sénateurs dont le positionnement politique était compatible avec le mien, et parce que je soupçonnais en eux un penchant francophile qui aurait pu compenser le net désavantage que constituait ma nationalité. Armé de deux lettres de recommandation de mes expériences professionnelles préalables, le Sénat français et les services du premier ministre, de mes bulletins de notes, ainsi que de toute mon énergie et ma détermination, j’ai reçu après plusieurs mois d’attente fébrile deux refus. L’un des sénateurs n’en motivait même pas la raison, l’autre m’expliquait par des éléments de langage laconiques que mon dossier ne serait pas étudié puisqu'il favoriserait les très nombreux candidats originaires de son Etat.
Sonné, je me suis rendu à l’entretien auquel le troisième sénateur, fort heureusement celui qui me convenait le mieux, m’avait convié. Je l’avais préparé avec un acharnement désespéré. Vierge de connaissances sur le système politique, économique, législatif du pays, j’avais ingéré des données brutes à m’en rendre malade. Mes arguments ont semblé convaincre la conseillère qui menait l’entretien et j’ai été recruté à temps partiel, pour le nombre maximal d’heures auquel mon visa étudiant me donnait droit – soit trois jours par semaine. A savoir que la rémunération est à la discrétion des sénateurs, et que la grande majorité d’entre eux n’en versent pas.
Une ville dans la ville
Soumis à la fouille minutieuse des agents à la mine patibulaire de l’unité de police du Capitole, dont le visage ne se détend qu’à la vue du badge ouvrant les portes du saint des saints, j’ai ensuite découvert un univers inattendu. Le Congrès américain est une véritable ville dont le Capitole, déjà marquant par sa démesure, n’est que la partie visible. L’autre, comme l’Atlantide, est immergée. Des souterrains constitués de larges couloirs en marbre courent de bâtiment en bâtiment. On y trouve des rangées de bureaux confortables, des salles de réunion, des bibliothèques, mais également un coiffeur, un teinturier, un bureau de poste et sans doute bien d’autres incongruités que je n’ai pas encore eu le loisir d’explorer. Au pays du productivisme (et du surpoids), trois lignes de métro réservées aux employés ont été construites afin de s’affranchir des distances entre les bureaux et de relier le Sénat à la Chambre des représentants, dont les bâtiments sont situé dans l’aile Sud. On peut s’y trouver assis face à John McCain, Bernie Sanders ou Elizabeth Warren. Plus de deux mille agents de police sécurisent les lieux nuit et jour. En France, les sénateurs avec qui j’avais travaillé employaient un ou deux collaborateurs à Paris et en circonscription. Ici, mon sénateur compte plus de trente conseillers à Washington et une vingtaine dans différentes villes de l’Etat qu’il représente. Beaucoup sont diplômés des universités américaines les plus réputées.
Outre les drapeaux, les donuts posés discrètement à l’arrière des bureaux, les écrans plats disposés aux angles de chaque pièce et branchés sur des chaînes d’information en continu, ce qui frappe est l’état d’esprit américain qui y règne.
Les premiers jours sont consacrés à des formations d’éthique et contre le harcèlement. On signe ensuite des accords de confidentialité stricts. On renonce formellement à toute relation amoureuse au sein du cabinet et on se voit rappeler l’interdiction de venir au bureau équipé d’une arme à feu. Ensuite, la méritocratie y est largement célébrée. Les premières tâches de stagiaire sont souvent assez élémentaires : gérer le courrier, répondre aux e-mails et aux appels des administrés. On nous explique, cependant, clairement qu’on peut s’en contenter, ou se rapprocher des conseillers techniques chargés des dossiers qui nous intéressent et faire nos preuves afin de se voir déléguer des charges plus complexes et stimulantes.
La hiérarchie existe, mais l’esprit d’initiative subsiste : de simples “correspondants législatifs” peuvent rédiger une note suggérant au sénateur d’orienter son vote, de se porter coauteur d’une loi, de proposer un amendement. Il est alors très gratifiant de constater que changer une voix sur cent (il y a deux sénateurs pour chacun des cinquante Etats américains) peut réellement peser au niveau national, voire international. Cela donne une sensation de vertige devant l’ampleur des enjeux et des conséquences de ces décisions.
Au téléphone, lobbyistes, administrés… ou le vice-président
Ainsi, lors du débat chaotique sur le budget faisant suite au second et bref shutdown du gouvernement, cent personnes réunies dans une salle devaient voter, en une nuit, un budget de plus de 4 400 milliards de dollars. L’échec aurait entraîné instantanément la mise au chômage technique de 850 000 fonctionnaires. Ce n’est qu’à six heures du matin que 71 sénateurs ont finalement voté en faveur du texte : la catastrophe était évitée, les conseillers pouvaient enfin respirer.
Cette position ne permet pas seulement de se former rapidement sur différents domaines techniques, elle offre surtout un point de vue imprenable et touchant sur l’Amérique. On reçoit des appels téléphoniques de lobbyistes, de conseillers, de diplomates, et parfois même du vice-président des Etats-Unis – Joe Biden, alors numéro 2 de Barack Obama, avait ainsi appelé un stagiaire parce qu’il ne retrouvait plus le numéro personnel d’un sénateur. On échange aussi avec des administrés en difficulté : certains, immigrés, m’ont ainsi expliqué que le vote d’un amendement précis sur une loi en discussion pouvait décider de leur maintien dans le pays ou de leur expulsion.
De telles conversations permettent de prendre pleinement conscience de la portée des décisions prises et d’observer la fracture qui règne dans ce pays troublé, au fil des appels de militants souhaitant féliciter ou vilipender son élu. J’ai ainsi eu le plaisir, en une seule matinée, d’être qualifié successivement au téléphone de “sale immigré” en raison de mon accent, puis d’être affublé du titre de “second Lafayette” par un vétéran amoureux de la France. On y jouit des honneurs de l’exagération, illustrant bien la formidable diversité de ce pays, qu’on ne peut enfermer dans une représentation trop simpliste. »







