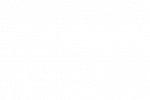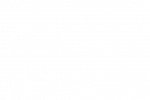Le Brésil dans le désarroi après la décision de Joaquim Barbosa de renoncer à la présidentielle
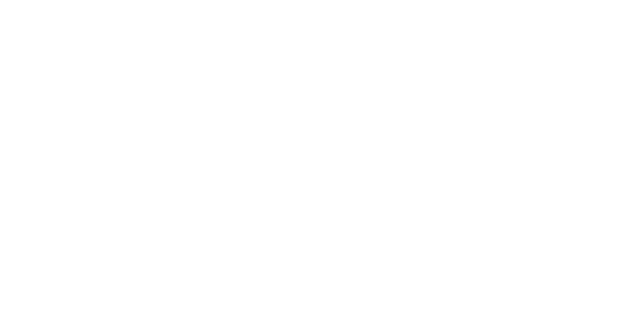
Le Brésil dans le désarroi après la décision de Joaquim Barbosa de renoncer à la présidentielle
Par Claire Gatinois (Sao Paulo, correspondante)
L’ancien président de la Cour suprême, très populaire, était perçu comme l’homme providentiel dans un monde politique gangrené par la corruption.
Les uns voyaient en lui un messie politique, un homme à même de réconcilier le Brésil, se souciant des millions de misérables que compte le pays sans affoler les milieux d’affaires. Les autres soulignaient l’image irréprochable de l’ancien président de la Cour suprême dans un monde politique vérolé par la corruption.
Mais Joaquim Barbosa, 63 ans, coqueluche des sondages de ces dernières semaines, ne sera pas l’homme providentiel que le pays attend. L’ex-magistrat a renoncé, mardi 8 mai, à se présenter à l’élection présidentielle d’octobre. Sur Twitter, le père de famille explique son choix par des « raisons strictement personnelles ».
Une source proche du sexagénaire, consultée par Le Monde, ajoute que M. Barbosa aurait été échaudé par le climat politique « nauséabond » du pays. Bien qu’effrayé par la radicalisation de l’opinion et la montée du candidat d’extrême droite, Jair Bolsonaro, celui que l’on surnommait parfois « Batman » du fait de sa cape de juge, ne se voit pas l’âme d’un « sauveur ».
Affilié au Parti socialiste brésilien (PSB) depuis le 7 avril, Joaquim Barbosa, avait alors laissé planer le doute sur sa candidature. Dans un pays où la gauche, orpheline, pleure l’emprisonnement de Luiz Inacio Lula da Silva, condamné à douze ans et un mois de prison pour corruption, et où la droite modérée peine à s’enthousiasmer pour l’ancien gouverneur de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, moqué pour son charisme de « sorbet de chuchu » – une cucurbitacée insipide –, le nom de Joaquim Barbosa emballaient les analystes, épatés par son score : entre 8 % voire 16 % des intentions de vote.
Un fils de maçon produit de la méritocratie
Une popularité déconcertante, pour un homme sans programme, qui n’a jamais fait part de son souhait d’être président. Un témoin du désarroi des électeurs brésiliens avides de nouveauté. Quatre ans après le déclenchement de l’opération anticorruption « Lava Jato » et la mise au jour d’un gigantesque système de pots-de-vin orchestré entre les groupes publics, les sociétés privées et les partis politiques, les Brésiliens ont perdu foi en leurs élites.
Mais ce fils de maçon, noir, semblait à même de les faire rêver. Produit de la méritocratie, Joaquim Barbosa fit, à 18 ans, le ménage dans un tribunal de Brasilia pour payer ses études avant de gravir un à un les échelons de la magistrature jusqu’au Graal : la Cour suprême, qu’il rejoindra en 2003, nommé par Lula, alors chef de l’Etat. L’adoubement n’empêchera pas la sévérité du juge lors du scandale du « mensalao », l’achat de votes de membres du Congrès qui éclaboussera le Parti des travailleurs (PT, gauche) et Lula.
Décidant de prendre sa retraite de la Cour suprême en 2014, le francophile, diplômé d’Assas, s’éloignera sans regret du tumulte de Brasilia pour couler une vie paisible entre sa résidence de Rio de Janeiro et son bureau d’avocat à Sao Paulo. Une retraite perturbée lorsque son nom apparaît dans les « Panama Papers » avec la découverte d’un appartement en Floride dont l’achat a transité par une société off-shore. « Une histoire bidon », selon l’intéressé, qui assure avoir mené cette acquisition en toute transparence.
La mise hors compétition de Joaquim Barbosa soulage les candidats de centre gauche – Ciro Gomes ou Marina Silva – comme de centre droit – Geraldo Alckmin. Mais son absence renforce l’incertitude d’un scrutin menacé par les dérives populistes. « Il y a encore beaucoup d’espace pour un discours antipolitique. Qui l’embrassera si ce n’est Bolsonaro ? », note Carlos Melo, professeur de sciences politiques à l’institut Insper de Sao Paulo, évoquant le candidat d’extrême droite, grand nostalgique de la dictature militaire.