L’exécutif plaide pour une protection sociale des travailleurs « ubérisés »
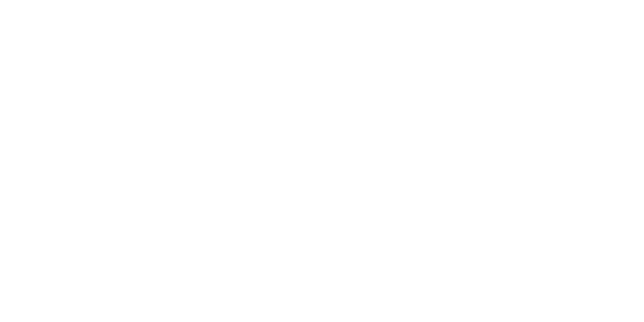
L’exécutif plaide pour une protection sociale des travailleurs « ubérisés »
Par Sarah Belouezzane, Bertrand Bissuel
Des négociations sont en cours avec les plates-formes numériques
La protection sociale des travailleurs « ubérisés » va-t-elle s’améliorer ? Tel est, en tout cas, l’objectif affiché par le gouvernement et par plusieurs députés de la majorité qui veulent ajouter des mesures allant dans ce sens dans le projet de loi « avenir professionnel », examiné à l’Assemblée nationale à partir de la fin mai. Des discussions ont été discrètement ouvertes, il y a plusieurs semaines, entre les services de la ministre du travail, Muriel Pénicaud, et des plates-formes numériques, parmi lesquelles Uber, Deliveroo et Stuart. Les protagonistes tentent d’identifier des solutions en faveur des précaires de l’économie digitale, dans le cadre d’un « deal global », selon la formule employée, début mars, par l’entourage de Mme Pénicaud.
Depuis quelques années, on assiste à l’émergence d’une nouvelle catégorie de travailleurs qui sont mis en relation avec le consommateur par le biais d’applications sur smartphone. Livreurs à vélo, chauffeurs… tous ont le statut d’auto-entrepreneur – une des modalités pour être qualifié d’indépendant – et ne bénéficient donc pas du filet de sécurité accordé aux salariés (assurance-chômage, etc.). Ils sont payés à la tâche par la plate-forme numérique à laquelle ils versent une commission à chaque fois que celle-ci les met en contact avec un client.
Cet écosystème, qui permet aux plates-formes de limiter à la portion congrue les prélèvements sociaux, est très décrié et engendre même des contentieux. Les uns résultent du recours de travailleurs indépendants qui demandent la requalification en contrat de travail de leur relation avec la plate-forme – mais très peu ont obtenu gain de cause, à ce stade. Les autres litiges sont à l’initiative de l’Urssaf, qui a considéré dans certains dossiers que les « ubérisés » étaient en réalité des salariés déguisés et que leur employeur devait par conséquent payer des cotisations. Comme l’a révélé, à la mi-mars, nos confrères de Mediapart, l’inspection du travail a même transmis au parquet de Paris un procès-verbal de près de 200 pages qui constate du travail dissimulé chez Deliveroo France, l’un des spécialistes de la livraison de repas à domicile.
Terrain miné
Les discussions engagées par le ministère du travail se déroulent donc en terrain miné. Le but de Muriel Pénicaud est d’accorder de nouveaux droits aux « ubérisés » mais aussi de clarifier leur statut, afin de sécuriser un modèle économique créateur d’emplois. « Le législateur tâtonne depuis quelques années, décrypte Me Marianne Lecot, avocate de la plate-forme Tok tok tok. La loi El Khomri de 2016 a posé une première pierre en affirmant le principe d’une responsabilité sociale des plates-formes, avec des droits en matière de formation continue et d’accidents du travail. »
L’exécutif entend aller plus loin. « Les représentants du gouvernement nous ont dit qu’ils voulaient étendre les droits et qu’ils réfléchissaient aux modalités pour y parvenir avec nous, confie, sous le sceau de l’anonymat, un haut gradé d’une plate-forme. Nous y sommes tous favorables mais nous avons chacun nos limites : certains sont prêts à mettre la main à la poche, d’autres clairement pas. »
Uber semble plutôt se situer dans la seconde catégorie. « C’est un vrai sujet, reconnaît un porte-parole du géant américain en France. Nous avons agi pour soutenir nos chauffeurs, par exemple en les assurant gratuitement. » Mais il est hors de question, complète cette même source, de participer au financement du système en cotisant.
Le député LRM du Val-d’Oise Aurélien Taché, corapporteur du projet de loi « avenir professionnel », ne l’entend pas de cette oreille. Pour lui, il est légitime que les plates-formes versent leur écot à l’Etat-providence. « En contribuant à la protection sociale, elles sécuriseraient leurs travailleurs qui n’auraient alors plus grand intérêt à demander la requalification en salariat », explique-t-il. L’une des idées défendues par M. Taché consiste à élargir les conditions prévues dans le projet de loi pour permettre aux indépendants de toucher l’allocation-chômage : il s’agirait de prendre en compte par exemple la « perte subite de revenus, pour inclure les auto-entrepreneurs », précise M. Taché. L’hypothèse de droits accrus en matière de formation continue est également à l’étude.
« Pour les plates-formes, le véritable enjeu est de montrer qu’elles sont des entreprises responsables, prêtes à accorder des protections supplémentaires aux travailleurs indépendants qui collaborent avec elles, résume Me Aurélien Louvet, du cabinet Capstan. Mais ces garanties nouvelles ne doivent pas être vues comme un indice laissant présumer une relation salariale entre les deux parties. » Autrement dit, il ne faudrait pas que les « ubérisés » tirent partie de ces droits nouveaux pour se voir reconnaître, devant les tribunaux, la qualité de salarié. Début mars, le cabinet de Mme Pénicaud avait d’ailleurs précisé qu’il fallait « traiter cette question de la requalification en salariat » afin de « sécuriser le “business model” » des plates-formes.
La démarche du gouvernement, fondée sur le dialogue « avec les entreprises de l’économie collaborative, est la bonne », commente l’économiste Gilbert Cette, co-auteur du livre Travailler au XXIe siècle (Odile Jacob, janvier 2017). « Toutes les parties prenantes peuvent gagner à l’instauration de normes stables, poursuit-il. Mais le sujet ne doit pas être cantonné à la protection sociale. Il faut parvenir à un socle de droits plus larges, par exemple la possibilité de contester une déconnexion par la plate-forme, comme salariés peuvent contester un licenciement. »
Co-fondateur du Collectif des livreurs autonomes de Paris (CLAP), Jérôme Pimot se montre beaucoup plus dubitatif sur l’issue des tractations en cours : « Elles ne laissent rien présager de bon. Ou alors que des effets d’annonce. »






