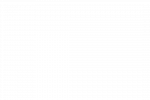La très grande solitude affective des exilés

La très grande solitude affective des exilés
Par Emile Costard
Contraints de quitter leur pays seuls, les Soudanais de Vichy que « Le Monde » a suivi racontent leur vie de célibataires en France.
Un soleil de mai filtre à travers le pare-brise. Ebloui, Ahmed profite d’un arrêt au feu pour sortir de sa veste une paire de lunettes noires, quand trois jeunes filles traversent au passage piéton. Il tourne lentement la tête de gauche à droite, mais un klaxon le sort de sa torpeur. En redémarrant, Ahmed esquisse un sourire gêné : « Elles étaient très belles… » Puis la gêne laisse place à la mélancolie. « Ça fait plus de trois ans que je n’ai pas vu ma femme. Trois ans, c’est long ! », ajoute-t-il pour justifier son absence passagère.
Ahmed est originaire de Nyala, une ville du Darfour qu’il a dû quitter précipitamment une nuit de novembre 2014 : « Quand j’ai été menacé par la sécurité nationale, je me suis caché et j’ai quitté le pays le plus rapidement possible. Je n’ai rien dit à ma femme, pour la protéger. » Ce n’est qu’une fois en Libye qu’il a pu l’appeler, la rassurer, lui expliquer son départ précipité, lui jurer qu’il allait bien et qu’ils se reverraient peut-être un jour. En Europe.
S’il est difficile pour Ahmed de parler de son exil, de sa vie d’avant, c’est avec une plus grande pudeur encore qu’il raconte sa vie sentimentale. « Grâce à WhatsApp, je suis en contact avec ma femme presque tous les jours », dit-il en faisant défiler sur son smartphone quelques photos de celle qu’il espère revoir au plus vite.
Comme Ahmed, 14 603 Soudanais ont pu ces dernières années bénéficier d’un titre de séjour en France, selon la direction des étrangers du ministère de l’intérieur. « Maisaujourd’hui la migration des Soudanais est presque exclusivement masculine. Dans les centres d’accueil et d’orientation, 90 % des demandeurs d’asile de nationalité soudanaise sont des hommes âgés de 25 à 30 ans », explique Didier Leschi, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Un sujet tabou »
Si ces dernières années la France a mis en place des politiques publiques pour la santé des migrants, l’apprentissage du français ou l’accès à la formation, une dimension essentielle pour le bien-être de ces hommes ne relève pas directement de cette prise en charge : la sexualité et la vie affective des exilés. « Ce sujet tabou n’est abordé que sous la forme du fait divers ou de l’effroi, alors même qu’il ne se passe pas une semaine sans que les questions de santé, de logement, de liberté de circulation fassent l’objet d’interventions associatives ou de colloques », regrette Didier Leschi.
Car ces jeunes gens dans la force de l’âge aspirent évidemment à faire des rencontres. Cependant, leur faible sociabilité, notamment en raison d’un manque de mobilité dû à leur difficulté d’accès à l’emploi, complique les rencontres avec des femmes et peut nourrir des frustrations.
Pour Ahmed, cette immigration quasi exclusivement masculine s’explique en partie par l’extrême violence sur les routes de l’exil. « Il aurait été impossible que je fasse endurer à ma femme ce par quoi je suis passé pour venir en Europe », raconte-t-il. Après avoir marché plus de huit jours dans le désert libyen et subi la cruauté des passeurs, il a traversé la mer pour se retrouver à la rue, sur les trottoirs européens.
Ali, 30 ans, lui aussi réfugié soudanais installé à Vichy, partage cet avis. « En Libye, les migrants sont traités comme des esclaves. Il y a des femmes d’autres pays africains sur les routes de l’exil, comme les Nigérianes, et ce qu’elles traversent est inhumain, pire que ce que les hommes endurent », explique cet ancien universitaire de Khartoum. Il ajoute que l’absence des femmes soudanaises sur les routes de l’exil s’explique peut-être aussi par les réticences de la société soudanaise à laisser voyager une femme seule.
« Sur Internet, sans succès »
Ahmed a aujourd’hui le statut de réfugié et vit dans un studio à Vichy. Il se dit chanceux de s’être marié officiellement avant de partir en exil. Il compte se lancer prochainement dans les démarches de réunification familiale pour que sa femme puisse le rejoindre en voyageant dans de bonnes conditions. « J’aimerais pouvoir bien l’accueillir, avoir une situation, un travail correct. En attendant, je continue de parfaire mes talents de cuisinier, dit-il avec humour. En vivant seul, j’ai appris à me débrouiller au quotidien. »
Pour ceux qui ne pourront faire valoir la réunification familiale parce qu’aucune femme ne les attend au Soudan où parce que leur union n’a pu être officialisée avant leur départ, Ahmed se veut positif. « Je connais plusieurs Soudanais qui ont des relations avec des Françaises. Dans quelques années, des couples mixtes se marieront. » Pour Hassan, qui a dû quitter son pays d’origine, l’Erythrée, afin d’éviter le service militaire, la barrière de la langue complique les interactions avec les Françaises. « Dans des villes comme Vichy, les rencontres avec des femmes sont rares, alors je vais parfois sur Internet, mais sans grand succès », regrette l’Eyrthréo-Soudanais de 37 ans.
Selon Didier Leschi, « il y a là une question à anticiper et à aborder, notamment quand on parle de l’intégration des migrants ». Car, aujourd’hui, la question de la sexualité se pose de manière bien différente de ce qu’elle a été pour les travailleurs immigrés des années 1960 et 1970. Ils étaient souvent déjà mariés ou engagés au moment de leur exil et avaient la possibilité de revenir régulièrement voir leurs épouses.