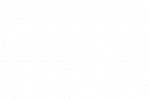Crise politique italienne : l’Europe partagée entre soulagement et inquiétude
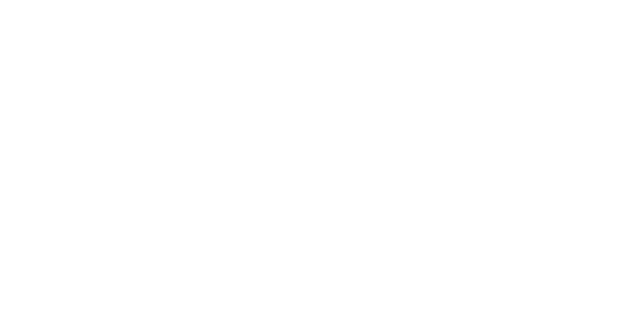
Crise politique italienne : l’Europe partagée entre soulagement et inquiétude
Par Service Europe
Le Front national dénonce un « coup d’Etat » venant de « Bruxelles, des marchés financiers et de l’Allemagne ».
Est-ce par volonté de ne pas renforcer le discours europhobe en Italie ? Les capitales européennes se sont en tout cas faites très discrètes à la suite de l’annonce de l’échec de la formation d’un gouvernement italien, dimanche 27 mai. Lundi matin, une forme de soulagement teinté d’inquiétude était perceptible. En Allemagne d’abord, où la volonté de confier à Paolo Savona le portefeuille des finances suscitait les craintes les plus vives.
Eurosceptique déclaré, cet économiste de 81 ans était présenté par la presse de ces derniers jours comme un « ennemi de l’Allemagne », pour reprendre le titre du portrait que lui a consacré, samedi, le quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dimanche soir, la presse allemande concentrait ses espoirs sur un seul homme : Sergio Mattarella, le président de la République italienne. « Le chef de l’Etat italien a bien fait. Courage, Mattarella ! », commentait le quotidien économique Handelsblatt en fin de soirée, ajoutant : « Sergio Mattarella a parfaitement joué son rôle constitutionnel en empêchant la formation d’une coalition populiste en Italie. »
En Allemagne, la perspective de voir M. Mattarella constituer un gouvernement technique sous la direction de l’économiste Carlo Cottarelli, convoqué lundi matin au palais du Quirinal, nourrit toutefois des inquiétudes.
Une catastrophe évitée
La presse allemande anticipe déjà les conséquences d’une telle décision, propre à « alimenter encore plus les sentiments populistes », selon Thomas Schmid, éditorialiste au quotidien conservateur Die Welt, pour qui, en cas de nouvelles élections, « le grand vainqueur » pourrait cette fois être la Ligue, le parti d’extrême droite dirigé par Matteo Salvini. Une façon de dire que si une catastrophe a été évitée, une autre, pire encore, est peut-être à attendre.
« La formation d’un nouveau gouvernement technique sous la férule d’un ancien apparatchik du FMI, c’est un cadeau fantastique pour M. Salvini », résume Yanis Varoufakis, ex-ministre des finances grec du gouvernement Tsipras, sur son blog, lundi 28 mai.
En France, où plusieurs ministres n’avaient pas hésité à critiquer publiquement le programme de coalition, aucune réaction officielle n’était intervenue lundi matin. Seul le Front national a dénoncé un « coup d’Etat » venant « de Bruxelles, des marchés financiers et de l’Allemagne ».
A Bruxelles, les dirigeants des institutions communautaires étaient certes soulagés d’avoir échappé à la nomination d’un ministre des finances professant des idées de plan B pour l’Italie et l’euro. Jusqu’à ces dernières heures, ils redoutaient un nouveau bras de fer « à la grecque », comme avec le gouvernement de la gauche radicale d’Alexis Tsipras en 2015, mais en pire, la troisième puissance économique de la zone euro risquant d’entraîner tout le reste de l’eurozone dans la tourmente.
Mais les chances d’aboutir d’ici l’automne à un accord sur les règles de Dublin d’accueil des réfugiés, sur une réforme substantielle de la zone euro semblent s’éloigner encore davantage si l’Italie doit retourner aux urnes. « Impossible de prendre de telles décisions sans Rome », assénait il y a quelques jours un diplomate bruxellois. « Il faut surtout privilégier un gouvernement stable, avec lequel l’UE pourra travailler de manière efficace », a expliqué Didier Reynders, ministre belge des affaires étrangères.