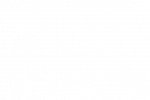Samis, Tamouls, Barawanis et Kabyles ont leur Coupe du monde à Londres

Samis, Tamouls, Barawanis et Kabyles ont leur Coupe du monde à Londres
Avant la Coupe du monde des nations reconnues par l’ONU, celle des nations et peuples non représentés, des Etats non reconnus, des autonomistes, des minorités et des apatrides qui ne sont pas affiliés à la FIFA se tient à Londres jusqu’au 10 juin.
Sur la pelouse du stade de Bromley, banlieue aisée au sud de Londres, une petite fille est assise en tailleur. Autour d’elle, une trentaine de journalistes la regarde agiter un drapeau, celui du Tibet. A deux pas, une chanteuse du « pays » du Dalaï-Lama, en tenue traditionnelle, clôt la cérémonie d’ouverture de la troisième ConIFA Football World Cup, plus proche de la performance en centre culturel que des grands spectacles organisés par la FIFA. Au cœur de l’enceinte de 5 000 places, bordée de chênes et de publicités pour les pompes funèbres du coin, pas de démonstrations pyrotechniques ou stars de la pop mondiale. Ici, tout est à taille réduite, comme les identités représentées au sein de la Confédération des associations de football indépendantes, qui cherchent l’espace pour grandir.
Au terme du match entre la sélection du Barawa, ville portuaire au sud de la Somalie et le Tamoul Eelam, territoire séparatiste situé au nord-est du Sri Lanka, le capitaine barawani, Omar Sufi, envoie des bises en tribune. Son équipe vient de gagner 4-0. Les fans répondent : « we love you Omar. » Ici, ils ne sont pas des milliers, mais seulement six et tous membres de sa famille. Sufi est aussi fier que s’il venait de jouer devant un stade comble. Affamé en cette période de ramadan, il se précipite vers l’assiette de riz jaune qu’on lui tend. Alors, son frère, Yusuf, prend sa place. « Omar est né à ici, mais pas moi, explique-t-il. Nous sommes arrivés à Londres en 1992. Si je n’étais pas venu, je serai mort. »
Il y a trois ans, Sufi perdait un oncle dans un attentat-suicide. En plein conflit, lui-même a frôlé la mort. « On devait changer un sac d’argent somalien contre quelques dollars, narre-t-il. Avant, j’ai voulu aller voir mon grand-père. Sans ce détour, nous aurions été là quand une bombe est tombée. Elle a tué onze personnes. » Contrôlé par le groupe salafiste des Chabab jusqu’en 2014, Barawa est à des années-lumière de remplir les conditions nécessaires pour accueillir un événement sportif. Nombreuse à Londres, la diaspora barawanie, qui parle une langue distincte du Somali, a pris le relais.
Une première édition chez les Samis
Dès la fin des rencontres, le football fait place aux enjeux derrière la présence des participants. Pour les seize équipes, il s’agit avant tout de rappeler l’existence de leur communauté au monde. Parmi les membres de la ConIFA, les combats sont aussi divers que les histoires des personnages qui les défendent. Toutes comportent, néanmoins, un chapitre lié à une identité complexe. Fondateur de la ConiFA en 2013, Per-Anders Blind, désormais président, est par exemple né à Sulitjelma, sur les bords du lac Langvatnet, au nord de la Norvège.
Entouré de glaciers, le petit village se situe en Sápmi, la terre du peuple sami, qui s’étend jusqu’à la Russie en passant par la Finlande et la Suède, où se tenait en 2014 la première coupe du monde ConIFA. Chez les Blind, on est éleveurs de rennes depuis des générations. Ancien arbitre dans le championnat suédois, Per-Anders est le premier à briser la tradition familiale. Au sous-sol de l’hôtel des joueurs, le président, crâne chauve, bras musclés serrés dans un polo blanc et vert, relate : « Mon père m’a très vite dit : “quoi que tu fasses dans la vie, tu ne seras pas éleveur de rennes.” Il voulait une vie meilleure pour moi. »
Le patriarche veut protéger son fils de sa propre identité. « Les Samis ont toujours été abusés par le gouvernement suédois. Jusque dans les années 1970, il existait un institut de biologie raciale. Ils prenaient des Samis et fracassaient leur crâne, leurs dents. » Dès ses trois ans, Per-Anders est envoyé en Suède avec sa mère. Les Blind dénaturent leur enfant, l’arrachent à son identité afin de lui donner la chance d’une existence « normale ». Radicale, sa famille refuse qu’il apprenne la langue same.
Enfant, Per-Anders souffre quand même. « Blind est un nom typiquement sami, enseigne-t-il. A l’école, à cause de ça, on me frappait. Souvent, je rentrais avec mes habits déchirés et du sang partout. » Et les conséquences de la décision paternelle sont durables. « Je ne me suis jamais senti chez moi nulle part, révèle-t-il, la tête baissée. Je suis né en Norvège, mais je ne suis pas Norvégien. Je vis en Suède, mais je n’y suis pas né. Je suis Sami, j’ai un renne, mais je ne parle pas la langue. J’ai une connexion avec tous ces endroits, mais je ne suis de nulle part. »
Ce déchirement identitaire est, selon lui, sa force motrice, la raison pour laquelle il travaille avec tant de passion pour que les identités et cultures de tout le monde soient respectées. Son engagement est tel, qu’il raconte s’être privé de nourriture pour pouvoir financer de sa poche la première édition. Grâce à son passé, le président peut nouer des liens avec les ressortissants d’autres peuples opprimés ou niés à travers le monde, sans pour autant partager les revendications de tous. Alors que des parlements samis existent, en Norvège, en Suède et en Finlande, le président ne prône pas une quelconque réunification. En Sápmi, il n’existe pas de mouvement autonomiste. En revanche, d’autres participants au tournoi ont des revendications plus tranchées.
Des tigres et des menaces
Face à Barawa se dresse la sélection tamoule. En sari turquoise, alors que son hymne retentit, Sanju Ganesan porte le drapeau des Tigres tamouls, le groupe armé défait par l’armée sri lankaise en 2009, au bout de trente-trois ans de guerre civile. A l’âge de sept ans, en 2001, Sanju et sa mère fuyaient leur petit village, près de Jaffna, ville connue pour son soutien à la lutte armée. « Les intimidations et discriminations de l’armée sri-lankaise étaient très dures, surtout envers les femmes », commente la jeune femme, leadeuse de l’association des jeunes Tamouls du Royaume Uni, qui supporte toujours l’indépendance. Néanmoins, Ganesan assure que la participation des Tamouls est plus culturelle que politique. « Au Sri Lanka, notre identité est totalement détruite, assène-t-elle. Mes enfants n’auront peut-être jamais l’occasion d’y aller. Alors il faut créer des alternatives pour exprimer notre identité ici. » Sans surprise, le Sri Lanka ne goûte que très peu à la participation des Tamouls, mais ne s’est plaint qu’à travers une lettre, adressée au président Blind. D’autres Etats souverains sont allés plus loin.
Joues rasées de près et costume gris cintré, Aksel Bellabbaci est le secrétaire d’Etat aux sports du gouvernement provisoire kabyle en exil. Il vit à Paris, mais est né dans un village près de Tizi-Ouzou, capitale informelle, à cent kilomètres à l’est d’Alger. Militant depuis l’adolescence, il a fondé la sélection kabyle en 2014. « Ce qui est dur, c’est de tout construire dans l’ombre, sourit-il, en tirant sur sa cigarette. L’ambassade d’Algérie en France a convoqué certains de nos joueurs. En Algérie, un d’eux a reçu des menaces. Il avait envie de venir, mais il a eu peur. »
Bellabbacci ne blâme pas son joueur, peu habitué à des méthodes que, lui, connaît bien. « Depuis le débarquement des Arabes au nord de l’Afrique, ils ont toujours essayé d’effacer les identités, assure-t-il. Ce qui les gêne dans ce projet, c’est qu’on transporte notre cause à l’étranger. » Ironie du sort, l’Algérie soutient le Front Polisario, mouvement de libération du Sahara occidental, qui a aussi participé aux éliminatoires de la ConIFA. « Mais c’est pour servir leurs intérêts, siffle-t-il. Ils veulent embêter le Maroc, qui nous a défendus à l’ONU. Aucun pays ne nous défend pour le plaisir. » En revanche, Bellabbaci peut compter sur d’autres soutiens : ceux des nations sans Etat et des membres de la ConIFA. « Si vous faites l’aumône dans la rue, généralement, c’est les pauvres qui vous donneront », philosophe-t-il.
« Freedom to play football »
La maxime de la ConIFA est simple. Jouer au football, comme liberté fondamentale. En défendant le droit pour onze joueurs de porter le maillot d’un territoire non reconnu, l’organisation leur donne le droit d’exister. Enfin rassasié, le capitaine barawani résume : « Avant le tournoi, qui savait ce qu’était Barawa ? On n’essaie pas de devenir un pays. On veut juste que les gens sachent qu’on existe. » Pour cette édition, trois cent cinquante médias ont été accrédités. Pour la plupart des communautés représentées, il s’agit de la plus grande couverture jamais obtenue.
Une couverture qui, de surcroît, n’est que positive. « Cela nous donne une caisse de résonance, reprend Yusuf, le frère. L’an dernier, on a joué un match de charité, qui a rapporté assez pour acheter un mois de nourriture au pays. Maintenant, on pourra peut-être faire plus. » En avril, cinq jeunes étaient tués dans un stade de Barawa, dans une explosion attribuée aux Chabab. Pourtant, le sage Sufi reste optimiste. « Je dis toujours que tout a un début et une fin. Avec le temps, ça aussi, ça prendra fin. » La compétition, elle, se termine le 10 juin. Après son 4-0, Barawa a fini premier de son groupe, devant l’île de Man, à la surprise générale. Prochain rendez-vous : Chypre Nord, en quarts de finale.