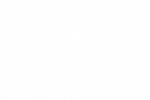Reprise : « Simone Barbès ou la vertu », l’amour à la dérive dans un Paris interlope

Reprise : « Simone Barbès ou la vertu », l’amour à la dérive dans un Paris interlope
Par Mathieu Macheret
Sorti en 1980, le film de Marie-Claude Treilhou montre la détérioration de la libération sexuelle dans l’individualisme.
Où était donc passée Simone Barbès depuis tout ce temps ? Longtemps resté invisible, hormis sur de piètres copies pirates ou lors de rediffusions hasardeuses à la télévision, le premier long-métrage de Marie-Claude Treilhou, sorti dans l’indifférence en février 1980, refait surface à la faveur d’une splendide restauration, qui rend à sa dérive noctambule tout son lustre équivoque et étincelant. Coup de maître d’un culot et d’une grâce infinis, le film apparaît comme l’un des chefs-d’œuvre oubliés du cinéma français, trait d’union possible entre le cinéma populaire d’avant-guerre et les conquêtes libertaires d’après la Nouvelle Vague. Il incarnerait même, rétrospectivement, ce que le progressisme appelle aujourd’hui de ses vœux : un contre-modèle soucieux des marginalités, des diversités sexuelles, écrit et tourné dans un élan fou par une jeune femme combative d’à peine 30 ans. Trente-huit ans plus tard, il n’a rien perdu de son bouillonnement existentiel ni de sa verve sentimentale.
Simone Barbès (Ingrid Bourgoin, comète fulgurante des années 1980) est une tige brune et incandescente, à la gouaille incendiaire, figure discrète de la nuit parisienne qu’on accompagne le temps d’une seule soirée, découpée en trois actes. Elle est ouvreuse dans un cinéma porno du quartier Montparnasse, où transite tout un monde interlope. Postée dans le hall, aux côtés d’une collègue chagrine, elle décrit toujours le même manège d’accueil et d’orientation des clients, virant et revirant de bord entre sa chaise et le radiateur, faisant claquer ses hauts talons sur le sol. Clientèle masculine furtive, qui dépose au passage des fragments d’histoires personnelles, complaintes, plaisanteries, regrets ou confidences. Le tout entrecoupé par les battements des portes, laissant filtrer le funk humide et les gémissements outrés des bandes-son pornographiques. Simone se tient au carrefour de toutes ces trajectoires, héroïne insaisissable, car traversée par les récits des autres et dissimulée en quelque sorte derrière eux.
Un théâtre des solitudes
Dans cet espace clos, Marie-Claude Treilhou construit avec une économie de moyens (changements d’axes précis et travellings raffinés) une éblouissante scénographie de circulations et de paroles télescopées. Le film fourmille de seconds rôles inoubliables, qui parviennent tous à exister le temps d’une scène, d’un passage, d’un mot lancé ou d’une gestuelle silencieuse. Théâtre des solitudes désirantes, qui se renverse, lors du deuxième acte, en son double féminin : une boîte lesbienne où Simone se rend après le travail, pour retrouver celle qu’elle aime, une serveuse qui la mène en bateau. Autour d’elle accoudée au bar, c’est une nouvelle ronde qui reprend de plus belle, entre les allées et venues des entraîneuses, les ritournelles tristes d’un orchestre de garçonnes décrépies, les performances d’une chanteuse punk-rock (Josse, du groupe 12°5) ou d’amazones s’affrontant sur un remix de Moussorgski… Simone patiente et voilà toute son histoire, banale et déchirante : elle se languit d’amour, elle attend, seule dans la nuit fluorescente. Et l’on n’aura pas besoin d’en savoir plus, pour surprendre dans son regard l’essentiel : le lent progrès de la lassitude et de la désillusion sur la soif de vivre.
Tourné à la toute fin de 1979, sur la brèche de la décennie suivante, Simone Barbès ou la vertu rendait ainsi visible des lieux et des milieux que le cinéma ignorait, et captait avec une acuité sidérante la bascule de son époque. Ce moment de déshérence amoureuse, où les promesses de la liberté sexuelle se détérioraient dans l’essor galopant de l’individualisme, livrant les êtres à un isolement toujours plus grand. Ici, les désirs aveugles se bousculent, empiètent les uns sur les autres sans jamais se rencontrer. Simone est l’image de cela, de l’irritation du désir, de la fatigue d’aimer dans le vide. Mais son élégance suprême est de ne jamais le dire ouvertement, sinon par le truchement de ses échanges éparpillés avec les autres. Des conversations banales, des paroles en l’air. Car parler de tout et de rien – d’une cuisinière à vendre, du bistrot d’en face –, c’est mesurer en même temps le gouffre béant de l’existence, les manques cruels et les insatisfactions qui la tiraillent.
Le film subjugue par sa concision toute racinienne (un barman y déclame d’ailleurs quelques vers de Phèdre dans le brouhaha ambiant) et sa complexité de détails, chaque scène ouvrant sur une sorte de chaos sentimental. Simone traverse ce désordre dans un halo de couleurs saturées et glaciales, éclairages au néon striant son parcours d’une rumeur synthétique.
Reste un dernier acte, sommet émotionnel inégalé, car donnant lieu à l’une des plus belles rencontres de cinéma : celle de l’héroïne, marchant seule dans la rue déserte, et d’un automobiliste, joué par Michel Delahaye (à l’apogée de sa sensibilité hallucinée), qui lui propose de la reconduire chez elle. On n’en dira pas plus, sinon que s’ensuivent quinze minutes bouleversantes, celles d’une virée nocturne filmée in extenso et comme en apesanteur par le chef opérateur Jean-Yves Escoffier. Deux regards perdus, saisis derrière un pare-brise embué, se frottent l’un à l’autre, se réchauffent tout en filant dans l’obscurité, jusqu’aux limbes d’un Paris endormi, jusqu’aux frontières de l’aube. Moment suspendu où Simone se libère de la comédie du désir et côtoie enfin l’éternité.
Simone Barbes Ou La Vertu : "maintenant, c'est du rock, va falloir remuer votre cul"
Durée : 00:31
Film français de Marie-Claude Treilhou (1980). Avec Ingrid Bourgoin, Martine Simonet, Michel Delahaye (1 h 16). Sur le Web : www.legrandaction.com
Trois films frondeurs de Diagonale
Simone Barbès ou la vertu (1980) ressort en salle avec deux autres longs-métrages, Les Belles Manières (1979) et Beau temps mais orageux en fin de journée (1985), dans un programme intitulé « L’expérience Diagonale ». Diagonale, maison de production fondée en 1976 par le réalisateur Paul Vecchiali, a réuni sous son toit une petite famille de cinéastes singuliers (mais aussi d’acteurs et de techniciens), auteurs d’une constellation de films à la fois sensibles et frondeurs, restés largement méconnus. Les Belles Manières, premier film de Jean-Claude Guiguet (1948-2005), dépeint l’insidieux rapport de classe entre une grande bourgeoise divorcée et son jeune employé de maison. Plus rare encore, Beau temps…, de Gérard Frot-Coutaz (1951-1992), visite le quotidien étriqué d’un vieux couple de Bellevillois (Micheline Presle et Claude Piéplu) à la façon d’un petit théâtre boulevardier et névrotique. Deux films venus de cinéastes disparus trop tôt.