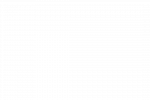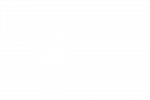Au Rwanda, une « révolution verte » à marche forcée

Au Rwanda, une « révolution verte » à marche forcée
Par Ghalia Kadiri (Districts de Rutsiro et de Nyanza (Rwanda), envoyée spéciale)
Semences, intrants, quotas… Depuis dix ans, l’Etat encadre de près l’agriculture pour augmenter les rendements, au risque de fragiliser les paysans les plus pauvres.
Un champ de maïs dans les plaines de Busasamana, dans le sud du Rwanda, en mai 2018. / Ghalia Kadiri
Face aux eaux bleutées et paisibles du lac Kivu, les collines sculptées en terrasses paraissent inertes, presque inanimées. Là-haut pourtant, des machines tournent à plein régime. Les sols volcaniques du district de Rutsiro, dans l’ouest du Rwanda, servent à cultiver du café arabica, qui remplira des tasses à Londres ou à New York. « Il y a vingt ans, on ne produisait même pas dix tonnes par an. L’année dernière, on était à 1 500 », se félicite Gervais Kayitare, directeur technique de la coopérative Kopakama, créée en 1998, quatre ans après le génocide des Tutsi qui a fait 800 000 morts selon l’ONU. « A l’époque, toutes les plantations de café avaient été détruites. Il a fallu repartir de zéro. »
Incités par le gouvernement à réunir leurs microparcelles familiales pour augmenter leurs rendements, les 48 petits fermiers qui vivaient auparavant avec moins de 5 euros par mois sont devenus des hommes et des femmes d’affaires. « Nous exportons au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Notre café est labellisé “commerce équitable” et nous visons la certification biologique », ajoute fièrement M. Kayitare.
Aujourd’hui, la coopérative compte près de 700 membres. Grâce aux subventions de l’Etat et du Fonds international de développement agricole (IFAD), une agence onusienne, Kopakama s’est dotée de deux unités de lavage de café, dont les machines atteignent une capacité de 120 kilos par heure. « Nous pouvons produire du café de qualité, aux normes et en masse, puis négocier les prix sur le marché international », se réjouit un membre du comité de direction. Depuis quelques années, l’eau utilisée pour laver le café est recyclée afin d’alimenter l’électricité des villages alentour. « L’objectif est de faire profiter tout le district de cette réussite », affirme le directeur technique.
Pression foncière
Kopakama est l’une des « success stories » que le gouvernement et les bailleurs de fonds, Etats-Unis en tête, aiment mettre en avant. Depuis une dizaine d’années, le Rwanda joue à plein son rôle d’élève assidu de la « révolution verte » initiée à marche forcée par son président, Paul Kagame, et soutenue par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). L’Etat s’est fixé pour objectif de maximiser la production agraire à travers des cultures de rente, de commercialiser et de moderniser l’agriculture, alors qu’au moins 37 % des enfants rwandais de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique, d’après les chiffres officiels.
Un projet ambitieux dans ce petit pays vallonné d’Afrique centrale, où la densité de peuplement est la plus élevée du continent (500 habitants par km2) et qui devrait voir sa population de 12 millions d’habitants doubler d’ici à trente ans. Son enclavement dans la région des Grands Lacs et son relief accidenté, déjà soumis aux problèmes d’érosion et aux risques de sécheresse et d’inondations, aggravent la pression foncière, qui n’est pas étrangère au génocide de 1994. Avec en moyenne 0,7 hectare par famille, 70 % des paysans cultivent à peine de quoi se nourrir.
En 2007, un programme d’intensification visant à prioriser six cultures (maïs, blé, manioc, haricots, pommes de terre et riz) destinées à la commercialisation et à l’exportation a été imposé aux agriculteurs. A travers le pays, des marais jusqu’aux montagnes, l’Etat a aménagé les terrains en terrasses, des haies ont été plantées pour lutter contre l’érosion, des digues retiennent désormais l’eau pour irriguer les parcelles menacées par la sécheresse, en particulier dans l’est du pays.
Sur les routes sinueuses traversant les « milles collines » qui ont donné son surnom au pays, on reconnaît la présence des autorités aux pancartes affichant « RAB » à l’entrée des fermes : le Rwanda Agriculture Board, dont les agronomes et autres techniciens du gouvernement ont été dépêchés dans les campagnes pour former les paysans, fournir des intrants subventionnés et fixer les quotas de production.
Chenilles légionnaires
Il y a un an, dans les plaines de Busasamana, tout près de la frontière burundaise, les champs de maïs ont été envahis par des chenilles légionnaires d’automne, un insecte ravageur qui s’attaque principalement au maïs. « Les plantes étaient trouées, la moitié de la culture était détruite. Et comme on nous a obligés à planter uniquement du maïs, c’était foutu, raconte Callixte, un fermier de 50 ans, père de cinq enfants. Nous avons beaucoup souffert : je n’avais plus de quoi payer la mutuelle ni les fournitures et les uniformes scolaires de mes enfants. » La survie de sa famille, leur régime alimentaire, l’accès à la santé et à l’éducation… Tout dépend des bénéfices qu’il récolte à la fin de la saison. En moyenne, 40 euros tous les quatre mois. Quand on lui demande s’il achète de la viande, Callixte éclate de rire : « J’achète du poulet une fois par an. Des œufs, de temps en temps. »
« Lorsque nous avons trouvé les insectes, nous avons immédiatement informé les autorités. » Callixte a reçu la visite d’un agronome envoyé par le RAB et des experts de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui lui ont fourni des pesticides, des pièges à insectes et des conseils. « La bataille a été rude mais nous avons pu sauver les nouvelles récoltes », soupire le fermier. « Il y a de réels progrès en termes de productivité. Mais à force de planter la même espèce, les sols se sont appauvris et les productions sont devenues plus sensibles au changement climatique, aux maladies, aux parasites… », analyse An Ansoms, professeure à l’Université catholique de Louvain, en Belgique.
En imposant des monocultures spécifiques, le gouvernement rwandais a aussi installé une dépendance vis-à-vis des engrais chimiques, des semences améliorées et des pesticides. « Les techniques d’innovation encouragées par l’Etat ont changé la composition des sols, qui sont devenus dépendants des fertilisants », poursuit la chercheuse. Or, même s’ils sont en partie subventionnés, les intrants chimiques restent trop chers pour les petits exploitants, contraints de s’endetter ou de vendre leur terre. Certaines semences financées à moitié par l’Etat ne sont accessibles qu’aux agriculteurs possédant au moins un hectare, très rares au Rwanda, ou enregistrés dans une coopérative. Mais là encore, les frais d’admission, peu élevés mais obligatoires, restent trop élevés pour les paysans les plus pauvres.
Avant le programme d’intensification des cultures et la consolidation des terres, les petits producteurs avaient l’habitude de planter en moyenne huit variétés différentes, afin de minimiser les risques de perte et assurer leur sécurité alimentaire. Paradoxalement, si les paysans gagnent plus aujourd’hui, ils ne parviennent plus à se nourrir comme avant. « Leur marge de négociation des prix est limitée. Ce sont plutôt les commerçants intermédiaires qui profitent le plus de ces chaînes de commercialisation, déplore An Ansoms. En même temps, les paysans sont confrontés à une forte inflation sur les produits qui ne sont plus cultivés localement. Tout ceci affecte négativement la sécurité alimentaire, surtout pour les fermiers opérant à petite échelle. »
Filières informelles
Face aux prix imposés par des grands commerçants « la plupart du temps bien connectés au FPR [Front patriotique rwandais, au pouvoir] », selon un observateur avisé, des filières informelles se sont développées : des camions de marchandise roulent la nuit en direction de la République démocratique du Congo (RDC) voisine, pour vendre les produits à un tarif plus intéressant. « C’est extrêmement dangereux, continue la même source. Surtout que les campagnes sont étroitement surveillées : les agents sont partout et l’organisation en coopérative permet de mieux contrôler ce qui se fait dans les fermes. »
Que se passe-t-il quand les agriculteurs ne peuvent pas se conformer au système ? « Au mieux une amende, au pire la prison, confie une source bien informée. Si un fermier plante une culture différente de celle imposée par l’agronome du district, l’armée ou la police peut détruire toute la plantation. » La loi de 2005 sur le régime foncier autorise par ailleurs le gouvernement à exproprier « pour cause d’utilité publique », avec une compensation pas toujours à la hauteur. « Certains ont peur que le gouvernement leur confisque leur terre et la redistribue s’ils ne sont pas assez productifs ou pas conformes aux nouvelles règles », souligne Neil Dawson, professeur à l’université d’East Anglia, au Royaume-Uni. Cette angoisse obsède les Rwandais, traditionnellement très attachés à leur terre, bien souvent le seul héritage qu’ils ont à transmettre à leurs enfants.
« Ces politiques agricoles sont largement saluées, car elles augmentent les revenus de certains. Mais sans une aide ciblée pour les plus pauvres ou une évaluation de leurs impacts, elles peuvent facilement devenir l’antithèse de la lutte contre la pauvreté », met en garde M. Dawson, auteur d’une étude sur les limites de la « révolution verte ». La chercheuse An Ansoms nuance : « Les autorités sont de plus en plus ouvertes à des discussions au sujet les failles du système. On peut remettre en cause la légitimité d’une décision provenant d’une autorité décentralisée. Toutefois, le modèle en tant que tel reste indiscutable. »
En dehors de Kigali, où le secteur des services se développe, il est très difficile de trouver une alternative. Sur la rive rwandaise du lac Kivu, Paul (le prénom a été modifié), 32 ans, a trouvé du travail dans les plantations de café de la coopérative Kopakama. Comme lui, les paysans privés de terre se tournent vers des emplois saisonniers dans les grandes fermes de la région. Sous sa casquette retournée, il sue à grosses gouttes. Depuis deux ans, chaque fois que la saison le permet, il trie à la main les graines de café sur les tables de pré-séchage, sous un soleil de plomb. « J’ai du travail mais le salaire reste insuffisant et je ne gagne pas les dividendes de la coopérative », dit-il. Avec l’équivalent de 7 euros par semaine, il peine à nourrir sa famille. « Au Rwanda, quand tu n’as pas de terre, tu n’es rien. »