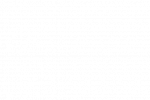Réussite en licence : « Le passé scolaire joue plus que l’origine sociale »

Réussite en licence : « Le passé scolaire joue plus que l’origine sociale »
Propos recueillis par Séverin Graveleau
Une étude montre que les étudiants qui échouent en licence à l’université sont souvent d’anciens élèves aux acquis fragiles en 6e.
L’étude de l’Insee analyse le devenir, dix ans après, d’une cohorte de 18 000 élèves entrés en classe de 6e en 1995. / DPA / Photononstop
Alors que le gouvernement a défendu sa réforme de l’accès à l’université par la volonté d’endiguer les « 60 % d’échec » en licence, une étude parue dans la revue Economie et statistique de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) montre que cette réussite dépend en partie du niveau acquis à la fin de l’école primaire. Réalisée par les chercheurs Yaël Brinbaum (CNAM), Cédric Hugrée (Cresppa) et Tristan Poullaouec (CENS), celle-ci analyse le devenir, dix ans après, d’une cohorte de 18 000 élèves entrés en classe de 6e en 1995, et dont 8 000 ont débuté des études supérieures.
La réussite en licence est-elle corrélée au passé scolaire de l’étudiant ou à ses origines sociales ?
Cédric Hugrée : Dans notre cohorte de bacheliers, 71 % des enfants de cadres ou de professions intermédiaires obtiennent une licence, contre 52 % d’enfants d’ouvriers. Et à milieu comparable, les enfants d’immigrés l’obtiennent aussi moins. Il y a donc bien un impact des origines sociales et migratoires.
Mais ce qui est intéressant, c’est de remonter le passé scolaire de ces étudiants. On sait que les bacheliers généraux obtiennent majoritairement la licence, contrairement aux bacheliers professionnels ou technologiques. Mais la réussite en licence diffère aussi au sein des bacheliers généraux, selon leurs parcours au collège et au lycée, et leur mention, etc. Le fait d’avoir redoublé au collège ou au lycée a clairement un impact.
De fil en aiguille, on remonte jusqu’aux évaluations des élèves à l’entrée en 6e en mathématiques et français. Et là, on s’aperçoit que les étudiants dont les résultats étaient faibles en fin de primaire sont certes peu nombreux à être parvenus jusqu’à l’université, mais quand c’est le cas, ils ont beaucoup moins souvent obtenu la licence.
Autrement dit : les étudiants qui échouent à décrocher une licence sont beaucoup plus souvent des élèves aux acquis scolaires les plus fragiles… qui se trouvent rarement appartenir aux classes moyennes et supérieures.
Tout est donc joué à 11 ans ? Est-ce à dire que l’origine sociale ne joue plus dans l’enseignement supérieur ?
Tristan Poullaouec : L’obtention de la licence dépend à la fois du passé social et du passé scolaire. Mais lorsqu’on essaie de mesurer les effets en isolant un seul paramètre, on voit que c’est le passé scolaire qui joue le plus. Comme le montre le graphique ci-dessous, ce n’est pas le fait de venir d’un milieu plus populaire qui fait que l’on obtient ou non sa licence, mais plutôt le type de bac, le fait de l’avoir décroché « à l’heure », d’avoir eu une mention ou non, etc.
Obtention d’une licence selon le type de bachelier et l’origine sociale / MEN‑DEPP / Economie et statistique
Les origines sociales jouent d’abord en amont, avant la sixième, surtout pour les enfants des familles populaires. L’école française échoue donc à transmettre équitablement les savoirs scolaires, mais pire, elle aggrave ces inégalités au fil du temps, comme d’autres enquêtes l’ont déjà montré. Nous en avons une confirmation quand on observe les titulaires d’une licence.
Notre étude permet ainsi d’éclairer le système scolaire français : du haut de la pyramide scolaire, depuis la licence, niveau auquel la France voudrait diplômer 50 % d’une génération, nous montrons sous un nouveau jour l’importance des apprentissages à l’école primaire et leurs conséquences sur le temps long pour les élèves. La démocratisation de l’enseignement supérieur passe donc par la lutte contre les inégalités scolaires à l’école primaire.
Votre étude identifie cinq parcours types des licenciés de l’université. Quels sont-ils ?
C. H. : Parmi les étudiants ayant obtenu la licence, les parcours « honorables » sont les plus fréquents, avec un tiers de licenciés concernés. Ce sont souvent des bacheliers généraux « à l’heure » au moment du bac, et avec de bons résultats aux évaluations de sixième, majoritairement des filles.
Viennent ensuite les étudiants « de l’entre-deux universitaire » (31 % des licenciés). Ni excellents, ni faibles, ce sont aussi des bacs généraux, mais avec des petits ratés scolaires (redoublement par exemple), avec notamment des étudiants issus des fractions supérieures des classes populaires.
On trouve ensuite les « rescapés » de l’enseignement technologique et professionnel (21 % des licenciés). En majorité titulaires d’une licence professionnelle, ils ont un bac technologique et dans une moindre mesure un bac professionnel. Ils ont eu un parcours scolaire moyen et travaillent souvent en parallèle de leurs études et sont plutôt issus des classes populaires.
Viennent ensuite les « héritiers » (8 % des licenciés), avec un excellent parcours scolaire, puis enfin ceux avec un parcours fragile et heurté dans le secondaire (6 %).
La ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a défendu sa réforme de l’accès à l’université par, entre autres, la nécessité de lutter contre les « 60 % d’échec » en première année de licence. Qu’en dit votre étude ?
T. P. : Parmi les étudiants de notre cohorte, on s’aperçoit que la moitié de ceux qui n’ont pas obtenu leur licence (L1) ne décrochera aucun diplôme de l’enseignement supérieur. On peut donc dire que 50 % des autres se sont réorientés avec succès.
Mais ces réorientations efficaces sont une fois encore différenciées selon le type de bac. Alors que les trois quarts de ces décrocheurs titulaires d’un bac général ont finalement obtenu un diplôme du supérieur, ce n’est le cas que pour 40 % des bacheliers généraux sans mention et seulement 31 % des bacheliers professionnels et technologiques.
Là encore, ces inégalités scolaires étaient en partie déjà présentes à l’entrée de la sixième. Il n’est donc plus possible de se poser la question de la réussite en licence du seul point de vue de l’accès ou non à l’université. Et on en revient à l’école française qui doit régler ses problèmes autour de l’apprentissage des savoirs élémentaires de la culture écrite…
Quels leviers pour améliorer cet apprentissage des savoirs fondamentaux alors ?
T. P. : Quand on voit que les acquis de fin de primaire pèsent encore jusqu’à la licence pour certains jeunes, la question à se poser est : « Qu’est-ce que l’école fait pour ces élèves qui ne bénéficient pas d’une transmission familiale de la culture écrite ? »
Dans le contenu des enseignements, comme dans la formation des enseignants, on suppose trop souvent que les élèves des classes populaires n’ont pas les ressources pour manier l’abstraction, le raisonnement logique et la réflexivité. Or, seule une pédagogie de l’exigence intellectuelle « s’obligeant à tout en faveur de tous » (Bourdieu) peut démocratiser la réussite…
C. H. : De ce point de vue, on a toujours du mal à comprendre pourquoi nos étudiants de licence à l’université reçoivent moins d’heures de cours que ceux de la moindre classe préparatoire aux grandes écoles ! Plus largement, depuis de longues années maintenant, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et les études récurrentes du ministère de l’éducation nationale montrent les difficultés de la France à transmettre également les savoirs scolaires, et finalement à faire « école commune » pour toutes et tous. Mais, contrairement à d’autres pays de l’OCDE, on a l’étrange sentiment que le « choc PISA » n’a pas encore vraiment eu lieu en France. L’expérience montre pourtant qu’une bonne entrée dans les savoirs élémentaires annule quasiment le désavantage des étudiants issus des classes populaires.