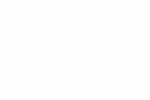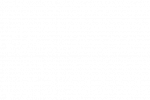Erdogan réélu, les Turcs face à l’« hyper-présidence »

Erdogan réélu, les Turcs face à l’« hyper-présidence »
Editorial. Vainqueur de la présidentielle en Turquie avec 52,5 % des voix, Recep Tayyip Erdogan concentre désormais la totalité du pouvoir exécutif et reste plus que jamais, pour une majorité de ses concitoyens, le « Reis ».
Editorial du « Monde ». Recep Tayyip Erdogan a gagné son pari. Sa réélection à la tête de la Turquie, dimanche 24 juin, fait de lui le dirigeant le plus puissant depuis le fondateur de la République, Mustafa Kemal.
Une situation qui tranche avec la manière dont il a été élu. Même s’il a réussi à éviter une mise en ballottage, qui aurait représenté un camouflet politique, sa victoire n’a pas été « une promenade de santé », comme il l’avait lui-même anticipé. La mobilisation de tous les rouages de l’administration, tous les réseaux de l’AKP, le parti islamo-conservateur, devenu un parti-Etat, a permis d’éviter une « mauvaise surprise », alors que les sondages le montraient à la peine face à la percée du candidat de la gauche kémaliste, Muharrem Ince.
Au pouvoir depuis quinze ans, d’abord comme premier ministre, puis comme président, M. Erdogan remporte 52,5 % des suffrages, un score légèrement supérieur à celui de l’élection présidentielle de 2014 et à celui du référendum d’avril 2017 instaurant un régime présidentiel. Celui-ci avait été marqué par de nombreuses irrégularités dénoncées par les observateurs internationaux.
Une nouvelle fois, ceux-ci ont critiqué l’iniquité de la campagne au cours de laquelle les grands médias, en quasi-totalité contrôlés par le pouvoir, n’ont guère laissé de place à l’opposition, à commencer par Selahattin Demirtas, du parti prokurde HDP, qui a été contraint de mener campagne depuis sa cellule.
Pour une majorité de Turcs, M. Erdogan reste plus que jamais le « reis », le chef, et nombre d’entre eux approuvent sa dérive autoritaire toujours plus affirmée. Depuis 2002 son parti a gagné toutes les élections, sauf les législatives de juin 2015. D’où son hubris, convaincu qu’il est d’avoir été désigné par Dieu pour remettre la Turquie dans la voie de l’islam et lui rendre sa grandeur passée.
Le chef de l’Etat peut arguer de son bilan. Le PIB par habitant a triplé depuis son arrivée au pouvoir, même si la dette a explosé dans les mêmes proportions. En outre, la Turquie est devenue un acteur majeur sur la scène régionale, malgré son échec syrien, et il joue du nationalisme d’une bonne partie de la population comme de ses nostalgies de grandeur ottomane.
Une alarmante radicalisation de l’électorat
Il incarne un bloc religieux conservateur, sunnite et turc, majoritaire au sein de la population, attisant la haine contre les autres : les laïcs, les alévis, courant hétérodoxe issu du chiisme, et les Kurdes. Ces élections permettent à l’AKP d’asseoir sa majorité à la Chambre, grâce à son allié de l’extrême droite nationaliste, le MHP. Celui-ci réalise le même score qu’en 2015, malgré la scission d’une bonne partie de sa base, qui a rejoint Le Bon Parti. Ce dernier, en séduisant les déçus de l’AKP, illustre une alarmante radicalisation de l’électorat.
Pendant des années, M. Erdogan a représenté à l’extérieur du pays un gage de stabilité. Mais ses volte-face, ses brouilles avec l’Europe et sa fuite en avant dans la répression depuis le coup d’Etat raté de juillet 2016, ne cessent d’inquiéter. La monnaie turque dévisse et le risque de retournement de l’économie ainsi que la grogne sociale ont été des facteurs qui l’ont incité à appeler les Turcs aux urnes un an avant la date prévue.
Cet obstacle franchi, M. Erdogan devient un « hyperprésident » concentrant la totalité du pouvoir exécutif. Une grande partie de la société civile turque a jusqu’ici su résister avec une grande maturité. Ce renforcement du régime autocratique constitue pour elle un nouveau défi.