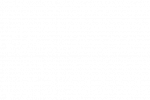Malgré le stress, la pauvreté et des conduites à risques, les étudiants se déclarent en bonne santé

Malgré le stress, la pauvreté et des conduites à risques, les étudiants se déclarent en bonne santé
Par Eric Nunès
Sexualité, alcool, usage des écrans… Si les étudiants conservent des comportements à risque, selon l’enquête de la Smerep, 84 % s’estiment être en bonne santé.
Soirée d'intégration entre étudiants de l'Institut de commerce de Paris (ISC), en 2011. / Jiri Matousek (CC BY 2.0)
Stress, addiction au numérique, sexualité à risque et méconnaissance des risques liés au sida… la mutuelle étudiante Smerep souligne, dans son enquête annuelle, les failles dans les pratiques et les croyances des étudiants en matière de santé.
Comment joindre les deux bouts quand on dispose de 382 euros par mois pour vivre ? Selon cette étude, c’est cet exploit mensuel que doivent réaliser de nombreux étudiants. C’est en effet le budget moyen dont dispose la population estudiantine pour se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner et avoir une vie sociale, alors que le seuil de pauvreté est fixé par l’Insee à 1 015 euros.
Les étudiants ne sont pas moins démunis que l’an passé, lorsque le budget moyen était de 379 euros. Selon la Smerep, leur paupérisation a été progressive : « L’érosion du revenu moyen ne cesse depuis 2007. Il était alors de 470 euros. » Les étudiants ont peu d’argent et pourtant, 47 % ont aujourd’hui, parallèlement à leurs études, un travail ; 25 % y consacrent d’ailleurs plus de seize heures par semaine ; sans surprise, 52 % des étudiants déclarent « avoir rencontré des difficultés financières ».
Avec un budget si contraint, la majorité d’entre eux (56 %) vivent chez leurs parents ou un membre de leur famille et la plus importante partie de leur budget est consacrée à… se nourrir (26 %). Le logement ponctionne en moyenne 20 % de leurs revenus, les sorties 17 %. Les dépenses de santé des étudiants sont d’environ 11 euros par mois. Une somme très faible mais logique si l’on considère que les étudiants sont en bonne santé. Or, ils sont 84 % à se déclarer comme tel, en hausse de quatre points par rapport à l’enquête 2017, tandis qu’aucun ne fait état d’une mauvaise santé. Toutefois, en cas de besoin, 57 % « attendent que ça passe » (sans consulter) et 42 % choisissent l’automédication. Enfin, pour 65 % de ceux qui franchissent la porte d’un médecin, ce sont les parents qui payent.
L’usage des préservatifs en baisse
En matière de prévention, certaines pratiques, pourtant essentielles, tendent à être oubliées. En 2016, l’étude de la Smerep soulignait que seulement 57 % des étudiants utilisaient systématiquement un préservatif lors d’un rapport sexuel. Le chiffre passait à 54 % en 2017 et il diminue encore cette année, à 52 %. La grande majorité (83 %) des étudiants et étudiantes qui sont fâché·e·s avec l’usage du latex comme moyen de prévention le jugent inutile, car ils ont un partenaire stable. Mais parallèlement, ils ne sont que 35 % à se faire dépister contre le sida et autres maladies sexuellement transmissibles lorsqu’ils changent de partenaire.
Comment le sida se transmet-il ? Par des relations sexuelles non protégées, répondent 93 % des étudiants. Vrai ! Mais ils sont 32 % à avoir de fausses croyances, en hausse de deux points : 15 % pensent que le virus peut se transmettre par une piqûre de moustique ; 6 % en embrassant une personne séropositive ; 4 % en buvant dans son verre ; 11 % croient même qu’aujourd’hui « l’on guérit facilement du sida ».
Une sexualité non protégée, c’est prendre le risque de contracter une maladie sexuellement transmissible, et/ou pour une femme, de se retrouver enceinte. Mais l’usage de la pilule contraceptive chez les jeunes femmes est presque stable : elles étaient 60 % à déclarer la prendre en 2017, elles sont 58 % en 2018. Toutefois, 31 % des étudiantes qui ont « déjà eu des rapports sexuels ne prennent pas la pilule ». En conséquence il est possible d’y voir une explication de la hausse du recours à la contraception d’urgence : en 2015, 28 % des étudiantes avaient utilisé une « pilule du lendemain » ; trois ans plus tard, c’est le cas de 39 % d’entre elles, soit un bond de 11 %.
L’étude montre que globalement, les étudiants sont plutôt heureux : 78 % se disent satisfaits de leur vie. Ils dorment en moyenne de six à huit heures par nuit en semaine et s’autorisent plus en fin de semaine. Ce qui n’empêche pas certains moments de stress, d’angoisse, qui ponctuent leur parcours : 91 % reconnaissent une période de stress au cours de l’année et particulièrement lors des périodes d’examens. Les choix d’orientation, la recherche de stage et la vie affective sont également des sources de mal-être, au point que 60 % se sont déjà sentis « dépassés, submergés par leur quotidien » ; 22 % d’entre eux déclarent même avoir eu des « pensées suicidaires ».
Surutilisation des smartphones
Il existe, semble-t-il, un moyen simple de faire : 82 % des étudiants ont déjà bu de l’alcool et 70 % ont ressenti les effets d’une consommation excessive, parmi lesquels l’euphorie, mais aussi les nausées, vomissements, trou noir, agressivité, coma éthylique… Quand on leur demande pourquoi ils boivent de l’alcool, parfois excessivement, ils répondent à 55 % pour « relâcher la pression, décompresser », puis pour être « plus à l’aise » (33 %), ressentir le plaisir de l’ivresse (21 %). Par ailleurs, 28 % d’entre eux déclarent avoir consommé de la drogue, cannabis en tête (20 %), mais aussi du poppers (7 %), gaz hilarant (6 %), extasy (3 %), cocaïne (2 %).
Un autre usage excessif peut avoir des conséquences fâcheuses sur la santé de ces jeunes, leur capacité de concentration et leur sommeil : une surutilisation de leur smartphone. 20 % y consacrent plus de six heures par jour, 70 % le consultent quelques minutes seulement après le réveil ; 40 % se sentent « incapables de se passer de leur téléphone pendant une journée ». Pour ces étudiants, le smartphone est devenu « une extension de soi dont les étudiants ont conscience des incidences sur leur vie », analyse Hadrien Le Roux, président de la Smerep. La « santé numérique » des étudiants deviendrait une source de préoccupation en termes de santé publique. « Il faut en prendre conscience », alerte le mutualiste.
Méthodologie de l’enquête : cette étude a été réalisée par Opinionway auprès d’un échantillon de 1 001 étudiants de 16 ans et plus, interrogé en ligne du 19 avril au 21 mai.