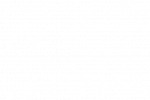Pour son investiture, Erdogan promet « une nouvelle ère » et enterre la République d’Atatürk
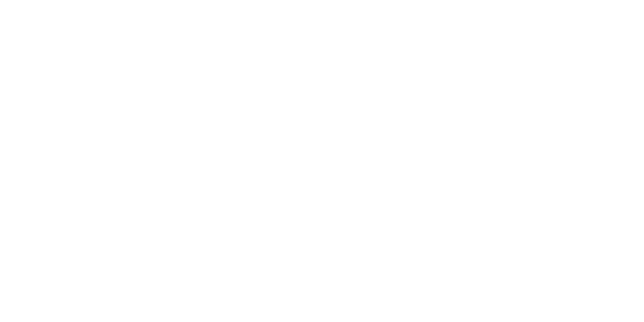
Pour son investiture, Erdogan promet « une nouvelle ère » et enterre la République d’Atatürk
Par Marie Jégo (Istanbul, correspondante)
Le président turc a prêté serment, lundi, pour un nouveau mandat de cinq ans aux pouvoirs renforcés.
Convaincu d’ouvrir « une nouvelle ère » dans l’histoire de la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a prêté serment, lundi 9 juillet, devant le parlement à Ankara. Aux manettes du pays depuis 2003, d’abord en tant que premier ministre puis comme président, M. Erdogan, 64 ans, a été réélu pour un nouveau mandat de cinq ans aux pouvoirs renforcés le 24 juin, au terme d’une élection présidentielle remportée dès le premier tour avec 52,5 % des voix.
Accompagné de son épouse Emine, M. Erdogan a ensuite effectué une visite au mausolée de Mustafa Kemal (dit Atatürk, fondateur de la Turquie moderne et républicaine, 1881-1938) avant de présider une cérémonie digne d’un couronnement en son immense palais de Bestepe, à la périphérie d’Ankara, où dix mille invités avaient été conviés.
Une vingtaine de dirigeants étrangers étaient présents, parmi lesquels le président du Venezuela Nicolas Maduro, le numéro un soudanais Omar Al-Bachir, les premiers ministres hongrois Viktor Orban et russe Dmitri Medvedev. L’Union européenne était représentée par Dmitris Avramopoulos, commissaire en charge des politiques migratoires. Pour immortaliser l’événement, chaque personne présente à la cérémonie a reçu un exemplaire d’une nouvelle pièce de monnaie à l’effigie du palais et datée du 9 juillet.
Salué par des applaudissements, le couple présidentiel, lui en costume sombre, elle revêtue d’un long cafetan noir et banc, a pénétré dans le jardin du Palais sous la vigilance d’une double haie de gardes en costumes d’époque, hallebardes en main, comme tout droit sortis de la série télévisée adulée des Turcs, Dirilis Ertugrul, consacrée à la gloire de l’empire ottoman.
Fermer « la parenthèse du kémalisme »
Dans son allocution, M. Erdogan a promis « de donner au pays un nouvel aspect après 95 ans d’existence de la République », dessinant une « Turquie forte », vouée à devenir d’ici 2023 « l’une des dix premières puissances mondiales », promettant « la démocratie ». La « parenthèse » de la République créée en 1923 par Atatürk a été définitivement fermée. « Le système qui a coûté si cher au pays, en raison du chaos politique, social et économique qu’il a suscité par le passé, est désormais derrière nous », s’est félicité l’homme fort d’Ankara.
Fermer « la parenthèse du kémalisme », est le vœu le plus ardent de l’élite islamo-conservatrice au pouvoir depuis 2002. Les tenants de l’islam politique en rêvaient, M. Erdogan l’a fait.
Il le fallait, tant aux yeux des militants du Parti de la Justice et du développement (AKP), créé par M. Erdogan et quelques compagnons de route en 2001, le projet modernisateur d’Atatürk, le « Père » de la Turquie moderne, est usé. La laïcité, l’arrimage quasi exclusif du pays à l’Occident n’ont plus lieu d’être. A force de trop regarder vers l’Ouest, les Turcs ont été coupés de leur héritage ottoman et de leurs racines islamiques.
M. Erdogan promet une révolution. Il va façonner une tout autre Turquie, plus conservatrice, plus religieuse, dotée d’ambitions globales, capable de s’ériger en protectrice de l’islam sunnite.
L’« ère Erdogan » a ses symboles. Le chef de l’Etat a ainsi achevé son discours en faisant de la main le signe de la Rabia – pouce replié vers la paume, quatre doigts dressés. Ce geste servit de signe de ralliement à la confrérie des Frères musulmans lors du coup d’Etat de l’armée égyptienne contre le président islamiste Mohamed Morsi, à l’été 2013. Répétée à l’envi lors des discours, érigée en monument à Düzce (Sud), la Rabia représente la transformation identitaire islamo-nationaliste voulue par le reïs (« chef »).
Son gendre aux finances
Le nouveau gouvernement annoncé en soirée – 17 ministres contre 26 précédemment – sera-t-il à la hauteur des ambitions ? Conduit par M. Erdogan, il est placé sous le signe de la continuité car Mevlüt Cavusoglu (affaires étrangères), Süleyman Soylu (intérieur) et Abdulhamit Gül (justice) ont conservé leurs postes.
La politique étrangère reste sur les mêmes rails. La Turquie demeurera un partenaire difficile pour ses alliés occidentaux tant que le discours revanchiste, conspirationniste et anti-occidental restera le cri de ralliement des islamo-conservateurs, habiles à persuader le public que le coup d’Etat manqué attribué au prédicateur musulman Fethullah Gülen, installé aux Etats-Unis depuis 1999, a été fomenté par la CIA avec la bénédiction des Européens.
Les déboires actuels de l’économie (inflation à plus de 15 %, dépréciation de la monnaie locale -20 % depuis le début de 2018, déficit des comptes courants) sont quant à eux mis au compte du « lobby des taux d’intérêts », qui n’a qu’une idée en tête : mettre la Turquie à genoux. Selon un sondage publié en mai par le centre d’études de l’opinion XSights, un Turc sur cinq estime que cette explication est « plausible ».
Très attendue par les milieux d’affaires, la nomination du nouveau ministre des finances a malgré tout jeté un froid. Berat Albayrak, 44 ans, le gendre de M. Erdogan, connu pour ses vues économiques peu orthodoxes, a été choisi pour le poste.
Ministre de l’énergie dans le gouvernement sortant, l’époux de Esra, la fille aînée du président, est en pleine ascension. Décrit comme « l’héritier », ce barbu au visage poupin, qui ne quitte pas son beau-père d’une semelle, ne semble guère armé pour sortir le pays de l’ornière économique. Sa nomination a déplu aux investisseurs, comme en témoigne la chute de la livre turque (-3,5 % par rapport au dollar) survenue juste après l’annonce du nouveau gouvernement.