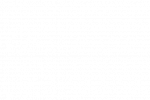Brexit : les ambiguïtés se dissipent

Brexit : les ambiguïtés se dissipent
Editorial. La démission de deux ministres du gouvernement May montre qu’après des mois d’ambiguïté et de compromis plus ou moins assumés, les positions sur la façon de prendre ses distances avec l’Europe semblent se décanter.
Des manifestants anti-Brexit, devant le Parlement de Londres, le 9 juillet. / Matt Dunham / AP
Editorial du « Monde » Certains départs peuvent signifier la fin d’une histoire ou le début d’une nouvelle. La démission en moins de vingt-quatre heures du ministre des affaires étrangères britannique, Boris Johnson, et celle du ministre responsable des négociations sur la sortie de l’Union européenne (UE), David Davis, pourraient bien appartenir à la seconde catégorie.
Tous deux affirment avoir voulu tirer les conséquences du virage pris par la première ministre, Theresa May, vers un Brexit en douceur, c’est-à-dire en faveur du maintien de liens étroits avec l’UE. Après des mois d’ambiguïté et de compromis plus ou moins assumés, les positions sur la façon de prendre ses distances avec l’Europe semblent enfin se décanter.
Depuis qu’elle occupe le 10 Downing Street, Mme May a déjà eu à affronter de nombreuses dissensions au sein de son camp. Avec les démissions de MM. Johnson et Davis, les 8 et 9 juillet, ce ne sont pas moins de onze de ses ministres qui ont déjà quitté, pour des raisons diverses, le gouvernement en l’espace de huit mois. Mais ce moment paroxystique peut avoir le mérite de clarifier la façon dont le Royaume-Uni souhaite mener son Brexit.
D’un côté, il y a les partisans d’un projet encore assez nébuleux d’une « Grande-Bretagne mondiale », incarné par MM. Johnson et Davis, qui prônent un modèle ouvert aux quatre vents du libre-échange, sorte de Singapour anglais, pratiquant le dumping social, fiscal et environnemental. D’un autre côté, les partisans d’une rupture « responsable et crédible », selon les mots de Mme May, répondant à la tentation d’un repli protectionniste, et voulue par une majorité d’électeurs britanniques, avec un pays restant arrimé au continent sur le plan économique.
La voie du pragmatisme
En claquant la porte, les deux ministres tranchent d’une certaine façon le problème. Leur Brexit « dur », un temps soutenu par Theresa May, a désormais du plomb dans l’aile. Face aux réalités économiques – ralentissement des investissements et menaces de délocalisations –, la première ministre, alertée par les milieux d’affaires, a finalement choisi la voie du pragmatisme en tentant de garder le maximum de liens possibles avec l’UE.
Pour autant, la partie est loin d’être gagnée pour elle. D’abord, elle reste à la merci d’un vote de défiance, même si les conservateurs britanniques qui seraient tentés par une telle aventure doivent y réfléchir à deux fois. A ce stade, il n’existe pas de majorité en faveur d’un Brexit « dur ».
Quant au champion de cette option, Boris Johnson, entre ses mensonges lors de la campagne du référendum de juin 2016 et son bilan calamiteux à la tête des affaires étrangères, sa crédibilité est largement entamée. Le scénario de l’arrivée au pouvoir du chef de l’opposition, le très à gauche Jeremy Corbyn, est également de nature à calmer les ardeurs des conservateurs les plus radicaux.
Maintenant, le plus dur reste à faire pour Theresa May : convaincre Bruxelles d’accorder au Royaume-Uni un accès privilégié au marché intérieur de l’UE. Or les Vingt-Sept sont farouchement opposés à l’idée d’une Europe à la carte, qui dissocierait la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux.
Si l’on peut espérer que la négociation se débloque, son issue reste très incertaine à moins de neuf mois de la date fatidique du 29 mars 2019, lorsque le divorce deviendra, théoriquement, réalité. Le problème avec les nouvelles histoires, c’est qu’on ne sait pas comment elles se terminent.