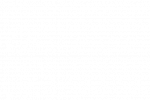« A Nairobi, les héroïnomanes de mon squat n’avaient jamais entendu parler de l’hépatite C »

« A Nairobi, les héroïnomanes de mon squat n’avaient jamais entendu parler de l’hépatite C »
Par Marion Douet (Nairobi, correspondance)
L’hépatite C, la grande oubliée (2). La maladie, qui se transmet par le sang, touche surtout les toxicomanes qui s’échangent du matériel d’injection contaminé.
C’était un matin de 2013, « juste après le premier shoot ». John Ndichu Muhia était avec une trentaine d’autres toxicomanes de son repaire quand une équipe de Médecins du monde (MDM) est arrivée. « On les a chassés », raconte le jeune homme cinq ans plus tard, assis sur le sol de ciment troué d’une petite clinique tenue par l’ONG français à Kangemi, un bidonville de Nairobi. Ses yeux sont encore tirés, pochés, et le rythme de sa voix cassée ralentit par moments, comme s’il était pris d’une extrême fatigue. Mais John, silhouette classique en jean et tee-shirt rouge, tient à raconter rigoureusement comment les médecins l’ont guéri de l’hépatite C.
Au squat, une clairière entourée d’arbres où se rejoignent vendeurs et consommateurs d’héroïne, le VIH est une menace bien connue. Mais quand l’équipe de docteurs parvient à entrer en contact avec les toxicomanes, la plupart n’ont jamais entendu parler de l’hépatite C. « On se disait : l’hépatite C, qu’est ce que cela a à voir avec moi ? Pourquoi j’aurais l’hépatite C, je m’injecte juste de l’héroïne. »
« J’avais perdu tout espoir »
Chez les toxicomanes de Nairobi, marginalisés, la prévalence de l’hépatite C est pourtant plus élevée que celle du sida (42 % contre 36 %, selon MDM) mais la sensibilisation, l’accès au diagnostic et au traitement sont extrêmement limités. La progression du virus a suivi celle de l’héroïne, qui entre dans le pays par le grand port de Mombasa. Indice de son importance, le pays compte l’un des plus grands nombres de drogués par injection au monde, selon l’ONG. Autrefois limitée à certaines rues lugubres du centre-ville, l’héroïne est désormais accessible dans de nombreux quartiers populaires. Comme Dagoretti, celui où John a grandi.
Sa première rencontre avec l’héroïne n’était ni dans la rue, ni dans un squat. Mais chez lui avec son grand frère. Ce dernier consomme depuis longtemps, malgré les disputes que cela occasionne dans la famille, éveillant chez l’adolescent une curiosité avide. « Je brûlais l’héroïne pour lui quand il n’était plus capable de le faire. Je faisais les doses, j’agitais la flamme pour qu’il puisse inhaler. Un jour où il était complètement parti, j’ai aspiré la fumée moi-même », raconte-t-il en mimant le geste. Sans pouvoir réprimer un sourire d’extase. C’était au début des années 2000, il avait 14 ans. En quelques mois, l’héroïne – fumée, inhalée puis finalement injectée – prend toute la place. Il quitte l’école, vole pour réunir les 1 500 shillings (13 euros) que coûtent ses dix doses quotidiennes, s’éloigne de ses parents et de leur maison. A Dagoretti, l’adolescent trouve un squat où il passe ses journées, parfois ses nuits ; et où il rencontrera un jour l’équipe de MDM.
Squat d’héroïnomanes kényans dans la ville côtière de Lamu, en novembre 2014. / Goran Tomasevic / REUTERS
Une fois acceptés, les humanitaires sensibilisent les toxicomanes à l’hépatite C, maladie transmise par le sang, la plupart du temps par les échanges de seringues ou des rapports sexuels qui provoquent des lésions. Ils proposent des tests de dépistage et des traitements. Comme ses pairs, John est très méfiant. Ils prennent au départ les médecins pour des indics. « On n’a jamais entendu parler de cette maladie, les mecs arrivent, disent que le traitement est très cher (100 000 shillings, soit 850 euros) et qu’ils veulent nous le donner ? La plupart des gars ont dit non », se souvient-il en agitant la tête de gauche à droite. Les héroïnomanes craignent d’être utilisés comme cobayes. De plus, « beaucoup préfèrent ne pas savoir s’ils sont infectés », ajoute Manassen Murage, un jeune médecin de MDM spécialisé dans le VIH et l’hépatite C.
Ce petit homme au regard confiant, désigné par d’anciens patients comme un « ange gardien », finit par convaincre John de faire le test en juillet 2017. Positif. Sa première réaction est une colère immense qu’il retourne contre lui-même. « Je n’ai pas pu rentrer chez moi, annoncer à ma mère ce que j’avais attrapé. J’avais perdu tout espoir. Je suis allé au repaire, j’ai pris plein de drogues, beaucoup bu, fumé, eu des relations sexuelles. »
Opportunité
Au bout de quelques semaines, il finit par demander à Manassen s’il peut recevoir le traitement. Le programme de Médecins du monde, développé depuis 2016 avec Médecins sans frontières, sur cofinancement d’Unitaid, arrive alors à son terme. Il ne reste que quelques mois, John saisit l’opportunité. Les quatre-vingt-quatre jours de traitement au sofosbuvir sont difficiles. « Au départ, je n’avais pas accès à la méthadone. Quand vous prenez encore de l’héroïne, que vous êtes encore dans le repaire, c’est très compliqué de bien suivre votre traitement. » Outre le déphasage lié à la drogue, les allers-retours quotidiens en transport en commun sont longs depuis Dagoretti jusqu’à la clinique de MDM. Pour ceux qui travaillent, concilier les deux est presque impossible.
Fin 2017, John réalise un dernier test. Négatif. La maladie a été vaincue, mais pas l’appel de l’héroïne. Même après avoir commencé la méthadone, John s’est « repiqué ». « Mais avec des seringues propres », lâche-t-il dans un sourire ingénu, précisant qu’il n’a plus rien touché depuis trois mois. Ses relations avec sa famille se réchauffent petit à petit, il envisage de devenir fermier, peut être un jour guide touristique. Et veut aider « ceux du repaire » à bénéficier eux aussi d’un traitement. « Il faut des gens qui connaissent l’effet d’un shoot et l’effet d’une descente, sinon c’est trop difficile de les convaincre. Il faut aussi trouver des solutions pour les transports, car beaucoup arrêtent juste à cause de cela. » Début 2019, MSF prévoit justement d’ouvrir un nouveau programme de traitement, cette fois près de Dagoretti.
Cette série a été réalisée dans le cadre d’un partenariat avec Unitaid.