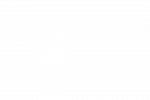En Ethiopie, les réfugiés érythréens craignent un retour forcé

En Ethiopie, les réfugiés érythréens craignent un retour forcé
Par Emeline Wuilbercq (envoyée spéciale dans les camps de Mai-Aini et Hitsats, Ethiopie)
Depuis qu’Addis-Abeba et Asmara ont fait la paix, les Erythréens qui ont fui le régime d’Isaias Afeworki redoutent une remise en cause de leur droit d’asile.
Le camp de réfugiés érythréens de Mai-Aini, dans le nord de l’Ethiopie, en février 2016. / Tiksa Negeri / REUTERS
Frewene a vu à la télévision que son pays, l’Erythrée, a fait la paix avec son frère ennemi éthiopien, en juillet, après vingt ans de conflit larvé. Cette annonce ne lui a procuré aucune joie. « La paix, c’est bien, mais tant que le gouvernement ne change pas, je n’y crois pas », lâche-t-elle sans ciller, en chassant les mouches qui volent dans sa cuisine du camp de réfugiés de Mai-Aini, dans le nord de l’Ethiopie. Cette frêle trentenaire a entendu dire que des milliers de personnes ont accueilli en héros son président, Isaias Afeworki, lors de sa visite en Ethiopie le 14 juillet. « Au lieu de l’applaudir, pourquoi ne lui ont-ils pas demandé où sont ses citoyens et pourquoi ils se sont échappés de son pays ? », interroge-t-elle.
Frewene est amère. Sa famille entière est marquée par l’exil. Sa sœur a péri en chemin vers l’Europe, son frère est atteint de démence depuis qu’il a été torturé par des trafiquants dans le désert égyptien du Sinaï. Elle aussi a choisi de fuir et s’est installée, faute de mieux, dans un camp à une centaine de kilomètres de la frontière érythréenne. Elle vit depuis neuf ans dans le Tigré, la région plus septentrionale d’Ethiopie, où ils sont plus de 38 000 réfugiés répartis dans plusieurs camps. Cela représente moins du quart des réfugiés érythréens enregistrés en Ethiopie, qui sont difficiles à tracer. Certains ont choisi de travailler en dehors des camps, avec ou sans autorisation, d’autres ont poursuivi illégalement la route de l’exil.
Pour de nombreux réfugiés qui ont choisi de reconstruire leur vie dans l’un des camps, le rapprochement entre l’Ethiopie et l’Erythrée n’a éveillé aucun espoir. Le nombre de migrants qui ont traversé la frontière n’a d’ailleurs pas changé : ils étaient environ 1 700 nouveaux arrivants en juin, autant en juillet. Mais il est encore trop tôt pour savoir si l’accord de paix et les changements qu’il pourrait apporter auront une influence sur l’afflux de migrants. La frontière, qui doit être démilitarisée, n’est toujours pas ouverte. Seule la voie aérienne relie pour l’instant les deux capitales, Asmara et Addis-Abeba.
« Les droits humains sont bafoués »
Dans le camp de Hitsats, construit il y a cinq ans, les réfugiés s’ennuient sous une chaleur sèche et vivent au rythme des distributions alimentaires. « Une vie misérable », résume Medichi, un ancien soldat qui a perdu l’usage de sa main gauche au front. Pourtant, il se sent mieux ici que dans son pays d’origine. « Si je vivais encore en Erythrée, je porterais une arme et mes enfants seraient forcés de faire leur service militaire. Ici, on déjeune et on dîne ensemble. Il n’y a pas d’arme à la maison », raconte-t-il.
« Personne ici ne veut rentrer en Erythrée », ajoute Medichi, comme une évidence. Sauf peut-être les mineurs qui ont traversé la frontière pour faire comme les autres et souhaitent désormais retrouver leurs parents. D’après cet homme grand et sec d’une cinquantaine d’années, la réconciliation ne peut en aucun cas pousser les gens au retour. « Ce n’est pas une question de guerre ou de paix. Nous n’avons pas traversé la frontière par peur de la guerre, précise-t-il. Les problèmes sont liés aux pratiques internes : il n'y a pas de démocratie, les droits humains sont bafoués. » L’Erythrée est depuis longtemps pointée du doigt par les organisations de défense des droits humains pour ses détentions arbitraires, la disparition d’opposants et les restrictions des libertés d’expression et de religion.
Une réfugiée érythréenne se fait coiffer dans le camp de Hitsats, en Ethiopie, en novembre 2017. / Tiksa Negeri / REUTERS
Medichi rappelle que le service militaire obligatoire est l’une des premières raisons de la fuite des Érythréens. Initialement prévu pour durer dix-huit mois, il s’est avéré à durée indéterminée après la guerre avec l’Ethiopie, qui a fait entre 70 000 et 100 000 morts entre 1998 et 2000. Il était justifié par la « menace » que représentait le pays voisin. D’après l’agence Reuters, les dernières recrues auraient été informées que leur service prendrait fin dans dix-huit mois. Mais aucune déclaration officielle n’a été faite à ce sujet. Pour Amnesty International, la paix doit entraîner l’arrêt de cette « pratique honteuse touchant même des jeunes de 15 ou 16 ans, qui a porté atteinte aux droits de milliers de personnes et a créé une génération de réfugiés ».
« En Erythrée, on n’a que des dettes »
Pour beaucoup de réfugiés interrogés, les perspectives de retour dans leur pays ne sont pas très alléchantes. « Qu’est-ce qu’on a en Erythrée ? Des dettes, explique Samuel, un jeune à la coupe afro. On a vendu tout ce qu’on avait pour venir ici et il faudra rembourser ceux qui nous ont aidés [à payer le passeur]. On veut aller quelque part où on peut gagner de l’argent pour leur rendre la somme due. » Comme de nombreux réfugiés, il rêve d’une réinstallation dans un pays tiers, en Europe ou en Amérique du Nord, d’où il reçoit régulièrement des nouvelles de la part d’anciens réfugiés. Mais le processus est sélectif et très long.
Son ami Kibirab, 20 ans, craint de ne pas avoir le temps d’attendre. « J’ai peur qu’un jour, le gouvernement éthiopien nous oblige à repartir là-bas sans notre consentement », explique-t-il. Des incursions futures de l’armée érythréenne dans les camps éthiopiens à l’expulsion forcée des réfugiés, le jeune homme a entendu tout un tas de folles rumeurs depuis la signature de l’accord de paix. Aujourd’hui, il a peur que les réfugiés soient les sacrifiés de cette paix.
Le camp de réfugiés érythréens de Hitsats, dans le nord de l’Ethiopie, en novembre 2017. / Tiksa Negeri / REUTERS
« Nous avons dû faire une campagne de sensibilisation dans les camps pour expliquer que personne ne serait forcé de repartir et que tout rapatriement serait volontaire », indique Matthew Crentsil, représentant adjoint sortant du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en Ethiopie. D’après lui, il est trop tôt pour parler d’un processus de rapatriement, qui nécessite des discussions approfondies avec le gouvernement éthiopien et, surtout, un accord tripartite entre le gouvernement hôte, le pays d’asile et le HCR. « Nous n’en sommes pas encore là, poursuit-il. Au moment du rapatriement, les cas de ceux qui ont de réelles craintes seront évalués. Et si nous constatons que les conditions sur place ne sont pas propices au retour, nous ne favoriserons pas le rapatriement. »
« J’irai au Soudan illégalement »
De son côté, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits humains en Erythrée, Sheila Keetharuth, a rappelé en juin aux pays d’accueil l’importance de « donner refuge ou le droit de transiter aux Érythréens qui fuient leur pays en appliquant le principe de non-refoulement ». Mais certains y pensent déjà : la ministre israélienne de la justice, Ayelet Shaked, a récemment affirmé que Tel-Aviv commencerait à expulser les Érythréens vers leur pays d’origine dès qu’Asmara mettra fin à la conscription militaire obligatoire à durée indéterminée. La tendance au durcissement des politiques migratoires en Europe et l’euphorie liée à la paix relayée dans les médias pourraient aussi peser sur les conditions d’octroi de l’asile aux Érythréens.
« Si ces pays ne veulent plus des réfugiés érythréens, si je n’ai pas d’autre choix, j’irai au Soudan illégalement », poursuit Kibirab, sous le regard approbateur de deux amis prêts à faire de même. Des jeunes réfugiés de son camp ont déjà franchi le pas, raconte-t-il, par méfiance et sous mauvaise influence. Car malgré la sensibilisation, l’anxiété et les doutes offrent un terrain fertile aux passeurs, qui ont compris à quel point certains réfugiés feraient tout pour ne jamais remettre un pied en Erythrée.
Joie et émotion lors du premier vol depuis vingt ans entre l’Ethiopie et l’Erythrée
Durée : 01:48