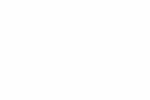Nicaragua : le vrai visage de Daniel Ortega

Nicaragua : le vrai visage de Daniel Ortega
Editorial. La répression menée par le président du Nicaragua, qui s’accroche au pouvoir, a déjà causé la mort d’au moins 300 personnes, sans compter les centaines de disparitions.
Editorial du « Monde ». Depuis quatre mois, au Nicaragua, le président Daniel Ortega offre un spectacle d’une cruelle ironie : celui d’un ancien révolutionnaire dont les méthodes répressives rappellent les heures sombres de la dictature d’Anastasio Somoza, qu’il contribua à renverser, en 1979.
Confronté à la pire crise politique que le petit pays d’Amérique centrale ait connue depuis 1990, l’ex-révolutionnaire s’accroche au pouvoir, à 72 ans, épaulé par son épouse et vice-présidente, Rosario Murillo. La répression a déjà causé la mort d’au moins 300 personnes, sans compter les centaines de disparitions. Opposants et étudiants sont pourchassés, emprisonnés, torturés. Le clergé catholique, qui critique les méthodes du président Ortega, est persécuté. Les tristement célèbres escadrons de la mort sont réapparus sous une autre forme, celle des sinistres « turbas », groupes paramilitaires à moto, armés, qui sèment la terreur pendant les manifestations.
Celles-ci pourtant se poursuivent, depuis la première qui, le 18 avril, a tout déclenché. Ce qui était au départ un mouvement de protestation contre une réforme de la sécurité sociale et du régime de retraite est devenu une véritable révolte politique : les Nicaraguayens étaient encore des milliers, samedi 18 août, à défiler dans les rues de Managua pour demander l’arrêt de la répression, la libération des prisonniers politiques, le départ du président et des élections anticipées. La répression a permis au pouvoir de reprendre le contrôle des villes et des grandes artères, qui ont été le théâtre de scènes de guérilla urbaine. La peur a chassé de nombreux opposants ; quelque 23 000 personnes ont fui au Costa Rica voisin. Ils y ont été mal accueillis : des centaines de Costaricains brandissant des croix gammées ont protesté, samedi, à San José contre l’arrivée massive de ces Nicaraguayens fuyant la misère du deuxième pays le plus pauvre d’Amérique, après Haïti.
Aucune sortie de crise ne paraît se profiler. Le processus de « dialogue national » amorcé à la mi-mai a fait long feu. La conférence épiscopale, qui y participait, a proposé d’avancer les élections à mars 2019, en demandant à Daniel Ortega, qui totalise déjà onze ans au pouvoir, de ne pas se représenter. Mais celui-ci a déclaré vouloir aller jusqu’au bout de son mandat actuel, en 2021. En juillet, l’Organisation des Etats américains (OEA) a adopté une résolution réclamant également des élections anticipées. Washington, l’Union européenne, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, se sont joints aux condamnations. Rien n’y fait. Daniel Ortega et son épouse ne donnent aucun signe de vouloir céder une once de pouvoir et préfèrent dénoncer l’éternel « impérialisme américain ».
L’ex-révolutionnaire vieillissant aurait tort, pourtant, de se croire aussi irréductible que Nicolas Maduro, le président du Venezuela en crise. A l’exception de ce dernier et du Bolivien Evo Morales, la gauche latino-américaine n’est pas dupe. En Colombie, l’ex-candidat présidentiel de gauche Gustavo Petro l’a clairement exprimé sur Twitter : « Au Venezuela comme au Nicaragua, il n’y a pas de socialisme, il y a une rhétorique de gauche du XXe siècle pour couvrir une oligarchie qui vole l’Etat, une minorité qui gouverne pour elle-même et qui viole les droits de la majorité. » Depuis quatre mois, Daniel Ortega a montré son vrai visage. Même ses anciens alliés dans la révolution sandiniste se sont retournés contre lui. Le temps est venu de rendre un dernier service à son pays : celui de quitter le pouvoir.