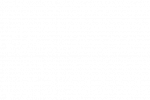Euro : l’amère odyssée de la Grèce

Euro : l’amère odyssée de la Grèce
Editorial. Avec la fin du troisième plan d’aide européen, Athènes s’émancipe de son étroite tutelle financière, mais le coût de l’opération pour les Grecs a été terrible. Rarement un pays se sera appauvri en si peu de temps.
Editorial du « Monde ». Alexis Tsipras a choisi l’île d’Ithaque pour saluer, mardi 21 août, la « libération » de la Grèce du douloureux programme d’assistance financière dont elle dépendait depuis huit ans. Tel Ulysse regagnant son île après la guerre de Troie au terme d’une décennie de périples en mer, le premier ministre grec a tenté de donner une tonalité victorieuse à cette « odyssée des temps modernes ». « Aujourd’hui, la Grèce reprend son destin en main », a poursuivi M. Tsipras : « une nouvelle ère » s’est ouverte.
Le dirigeant grec a quelque raison de vouloir marquer cette étape. Elus en 2015 sur un programme de gauche radicale et la promesse de mettre fin à l’aide financière extérieure, Alexis Tsipras et son parti, Syriza, durent rapidement faire volte-face et accepter un troisième plan d’assistance draconien pour éviter la faillite du pays et sa sortie de l’euro. Après trois plans d’aide, 289 milliards d’euros de prêts, huit ans de tutelle de ses créanciers et d’austérité imposée, Athènes va de nouveau pouvoir se financer sur les marchés. Laminée par des années de récession, l’économie grecque se porte aujourd’hui un peu mieux. La croissance, avec laquelle elle a renoué en 2017, devrait frôler les 2 % cette année. Le chômage, qui culminait à 27 %, est repassé sous la barre des 20 %.
Loin d’Ithaque, les dirigeants de l’Union européenne se sont aussi, bien que plus prosaïquement, félicités de l’émancipation de la Grèce de son étroite tutelle financière. Pour la zone euro, qui n’avait jamais été confrontée à une crise d’une telle gravité et n’y était absolument pas préparée, le pire a été évité : la banqueroute et le chaos qui aurait suivi ont été épargnés à la Grèce et à ses créanciers, l’euro ne s’est pas effondré et les Grecs ont pu se maintenir au sein de l’UE, comme ils le souhaitaient. Jamais l’Europe n’avait engagé de telles sommes pour sauver l’économie d’un Etat membre. Le « Grexit » n’a pas eu lieu.
Un sérieux examen de conscience à faire pour l’UE
Pour autant, l’humeur n’est festive ni à Athènes ni à Bruxelles. Comment le pourrait-elle ? Le coût de l’opération pour les Grecs a été terrible. Rarement un pays se sera appauvri en si peu de temps. Le PIB a fondu de 25 %. Le chômage a poussé près d’un demi-million de personnes, pour la plupart jeunes, à l’émigration. Quelque 250 000 PME ont fait faillite. L’administration reste défaillante, le système de santé délabré. Pour les Grecs, l’argument selon lequel l’alternative aurait été pire est une maigre consolation.
Malgré la mise en œuvre des réformes, les problèmes qui sont à l’origine de la catastrophe financière grecque n’ont pas été résolus. La corruption reste un fléau, la dette disproportionnée. La question du modèle économique de la Grèce demeure posée. L’horizon politique n’est pas éclairci : si l’Europe salue le pragmatisme d’Alexis Tsipras, celui-ci sort fragilisé de la gestion calamiteuse des incendies autour d’Athènes, qui ont tué près de 100 personnes en juillet. Enfin, la fin de la tutelle est assez symbolique : la Grèce restera soumise à une « surveillance renforcée ».
Quant à l’UE, cette nouvelle étape grecque doit être pour elle l’occasion d’un sérieux examen de conscience. La Grèce a fait les frais des failles d’une union monétaire incomplète. Les dirigeants européens n’ont pas tous la même lecture de cette tragique épreuve. Ils feraient bien, pourtant, d’en tirer les leçons une fois pour toutes, afin de ne pas être de nouveau surpris par la prochaine crise, au moment où l’Italie s’apprête à défier les règles budgétaires.