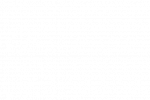Tous les spectres de Claude Vivier

Tous les spectres de Claude Vivier
Par Pierre Gervasoni
Mort en 1984 à 34 ans, le compositeur québécois a produit une musique à l’image de sa vie, foisonnante et trouble. Le Festival d’automne à Paris lui consacre cette année un grand « Portrait ».
Claude Vivier, en 1981. / JEAN BILLARD
Le soir du 25 janvier 1983, Claude Vivier rentre chez lui, à Paris, avec un homme qu’il a rencontré dans un bar. L’inconnu lui entaille le cou avec une paire de ciseaux avant de lui dérober quelques billets. L’histoire se répète dans la nuit du 7 au 8 mars. Cette fois, le compositeur est retrouvé mort ; un mois avant son 35e anniversaire. Sur sa table de travail, une partition dont le titre allemand interpelle, Glaubst du an die Unsterblichkeit der Seele (« Crois-tu en l’immortalité de l’âme »), et plus encore son contenu.
Un récitant y raconte, à la première personne et de manière amplifiée (poignard enfoncé dans le cœur), l’agression du 25 janvier. « Il faisait nuit et j’avais peur », confie plus loin le substitut du compositeur. Repris par les chanteurs, le mot « peur » aura été la dernière expression musicale de Claude Vivier. La partition, inachevée, s’arrête là.
Difficile alors de ne pas s’interroger sur la relation entre la vie et l’œuvre, sachant que, pour le Québécois plus que pour tout autre compositeur, l’une et l’autre « sont inextricablement liées », comme en atteste le chef d’orchestre Reinbert de Leeuw dans un instructif documentaire (Rêves d’un Marco Polo, 2006, 2DVD Opus Arte). Pourtant, Claude Vivier aura attendu sa dernière œuvre pour faire ouvertement référence à ce qui lui arrivait. Jusque-là, il s’était contenté d’allusions plus ou moins conscientes à une vie qui, riche en épisodes glauques, pourrait nourrir un roman impudique ou une thèse de psychanalyse.
Mystique toujours
Né à Montréal le 14 avril 1948, de parents inconnus, Claude Vivier est placé dans un orphelinat où il restera jusqu’à Noël 1950. L’enfant semble bien parti pour être adopté, mais le couple Vivier le ramène à l’institution après les fêtes. L’adoption officielle interviendra néanmoins en août 1951. Commence une vie qui, sur les photos, n’inspire que des sourires au jeune Claude.
Pourtant, abusé sexuellement à 8 ans par un oncle, il est envoyé dans un internat et ne voit plus sa famille que pendant les vacances. La scolarité chez les frères maristes le conduira au séminaire. Après quelques mois seulement de noviciat, pendant l’année scolaire 1966-1967, le jeune homme comprend qu’il n’est pas fait pour la vie monastique. Il a découvert son homosexualité et, surtout, sa nature de compositeur.
Subjugué par l’orgue et par les chants entendus, à 14 ans, pendant la messe de minuit, il voit la musique comme un élément de rêve susceptible de le protéger des atteintes de la réalité. Eneffet, dans une partition, tout est permis. Y compris l’usage d’une langue inventée. Toutefois, Ojikawa (1968), son premier essai dans ce domaine, utilise aussi des extraits du Psaume 131.
En 1970, alors qu’il vient d’obtenir ses prix d’analyse et de composition dans la classe de Gilles Tremblay (un disciple québécois d’Olivier Messiaen) au Conservatoire de Montréal où il a été admis en 1967, Claude Vivier effectue deux longues retraites dans l’abbaye cistercienne d’Oka, où il retournera tout au long de sa vie après des moments difficiles. Mystique un jour, mystique toujours. Sur ce plan, il aura bientôt à qui parler avec Karlheinz Stockhausen (1928-2007), qui l’accepte parmi ses élèves, à l’automne 1972, à Cologne, après un parcours semé d’embûches.
Vivier adule le compositeur qui diffuse la bonne parole avant-gardiste lors des cours d’été de Darmstadt (auxquels le jeune Québécois assiste depuis 1970), en Allemagne, et il se considère lui-même comme l’Elu parmi les disciples de cette figure christique. Composé en 1973, au plus fort de l’influence de Stockhausen, le chœur a cappella Jesus erbarme dich (« Jésus prends pitié ») prouve que Vivier est loin de se comporter en épigone. Le même constat est valable après le voyage effectué, de septembre 1976 à janvier 1977, en Asie du Sud-Est.
Hommage à la musique balinaise, Pulau Dewata (1977) balance entre incantation et frénésie selon une aspiration, toute personnelle, que le compositeur résume ainsi : « C’est une musique d’enfant. » L’opéra Kopernikus (1978-79), sous-titré « Rituel de mort », s’inscrit dans une semblable dimension. Inspiré des Aventures d’Alice au pays des merveilles, il commence par une lettre de Lewis Carroll et réunit des personnages mythiques (Merlin, le Roi Arthur, la Reine de la nuit, Tristan et Isolde) autour d’Agni, déesse hindoue du feu, laquelle demande notamment à Mozart s’il est vrai que, dans le château de la fée Carabosse, les gens communiquent par le biais de la musique…
Qu’on ne prenne pas cependant Vivier pour un créateur anecdotique et infantile ! Son intérêt pour les échelles non tempérées et son sens inné des superpositions de timbres et d’harmonies devaient naturellement le placer dans la mouvance de la musique spectrale, courant majeur apparu en France dans les années 1970. Le séjour parisien entrepris en 1982 par le Québécois a-t-il été motivé par un tel rapprochement ?
« Un écriveux de musique »
Quoi qu’il en soit, son dernier opus achevé, Trois airs pour un opéra imaginaire (sur un texte en langue inventée), fera sensation, lors de sa création posthume, le 24 mars 1983, au Centre Pompidou, alors que l’assassin du compositeur court toujours. On ne découvrira l’identité du meurtrier, un délinquant de 20 ans, que huit mois plus tard. Relation sadomasochiste ayant mal tourné, acte crapuleux ou crime homophobe – comme le suggère Bob Gilmore, auteur en 2014 d’une remarquable biographie du compositeur (University of Rochester Press, en anglais, non traduit) ?
Le fait est que la carrière de Vivier s’arrête net après dix ans de tours et détours entièrement voués à la création. « Je suis un écriveux de musique », avait-il clamé par un néologisme propre à manifester sa détermination, vaille que vaille, à s’exprimer avec des mots et des notes n’appartenant qu’à lui.
Prompt à désigner des symboles (l’addition des 7 chanteurs et des 7 instrumentistes de Kopernikus aboutissant au chiffre 14, celui de sa naissance), Claude Vivier a-t-il songé que son œuvre, foisonnante et juvénile, était tout entière résumée par son nom ?
Article réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le Festival d’automne à Paris.