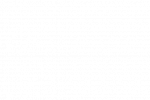« La Peur » : la mort en bleu horizon

« La Peur » : la mort en bleu horizon
Par Thomas Sotinel
Damien Odoul tente, avec audace et souvent avec brio, d’imaginer l’expérience des combattants de la première guerre mondiale.
Damien Odoul est né cinquante ans après la fin de la première guerre mondiale. Quand il était enfant, le 11 novembre, il restait encore des anciens combattants autour du monument aux morts. Des hommes pouvaient encore raconter de vive voix ce que l’écrivain Gabriel Chevallier (l’auteur de Clochemerle, Les Éditions Rieder Paris, 1934), mobilisé de 1914 à 1918, avait décrit dans La Peur (Stock, 1930), le récit dont est inspiré le film de Damien Odoul.
Après les témoignages directs (Les Croix de bois, de Raymond Bernard, 1932), après l’analyse et la dénonciation de l’horreur (Les Sentiers de la gloire, de Stanley Kubrick, 1957), est venu le temps d’imaginer ce que fut cette expérience que l’humanité (en tout cas sa moitié mâle) s’infligea à elle-même. Sans renoncer au respect que l’on doit aux faits établis, Damien Odoul tente de mettre en scène la transformation du monde d’un endroit où l’on vit en un lieu où l’on meurt et – au mieux – où l’on survit. C’est-à-dire préférer les sensations à la raison, ou même aux émotions.
Indifférence à l’horreur
Les risques inhérents à ce parti pris sautent parfois aux yeux : les êtres qui passent devant la caméra, en pantalon garance ou en capote bleu horizon, ne sont parfois que des silhouettes de papier découpé. La logique infernale du conflit, les mécanismes de machine guerrière sont simplifiés à l’extrême. Et puis, pour convaincre tout à fait de l’immensité de la catastrophe, il aurait sûrement fallu plus de moyens que ceux dont Damien Odoul a disposé.
N’empêche, La Peur fait peur, et pour les bonnes raisons. Le récit – ou ce qui en tient lieu – s’attache aux pas d’une jeune recrue, Gabriel (Nino Rocher), qui s’engage dès août 1914, mais n’arrive sur les lieux des combats qu’à l’hiver suivant. L’horreur s’insinue peu à peu. En quatre ans de guerre (et une heure et demie de film), Gabriel connaîtra les hôpitaux de campagne, le retour au front, l’indifférence progressive à l’horreur. La volonté du metteur en scène de faire de son personnage principal le miroir de ce qui l’entoure affaiblit sans doute son film. Celui-ci est envahi par les personnages secondaires, Nègre (Pierre Martial Gaillard), un grand type sympathique qui, au fil des séquences, s’adapte merveilleusement à son nouvel écosystème, profitant de tous les trafics que la boucherie a rendus possibles. Cette truculence fait passer au second plan ce qui devrait être le centre de gravité du film, la transformation de Gabriel. Tout comme elle est reléguée au second plan lorsque surgit Ferdinand (dont le prénom célinien ne ment pas), un type à la gueule de moine fou, qui prépare son automutilation, son billet vers l’arrière.
Un paysage qui a perdu tout sens
On s’aperçoit que La Peur, malgré ses imperfections, est parvenu à ses fins lorsque les séquences de retour à la vie civile – les permissions qui permettent à Gabriel de retrouver celle qui l’aime, de dîner avec les pékins qui pérorent sur une guerre à laquelle ils ont échappé – perdent de leur réalité au profit du cauchemar du front. Ce cauchemar est fait de visions atroces, étranges. Un groupe de tirailleurs sénégalais improvise une danse à laquelle se joint Gabriel, sans en connaître le sens. Il chemine sans fin dans un paysage qui a perdu tout sens, on ne sait même plus dans quel sens les arbres poussent, ni où commence le ciel. Le bleu horizon des uniformes est devenu la couleur du monde.
Dans les interstices de ces visions, le scénario glisse des bribes d’information : Verdun, les mutineries, l’arrivée des Américains, signalant au spectateur que la fin approche. Mais Odoul tient ses personnages à l’écart de tout espoir. Dans l’espace confiné d’un film, il a réussi à créer un monde dans lequel la peur paraît éternelle.
La Peur, de Damien Odoul (Fr./Can., 2015, 87 min).