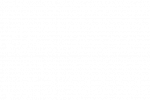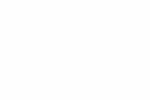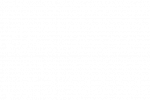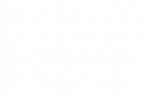Fin du numerus clausus : les syndicats d’étudiants en santé appellent à aller plus loin

Fin du numerus clausus : les syndicats d’étudiants en santé appellent à aller plus loin
Par Alice Raybaud
L’annonce de la suppression du numerus clausus est bien accueillie par les syndicats mais ne suffira pas, selon eux, à répondre aux enjeux de l’accès aux soins.
Jour d’examen à la faculté de médecine de Marseille, en décembre 2012. / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Un système plus humain et plus souple. C’est ce qu’avaient appelé de leurs vœux les syndicats d’étudiants en santé. La suppression du numerus clausus, et du concours couperet à l’issue de la première année commune aux études de santé (Paces), annoncée par Emmanuel Macron, mardi 18 septembre, leur donne satisfaction sur ce point.
Clara Bonnavion, présidente de l’Association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF), salue « de bonnes nouvelles ». Une sélection plus progressive qu’actuellement, avec plusieurs licences qui permettront d’intégrer les deuxièmes cycles de santé (médecine, pharmacie, odontologie…), permettra une « diversification des profils, avec l’arrivée d’élèves aux aspirations et aux formations différentes », ajoute-t-elle. Le président de l’Association nationale des étudiants en pharmacie de France (ANEPF), Robin Tocqueville-Perrier, se félicite d’« un signal fort envoyé pour remettre de l’humain au cœur du système, et pour sortir de l’absurdité du par cœur », largement requis – et décrié – pour se préparer au concours de fin de Paces actuel.
Les différents syndicats se disent prêts à se lancer dans la concertation qui doit s’ouvrir dès mercredi sur le détail de la refonte des cursus, mais comptent rester vigilants sur plusieurs points.
Crainte d’une « sélection brutale à l’entrée en master »
Il convient, selon eux, de ne pas trop augmenter le nombre de professionnels formés. « La formation en médecine est déjà saturée, que ce soit au niveau des infrastructures ou des terrains de stage, alerte Clara Bonnavion. L’application d’un modèle ultralibéral aux métiers de la santé ne serait que néfaste pour les patients. »
L’Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire (UNECD) pointe de son côté « des problèmes de capacité d’accueil avec le numerus clausus tel qu’il était fixé cette année ». « Nous sommes opposés à une augmentation, car elle impacterait notre qualité de travail », prévient sa présidente, Lucie Bertagnolio, en attente de précisions pour se prononcer plus avant sur le projet de réforme. Du côté des étudiants en pharmacie, l’ANEPF affirme l’importance d’une régulation correcte des flux d’étudiants, « pour ne pas se retrouver en fin de licence avec une sélection brutale à l’entrée en master ».
Les différents syndicats souhaitent que la réforme fasse évoluer l’orientation et le contenu des enseignements. « Il faut donner à connaître aux aspirants praticiens, dès le lycée, toutes les professions, souvent méconnues, ainsi que toutes les voies d’études qui permettent d’accéder à des métiers de la santé », encourage l’ANEMF. Robin Tocqueville-Perrier, vice-président, y voit l’occasion « d’un nouveau modèle des formations de santé où la pharmacie pourra, nous l’espérons, être intégrée, et ne soit désormais plus un choix par défaut, dépassée par la suprématie des études de médecine ». C’est aussi le moment de « dépoussiérer des matières qui datent de quinze ou vingt ans pour créer une filière plus innovante ».
Développer l’interprofessionnalité
Pour l’Association nationale des étudiants sages-femmes (ANESF), la suppression du numerus clausus ne permettra pas de répondre à l’ensemble des enjeux de formation, de démographie et de répartition des soignants sur le territoire, souligne sa présidente, Julie Kerbart : « L’enjeu est de mettre en place une interprofessionnalité satisfaisante pour mener une continuité dans le parcours de soin et un meilleur suivi des patients. » Elle plaide pour la création d’un statut de sage-femme référente, à même d’assurer un suivi au long cours des patientes. « En décentralisant le rôle du médecin – sans pour autant parler de récupérer leurs compétences – nous pourrions ainsi potentialiser les compétences de chaque métier pour mieux répartir le travail et la patientèle sur un territoire », estime-t-elle.
La suppression du numerus clausus en médecine, « dont les effets se font sentir à très long terme », ne suffira pas à lutter contre les déserts médicaux, souligne également Clara Bonnavion. Elle préconise d’augmenter les opportunités et incitations à découvrir de nouvelles pratiques et des territoires différents. « Actuellement, les stages se situent presque exclusivement dans des grandes villes et dans des centres hospitaliers. Il faut les développer dans les cabinets libéraux, dans les maisons de santé », ce qu’esquisse la réforme du second cycle des études de médecine de juillet, précise encore l’étudiante.
Du côté des étudiants en kinésithérapie, qui ont pour la plupart commencé leurs études en Paces, ils ne sont pas directement concernés par la suppression du numerus clausus, mais pourraient l’être par ricochet. « La réforme pourrait entraîner également la suppression des quotas régionaux qui régissent aujourd’hui les études de kinésithérapie », explique Louis Dreux, président de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. Une mesure souhaitable, selon lui, si elle ne s’accompagne pas, comme ces dernières années, de créations d’instituts de formation en masso-kinésithérapie « délocalisés ». Il plaide, lui, en faveur de l’intégration des instituts de formation aux universités et se félicite des annonces de mardi, selon lesquelles « l’université sera motrice dans le cadre de cette réforme ».