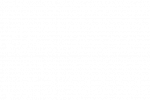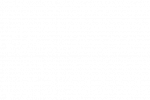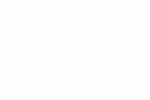Brexit : l’art du « deal »

Brexit : l’art du « deal »
Editorial. Face au gouvernement britannique, les Vingt-Sept font preuve d’une remarquable unité à vouloir préserver l’acquis commun et le projet politique que représente l’Europe.
Editorial du « Monde ». Unité, fermeté et pression maximale. C’est la stratégie que s’étaient fixée les dirigeants européens face au gouvernement britannique, en abordant la dernière longueur des négociations qui doivent en principe aboutir à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne dans six mois. A Salzbourg, où ils se sont réunis les 19 et 20 septembre, d’abord à vingt-huit, en présence de Theresa May, la première ministre britannique, puis sans elle, à vingt-sept, ils s’y sont tenus, faisant corps derrière le négociateur européen, Michel Barnier.
Même si Malte et quelques pays comme la Pologne se montrent plus sensibles aux positions britanniques, les Etats membres de l’UE continuent de faire preuve sur ce dossier d’une remarquable unité, eux si prompts à se déchirer sur tant d’autres questions. S’ils y parviennent, c’est parce qu’ils ont conscience de ce qui est en jeu dans le défi du Brexit : préserver l’acquis commun et le projet politique que représente l’Europe. Lorsque Donald Tusk, le président du Conseil européen, et Emmanuel Macron, le président français, évoquent « l’heure de vérité » à laquelle Londres et ses partenaires sont maintenant arrivés dans la négociation, ce n’est pas seulement de l’horloge qu’ils parlent ; c’est de la sauvegarde d’un authentique projet européen.
Theresa May furieuse
Theresa May l’aura-t-elle enfin compris jeudi, dans l’avion qui la ramenait à Londres ? Elle retrouve un pays en proie à de profondes divisions sur les modalités du Brexit, exacerbées par les enjeux de politique intérieure. Visiblement furieuse de ne pas avoir été traitée avec plus de souplesse à Salzbourg, Mme May doit faire face, dans une semaine, au congrès annuel de son parti, le Parti conservateur, où les « durs » ne lui feront pas de cadeaux. Elle n’aura donc pas été étonnée de lire dans la presse britannique vendredi les commentaires cinglants sur « l’humiliation » qu’elle a subie à Salzbourg et « l’embuscade » des Vingt-Sept dans laquelle elle est tombée.
Au-delà des infinies complexités techniques, économiques et juridiques que doit résoudre la négociation menée par M. Barnier au nom de la Commission européenne, c’est bien au niveau politique que se trouve la solution. Theresa May ne peut, au fond, demander aux Européens de régler un différend qui est d’abord intrabritannique : celui de la profonde crise ouverte dans son pays par le référendum du 23 juin 2016.
Réalité du rapport de force
Depuis la campagne pour ce référendum, à l’exception de quelques oiseaux de mauvais augure, une grande partie des Britanniques et leurs élus se sont bercés d’illusions sur la faisabilité et le coût du Brexit. Deux ans plus tard, ils ne semblent toujours pas prêts à affronter la réalité du rapport de force avec l’UE, ni les conséquences concrètes du divorce d’avec l’Union pour leur pays, leur économie et leur vie quotidienne.
Il reste encore quelques précieuses semaines pour avancer, en particulier sur le principal point de blocage, celui de la frontière irlandaise, qui met en jeu à la fois l’intégrité du Royaume-Uni et celle du marché unique européen. La balle est dans le camp de Londres. Pour autant, les Vingt-Sept devront, à un moment donné, savoir faire preuve aussi d’ouverture. S’ils sont légitimes à vouloir préserver ce qui constitue les fondements de l’Union, ils ne doivent pas oublier que la Grande-Bretagne restera un pays européen, notre voisin le plus proche à l’ouest, et un partenaire indispensable en matière de sécurité et de défense. Tout doit être mis en œuvre pour trouver ensemble l’art du « deal » à l’européenne : un accord qui protège l’Europe sans humilier les Britanniques.