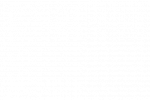Le « triple défi » des bacheliers africains invités à venir étudier en France
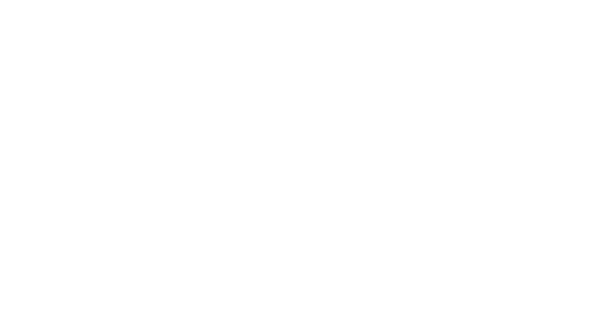
Le « triple défi » des bacheliers africains invités à venir étudier en France
Par Maryline Baumard
Tous les ans, 150 lycéens étrangers, sélectionnés pour leurs brillants résultats, bénéficient d’une bourse de cinq ans. En 2018, une quarantaine provient du continent.
Chaque soir en rentrant de l’université, Jessica Cupesalla prend la même résolution. Le lendemain, elle se le promet, elle fera le premier pas vers des étudiantes de sa licence de sciences. Mais le jour suivant, la jeune Angolaise ne force pas plus sa nature que la veille et file de l’Université Pierre-et-Marie Curie (UPMC) dès la fin des cours.
Comme les quarante autres Africains du programme Excellence-Major de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), Jessica cherche ses marques sur un continent inconnu, à 10 000 km de chez elle. Celle qui se bat contre le froid d’automne à coups de pull-overs se doute un peu que des amitiés nouvelles réchaufferaient plus sa vie que ce vêtement encore tellement exotique pour elle il y a quelques semaines. Mais le temps fera son œuvre, estime la jeune étudiante.
Choc d’acclimatation
D’autant que ce blues d’accoutumance est pondéré par l’excitation de sa vie nouvelle. Samedi 22 septembre, au milieu d’une partie des autres jeunes étrangers choisis comme elle par la France, et réunis pour la rentrée, Jessica se rassure. Elle n’est pas la seule à ressentir le petit pincement du déracinement dans les couloirs de sa faculté ou du métro. « Débarquer un baccalauréat en poche dans un pays étranger, sans sa famille, pour débuter des études supérieures, est un triple défi », reconnaît la proviseure d’Henri-IV, Martine Breyton, qui a elle-même sélectionné une partie de ces titulaires d’un bac français mention « bien » ou « très bien », passé aux antipodes.
« Un choc psychologique », lui répond comme en écho Mohamed Benhaddou Andaloussi, entré il y a deux semaines en classes préparatoires dans ce prestigieux lycée. Lui n’a pas à affronter l’anonymat des amphis, comme Jessica, mais doit se hisser aux standards d’exigence d’un des meilleurs lycées de France. « Un autre défi ! », observe, philosophe, le Marocain de Casablanca.
Hormis ce choc d’acclimatation, Jessica et Mohamed sont ravis de faire partie des 150 boursiers Excellence-Major de l’AEFE. « Ce dispositif permet à des ressortissants étrangers, qui ont passé un baccalauréat dans un des lycées français, de venir étudier pendant cinq ans en France. Nous les sélectionnons sur leur excellence académique et leur motivation, leur proposons une bourse pour préparer un master ou un diplôme de grande école », explique Christophe Bouchard, le directeur.
Une manière de séduire les élites francophones de demain, à l’heure où la bataille des cerveaux bat son plein, et de mettre vraiment à profit cet outil de la diplomatie d’influence qu’est le réseau des 492 établissements français de l’étranger. 210 000 étrangers y sont inscrits aux côtés des quelque 140 000 enfants d’expatriés français.
« Cinq années de bourse »
Sur les 150 élus de la promotion 2018, 41 viennent donc du continent africain. Ce groupe compte 13 nationalités, avec une mention spéciale pour les Marocains qui trustent 63 % des places, quand les Subsahariens (Sénégal, Togo, Cameroun, Djibouti, République démocratique du Congo…) ne sont jamais plus de deux par nationalité. L’AEFE les aimerait plus nombreux, mais les candidats postulent encore trop peu.
Moussa Diara est l’un d’eux. Burkinabé, il a étudié au Kenya et entre avec Mohamed en prépa à Henri-IV. Le jeune homme rêvait du Canada. Il avait même « postulé pour une licence de droit à Ottawa en premier choix, car les universités canadiennes sont mieux cotées que les françaises. J’étais accepté, mais j’ai reconsidéré cette option quand j’ai vu que la France m’offrait cinq années de bourse », explique-t-il.
Un peu comme Chaïma Al-Marji, une jeune Marocaine inscrite en droit à La Sorbonne après avoir décliné les offres des Etats-Unis et du Canada. « C’est la bourse qui m’a décidée à venir en France », reconnaît-elle aussi, tout net. Les 150 jeunes sélectionnés parmi 570 dossiers toucheront entre 222 et 685 euros par mois pendant cinq années et seront accompagnés par l’AEFE. Samedi, Laurent Métais, responsable du programme, a déjà pu faire le point avec chacun sur sa carte de séjour, son ouverture de compte bancaire et les nouvelles modalités d’inscriptions à la Sécurité sociale, avant de les laisser entre les mains de leur parrain ou marraine.
« Viser l’excellence »
Marlyse Lissan a deux filleuls. Cette Béninoise, arrivée en France en 2014 dans ce même programme, a tracé sa route depuis et entre à 22 ans en master 2 (M2) de droit des nouvelles technologies à La Sorbonne après avoir passé un an en Grande-Bretagne et enregistré « une mention à chaque diplôme annuel ». Y compris au Collège de droit, ce cursus d’excellence auxquels seuls les plus brillants d’Assas peuvent prétendre. « En tant que tutrice, je veux rappeler qu’il ne faut pas se laisser happer par le piège de l’université où l’on peut passer en année supérieure avec 10 sur 20 de moyenne. Il faut sans cesse viser l’excellence, c’est la seule manière de se distinguer », explique-t-elle en « grande sœur » à Chaïma et aux autres.
Marlyse, qui joue cartes sur table avec les nouveaux, n’hésite pas à raconter avoir été « la seule Noire du Collège de droit ». Elle s’amuse d’ailleurs rétrospectivement de la manière dont certains étudiants d’Assas, qu’elle savait sympathisants de l’extrême droite, sont passés vis-à-vis d’elle « de l’ignorance à la curiosité et même à un certain intérêt en voyant mes résultats universitaires ». Jessica écoute ce récit, consciente que le cosmopolitisme parisien cache des failles, même si l’UPMC où elle est inscrite n’a rien du profil politique très droitier d’Assas.
Mais les conseils de Marlyse ne s’arrêtent pas aux études car, comme l’a rappelé Christophe Bouchard, « ces cinq années doivent aussi permettre de très belles rencontres et une ouverture à l’Europe ». La jeune Béninoise, qui assure du bénévolat à l’Association française des étudiants pour la ville (AFEV), aimerait transmettre ce goût de l’engagement auquel elle croit. Quand elle raconte, Chaïma boit ces paroles, déjà projetée dans le futur par les mots de sa tutrice et par un début de réflexion sur la vie d’après.
« Soft power » à la française
Si Marlyse pense commencer sa carrière en Europe, elle se dit « sûre qu’à la fin elle veut rentrer au Bénin ». Comme Moussa qui veut retourner au Burkina une fois diplômé pour « faire avancer le pays », « rendre » ce qu’on lui « a donné », dit-il. A l’inverse, Mohamed et Jessica se projettent déjà en Europe, « parce qu’il n’y a pas d’avenir dans mon pays, pas de recherche, et moi je veux être chercheuse en physique », explique la jeune Angolaise. « Et moi parce que je me sens tellement bien ici. J’y suis dans mon élément », poursuit Mohamed déjà au point sur les adresses des meilleures crêpes de la rue Mouffetard, dans le 5e arrondissement de la capitale.
L’AEFE ne dispose pas aujourd’hui du suivi des jeunes passés depuis 1990 par ces bourses d’excellence sur lesquelles la France investit chaque année 7 millions d’euros. Mais quelles que soient leurs stratégies professionnelles, ces élites, une fois dans la vie active, resteront des ambassadeurs de la culture qui les a formées, et auront « vocation à développer des partenariats économiques ou industriels avec leur lieu d’installation », comme le rappelle la brochure de l’AEFE.
C’est le pari du soft power à la française. Une bonne raison de vouloir développer le nombre de boursiers en Afrique subsaharienne, à l’heure où cette zone qui compte 8 millions d’étudiants est déjà bien courtisée. La Chine, dont on connaît l’appétit, fait d’ailleurs profiter de plus en plus de jeunes Africains d’un programme baptisé Rêve chinois et les entrées d’étudiants étrangers à Pékin ont augmenté de 75 % en cinq ans pour placer l’empire du Milieu au huitième rang des pays d’accueil. La France, elle, arrive bonne quatrième place (derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie) et près de la moitié des 325 000 étudiants en mobilité qu’elle accueille sont originaires d’Afrique.