« Arrêtons d’enseigner l’économie comme si les trente dernières années n’avaient pas eu lieu »
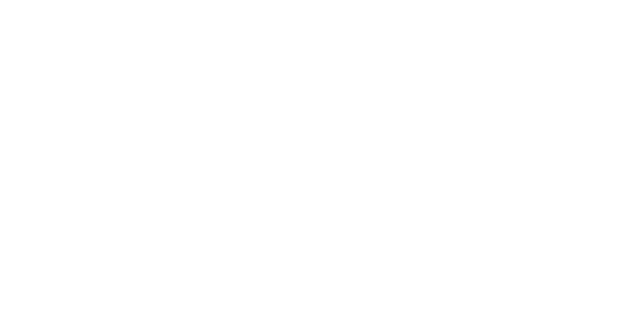
« Arrêtons d’enseigner l’économie comme si les trente dernières années n’avaient pas eu lieu »
Propos recueillis par Séverin Graveleau
Yann Algan, professeur d’économie et doyen de l’Ecole d’affaires publiques de Sciences Po, explique ce que la crise a modifié dans les cursus des grandes écoles.
Forme-t-on aujourd’hui les futurs responsables politiques comme on le faisait avant 2008 ? Entretien avec Yann Algan, professeur d’économie et doyen de l’Ecole d’affaires publiques de Sciences Po.
Comment les formations d’affaires publiques et de sciences politiques ont-elles réagi à la crise de 2008 ?
Cette crise et la montée des populismes qui a suivi ont obligé les écoles à s’interroger sur la façon dont elles forment les responsables d’aujourd’hui et de demain. Il faut mettre en place des politiques publiques dans un contexte où la défiance des citoyens est extrême vis-à-vis des responsables et des experts, des élites et des institutions. Les grandes écoles doivent reconstruire le pacte de confiance entre la politique publique et les citoyens en formant des responsables éclairés capables de coconstruire des politiques avec les citoyens pour le bien commun.
Cela passe d’abord par les politiques de recrutement. Il est important d’ouvrir l’accès aux grandes écoles et d’y introduire une forte mixité sociale, mixité géographique et mixité des parcours. On ne pourra pas donner confiance aux citoyens si l’ensemble des talents ne sont pas représentés parmi les responsables d’aujourd’hui et de demain. Les conventions éducation prioritaire mises en place à Sciences Po dès le début des années 2000 vont en ce sens.
Dans ce contexte, quels sont vos objectifs d’enseignements aujourd’hui ?
A l’Ecole d’affaires publiques, mais aussi plus généralement à Sciences Po, cette crise de confiance nous a incités à former nos étudiants à prendre des décisions non pas seuls mais en construisant les solutions avec l’ensemble de la société civile, en partant des problèmes concrets rencontrés par les citoyens, et non d’une approche technocratique venue d’en haut. Nous avons, par exemple, mis en place un incubateur de politiques publiques dans lequel les étudiants doivent travailler sur des questions précises de santé publique, d’éducation pour tous, d’environnement, d’accueil des réfugiés, etc. Dans le même objectif, nous avons aussi lancé un programme d’innovation démocratique consistant à développer de nouvelles formes de participation des citoyens.
Nous sensibilisons nos étudiants au fait que prendre des décisions éclairées passe par l’utilisation d’une pluralité d’indicateurs, à la fois quantitatifs et qualitatifs. Cela n’a pas toujours été le cas. Lorsque vous menez une politique de santé, par exemple s’il est nécessaire d’avoir un regard budgétaire qui permet la viabilité du service, il ne faut jamais perdre de vue la mission essentielle de qualité des soins et du bien-être des patients.
Comment se traduit concrètement cette approche dans les enseignements ?
A titre d’illustration, l’Ecole d’affaires publiques a introduit des cours d’éthique, de déontologie, d’évaluation, d’humanités, d’intelligence collective, en compléments des cours plus habituels en droit, économie ou sciences sociales. Nous multiplions aussi les approches interdisciplinaires en insistant sur le rôle de l’histoire, de la science politique, de la sociologie, du management public. Mais aussi de la psychologie, des humanités numériques, des grands enjeux éthiques et scientifiques posés par les nouvelles technologies. Cette place prépondérante donnée aux sciences sociales mais aussi à tous les savoirs, dans un contexte international, doit permettre un pluralisme des idées qui était, de fait, moins présent avant la crise.
Nous essayons enfin d’apprendre à nos étudiants l’humilité, la capacité à envisager l’ensemble des scénarios pour résoudre un problème. Car face à des problématiques complexes, il ne peut y avoir de réponse simple, de « bonne » solution opposée à une « mauvaise », de recette miracle.
Qu’en est-il de ce pluralisme des idées dans l’enseignement de l’économie, lui aussi épinglé après 2008 ?
Au lendemain de la crise, il y a eu une prise de conscience dans certaines grandes écoles : il fallait arrêter d’enseigner l’économie comme si les trente dernières années n’avaient pas eu lieu. Ce souhait est d’abord venu des étudiants et enseignants à qui on demandait « pourquoi la crise ? » et qui n’étaient pas toujours capables de répondre. Dans une étude réalisée aux Etats-Unis et en France, nous avons interrogé des étudiants sur les thèmes qu’ils aimeraient voir abordés en économie. Réponse : l’origine des crises financières, les inégalités, le changement climatique, les sources de prospérité et de bien-être…
Ces questions-là, les élèves ne les abordaient soit pas du tout, ou tardivement dans leur cursus pour ceux qui poursuivaient leurs études. Les cours d’économie étaient fondés le plus souvent sur des grandes théories, des situations fictives autour d’un Homo economicus agissant de façon rationnelle, sans prendre en compte ses biais cognitifs et sans aborder directement les imperfections de marché. On laissait les étudiants découvrir plus tard par eux-mêmes que non, le marché ne se régule pas tout seul, etc.
Pour renouveler les pratiques, vous avez participé à l’écriture de CORE, un manuel international d’économie plus ouvert au pluralisme…
Depuis la crise, la recherche en science économique s’est beaucoup enrichie, notamment en intégrant de plus en plus les sciences sociales (histoire, psychologie, sociologie, etc.). Mais aussi en cherchant à s’appuyer systématiquement sur des exemples concrets et des données. C’est ce que nous essayons de faire depuis 2016 avec CORE (pour Curriculum Open-Access Resources in Economics).
Utilisé dans 140 pays, en France à Science Po et à la Toulouse School of Economics, ce manuel aborde les théories économiques, mais aussi les grands défis contemporains et les récentes crises. Il fait la part belle aux derniers résultats de la recherche, avec beaucoup de recul historique ainsi que des exemples précis de décisions économiques prises dans tel pays, dans tel contexte. Il montre aussi les limites des marchés, les questions en suspens…
Encore faut-il que le pluralisme s’incarne aussi dans le recrutement des enseignants des écoles… Où en est-on ?
Mon sentiment est que les grandes écoles ont fait un vrai effort en ce sens ces dernières années. On recrute de plus en plus de jeunes économistes avec des profils différents. Ils s’intéressent à des sujets aussi divers que l’éducation, la santé, le bien-être, l’environnement ou encore les nouvelles technologies. Ils utilisent des méthodes à la fois quantitatives et qualitatives. Je ne suis pas sûr que l’opposition binaire entre économistes orthodoxes et hétérodoxes rende justice à la diversité des chercheurs.
Il est essentiel que les écoles puissent être des lieux qui font se rencontrer les opinions contradictoires afin de voir où sont les consensus et les lignes d’opposition en matière d’économie. Mais il ne faut pas non plus tomber dans un relativisme béat : il existe des évidences et des faits économiques historiques qui peuvent nous guider pour prendre des décisions, et qui doivent donc être enseignés.
« Le Monde » organise son Salon des grandes écoles les 10 et 11 novembre
La 13e édition du Salon des grandes écoles (SaGE) aura lieu samedi 10 et dimanche 11 novembre à Paris, aux Docks, Cité de la mode et du design (13e arrondissement), de 10 heures à 18 heures.
Plus de cent cinquante écoles de commerce, d’ingénieurs, IAE, IEP, écoles spécialisées et prépas y seront représentées, permettant d’échanger sur les différents programmes et leur accessibilité (post-bac, post-prépa ou après un bac + 2, + 3 ou + 4). Lycéens, étudiants et parents pourront également assister à des conférences thématiques animées par des journalistes du Monde Campus. Une équipe de vingt « coachs » pourra également conseiller lycéens, étudiants et parents pour définir leur projet d’orientation, préparer les concours ou rédiger leur CV.
L’entrée en sera gratuite, la préinscription en ligne est conseillée pour accéder plus rapidement au Salon. Liste des exposants et informations pratiques sont à retrouver sur le site Internet du SaGE.






