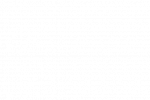« Mia madre » : l’insondable douleur d’une fille

« Mia madre » : l’insondable douleur d’une fille
Par Isabelle Regnier
Nanni Moretti met en scène une cinéaste bouleversée, en plein tournage, par l’agonie de sa mère.
Quand le film commence, Margherita Buy est en plein tournage, occupée à diriger une scène de conflit entre des ouvriers révoltés contre l’entreprise qui rachète leur usine et s’apprête à les licencier, et un bataillon de policiers armés de matraques, de grenades lacrymogènes, de lances à eau…
La réalisatrice d’une cinquantaine d’années s’emporte contre son chef opérateur qui filme de trop près, selon elle, les corps et les visages, l’accuse de jouir de la violence de la situation, le soupçonne d’être du côté des flics. Elle s’approche d’une actrice pour lui dire qu’elle doit se tenir « à côté » de son personnage, et la laisse se débrouiller avec cette formule énigmatique.
Implosion intérieure
Ses soirées, Margherita les passe à l’hôpital, auprès de sa mère malade, dont on lui annonce bientôt la fin prochaine. Pas de cris, pas de pleurs. La perspective que recouvrent ces mots, la disparition de cette femme qui l’a mise au monde, aimée sans condition, tout au long de sa vie, est à ce point inacceptable qu’elle ne la comprend pas. Elle demande à son frère (Nanni Moretti, parfait dans ce rôle discret d’homme solide, calme, aimant) de traduire les paroles des médecins. Les certitudes qu’elle avait érigées en dogmes s’effondrent, et, avec elles, les digues qui lui permettaient de tenir en un seul morceau. Désarmée, vulnérable à tout, elle dérive, à la surface d’une réalité devenue soudain absurde.
Voilà le film. Une mise en récit de cette implosion intérieure invisible, indicible, qui ébranle les vivants quand la mort vient trop près d’eux réclamer son dû. Porté par la sensibilité bouleversante et le jeu, tout en variations infimes, de son actrice, Moretti met en scène une nouvelle tragédie de l’impuissance où se déplie une implacable dialectique de la douleur : le drame qui emmure Margherita dans une solitude infinie est aussi ce qui la relie à l’humanité entière.
La folie déglinguée de John Turturro
Les voix qui résonnent sur le plateau, dans la salle où elle donne sa conférence de presse, n’arrivent plus à ses oreilles que par intermittence. Elles se dissolvent dans des silences ouatés, ne laissant plus que la sienne, blanche, occuper l’espace vide de son esprit.
Margherita débranche, s’abîme dans des souvenirs, dans des rêves envahissants. La réalité n’est plus à ses yeux qu’une sinistre mascarade, à laquelle Barry Huggins, cet acteur américain, égocentré et mythomane, venu jouer dans son film le représentant des nouveaux propriétaires de l’usine, offre son grimaçant visage. Médiocre en italien, incapable de retenir la moindre ligne de texte, ce bouffon, auquel John Turturro apporte une folie déglinguée, injecte dans le mélo une truculence digne des grandes heures de la comédie italienne, qui maintient le pathos à distance.
Barry incarne le cinéma dans tout ce qu’il peut avoir de superficiel, de ridicule. La machinerie délirante qu’un tournage met en branle devient obscène face à la nudité de l’hôpital, à l’infinie détresse d’une fille qui va perdre sa mère, à la tendresse déchirante que peuvent exprimer un sourire, une caresse… Barry aussi est malade. Un mal héréditaire l’empêche de reconnaître les choses. Pour se souvenir, il doit faire des fiches, question cruciale chez Moretti.
Le cinéma n’est pas qu’affaire de principes et de théories, nous dit Moretti. C’est un bien commun, une source de lien, un viatique d’autant plus précieux qu’il est menacé dans ses expressions les plus singulières.
Mia madre, de Nanni Moretti. Avec Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini, Nanni Moretti (Ital.-Fr., 2015, 110 min). www.arte.tv