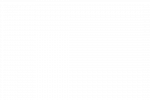Le pur-sang algérien menacé par le déclin du secteur hippique

Le pur-sang algérien menacé par le déclin du secteur hippique
Le Monde.fr avec AFP
Le Haras national de Chaouchaoua n’abrite plus que 208 chevaux, alors que 20 000 poulains y naissaient chaque année au début du XXe siècle.
Des chevaux élevés au Haras national de Chaouchaoua, en Algérie, en avril 2018. / RYAD KRAMDI / AFP
Vieux de plus de 140 ans, le Haras national de Chaouchaoua est un monument du patrimoine algérien, mais il se meurt, victime de la mécanisation, du déclin du secteur hippique et du désintérêt des pouvoirs publics.
A sa création par le colonisateur français, en 1877, sous le nom de « Jumenterie de Tiaret », à 340 km au sud-ouest d’Alger, il avait pour mission de fournir l’armée française en chevaux : des pur-sangs arabes importés d’Orient et des barbes, une race d’Afrique du Nord qui était déjà montée dans l’Antiquité et réputée pour son endurance et sa « rusticité » (résistance aux aléas climatiques, besoins alimentaires modestes…).
Le barbe a été la monture des régiments des spahis de la cavalerie française après la conquête de l’Algérie par la France en 1830. La Jumenterie a aussi développé l’arabe-barbe, issu du croisement des deux races et alliant l’énergie de l’un et l’endurance de l’autre. Au début du XXe siècle naissaient dans ce haras jusqu’à 22 000 poulains par an, destinés à la cavalerie mais aussi aux travaux agricoles.
Du côté des pur-sangs, certaines lignées issues d’étalons et poulinières nés à Chaouchaoua, devenue Haras national à l’indépendance de l’Algérie, en 1962, se sont couvertes de gloire sur les hippodromes du monde entier. Mais avec la mécanisation, le besoin en chevaux n’a cessé de diminuer, dans l’armée comme dans l’agriculture. Quant au hippisme, il est aujourd’hui moribond en Algérie et les courses réservées aux chevaux nés localement ont disparu.
Goût pour les races importées
Le Haras national de Chaouchaoua n’abrite plus désormais que 208 chevaux, dont plus de la moitié sont des pur-sangs arabes. Et comme cet établissement public ne reçoit aucune subvention, il ne parvient plus à s’autofinancer avec le seul commerce de ces animaux. La vente de fourrage et de céréales cultivées sur la majeure partie du terrain lui permet tout juste de tenir.
« Avoir maintenu l’élevage de chevaux relève du miracle », constate avec amertume Saïd Benabdelmoumen, le directeur des lieux. Car depuis le début des années 1990, le haras souffre notamment de la concurrence d’éleveurs privés et du goût récent pour des races importées. S’il vient à disparaître, « nous risquons de perdre la souche algérienne » des pur-sangs arabes, met en garde Ahmed Bouakkaz, un responsable de l’Office national de développement équin et camelin.
Malgré sa tradition équestre ancestrale – incarnée notamment par les spectacles de fantasia –, l’Algérie ne compte plus, selon M. Bouakkaz, qu’environ 30 000 chevaux, dix fois moins qu’au Maroc voisin. Pour lui, le Haras de Chaouchaoua est « victime de la politique générale liée au cheval », ignoré des pouvoirs publics bien que partie intégrante du patrimoine culturel de l’Algérie.