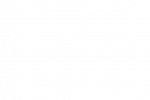Marcelo Martinessi : « le cinéma paraguayen n’a ni structure, ni industrie, ni institut »

Marcelo Martinessi : « le cinéma paraguayen n’a ni structure, ni industrie, ni institut »
Propos recueillis par Véronique Cauhapé
Le réalisateur du long-métrage « Les Héritières » déplore qu’il soit si difficile de tourner des films dans son pays, faute de financement
Né en 1973 à Asunción, au Paraguay, Marcelo Martinessi a réalisé trois courts-métrages, Karai Norte (2009), Calle Ultima (2010) et The Lost Voice (2016). En 2010, il a été chargé par le gouvernement du président Fernando Lugo de mettre en place la première télévision publique du pays qu’il a ensuite dirigée jusqu’au coup d’État de 2012. Avec Les Héritières, il signe son premier long-métrage.
L’industrie du cinéma au Paraguay a toujours manqué de moyens et d’équipement. Elle a aussi souffert durant les trente-cinq ans de la dictature d’Alfredo Stroessner (1954-1989). A quel contexte se voit confronté aujourd’hui un réalisateur qui veut tourner un film ?
Au Paraguay, il n’est pas seulement difficile de réaliser des films. Les difficultés s’étendent à tout ce qui a trait à la culture. Parce que nous n’avons pas une histoire importante concernant la littérature, la peinture, le cinéma… des domaines auxquels nous n’avons pas eu accès durant de très nombreuses années. La culture paraguayenne s’est construite, en grande majorité, à l’extérieur. L’écrivain Augusto Roa Bastos a par exemple beaucoup vécu à Buenos Aires, puis en France ; Augustin Barrios, grand musicien classique, a quitté le Paraguay et voyagé à travers l’Amérique ; Jose Asuncion Flores, le créateur du genre musical appelé Guarania, a dû s’exiler en Russie.
Aujourd’hui, quelques films – 7 Cajas (7 Boîtes) et Searchers (Chercheurs d’or) de Juan Carlos Maneglia et Tana Schémbori; La Última tierra de Pablo Lamar, Cloudy Times d’Arami Ullon; Memory Exercises de Paz Encina – ont commencé à faire connaître le cinéma paraguayen en dehors de nos frontières. Et nous en sommes très heureux. Mais la clé demeure le financement, car nous n’avons ni structure, ni industrie, ni institut.
Est-ce la raison pour laquelle vous signez votre premier long-métrage à 45 ans ?
Oui, bien sûr. Après trois courts-métrages, si je voulais faire un film, il me fallait un scénario très fort. Je suis donc venu à Paris où j’ai pu bénéficier de l’aide de la Cinéfondation pour écrire mon scénario. Sans cela, je n’aurais jamais pu imaginer en être capable, parce que je viens d’un petit pays où il n’y a pas de cinéma… Ensuite, il a fallu des années et l’intervention de plusieurs pays pour financer le film.
Vous dites que l’idée du scénario des « Héritières », au casting quasi entièrement féminin, remonte à loin...
Pour mes courts-métrages, j’avais principalement adapté des nouvelles ou des romans. Mais chaque fois me revenaient mes souvenirs d’enfance au Paraguay, entouré de beaucoup de femmes. La gouvernante qui s’occupait de moi, ma mère, quatre sœurs, beaucoup de tantes, de grands-tantes… Il fallait que je m’attache à cela dans mon premier film. Je voulais aussi réaliser un film qui soit le portrait de mon pays, d’une société qui sort des ténèbres. C’est pourquoi le début des Héritières est très noir, oppressant, avec des femmes confinées chez elles, sans que l’on voie le monde extérieur. Je voulais créer ce sentiment de claustrophobie, avec des plans très serrés. Même si la dictature est terminée, nous avons toujours l’impression de vivre dans une vaste prison.
En quoi cette classe de la petite bourgeoisie dont sont issues les femmes de votre film vous intéresse-t-elle particulièrement ?
Parce que cela me permet de parler de l’endroit d’où je viens et auquel je ne me sens plus appartenir. En 2012, lors du coup d’état parlementaire qui avait destitué le premier président de gauche du Paraguay, Fernando Lugo, j’avais détesté la façon dont les gens de ma classe sociale avaient réagi. Ils avaient soutenu cette action contre la démocratie avant tout parce qu’ils voulaient conserver leurs privilèges. Je me suis alors senti étranger à ma propre famille. Cela a été une grande tristesse et en même temps une merveilleuse opportunité. Car il m’a fallu chercher un autre endroit auquel appartenir. Ce qui m’est arrivé à ce moment-là, c’est ce qui arrive au fond dans le film à Chela quand elle perd son statut, à cause de la situation économique, et qu’elle s’aperçoit aussi qu’il y a d’autres choses dans le monde. Il y a beaucoup plus à découvrir que de s’enfermer dans une classe sociale.
Comment avez-vous travaillé avec les actrices ?
Nous sommes issus d’une société où il n’y a pas d’école de comédie, ni d’opportunité de carrières dans le cinéma ou le théâtre. Margarita Irún a fait du théâtre il y a cinquante ans, Ana Brun, très peu et il y a longtemps. Ce qu’elles ont apporté au jeu, à la place de la technique, c’est l’intensité de leurs propres vies, de leurs expériences. Et elles m’ont aussi donné beaucoup de leurs temps. Parce que nous avons grandi dans un pays où nous n’avons jamais entendu notre langue parlée sur un écran, jamais vu nos villes sur un écran, le défi était difficile. Or, elles m’ont beaucoup aidé à comprendre que c’était un pays invisible, une classe sociale invisible.